L’Autisme on en parle …
Publié le 07/03/2008 à 00:00
-  36 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
36 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
La semaine du cerveau est l'occasion de faire un point sur l'autisme, mal dont l'origine reste inconnue et dont les orientations thérapeutiques sont nombreuses. Néanmoins, la recherche actuelle s'oriente dorénavant vers des déficits cognitifs, sociaux, neurobiologiques ou encore sensoriels.
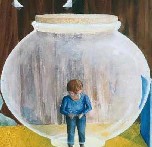
Dans le cadre de la semaine du cerveau (du 10 au 16 mars 2008), en collaboration avec l’Institut Fédératif des Neurosciences de Lyon,
un film sera projeté : L’autisme d’aujourd’hui à demain
, réalisé par Marcel Dalaise, publié par le CNRS en 2007.
 Depuis que l’autisme a été décrit pour la première fois par Léo Kanner en 1943, les critères définissant les symptômes ont considérablement évolué.
Depuis que l’autisme a été décrit pour la première fois par Léo Kanner en 1943, les critères définissant les symptômes ont considérablement évolué.
Une étude de l’INSERM estime le taux d’autistes dans la population à 27 pour 10 000.
La piste génétique, sans tout expliquer, se confirme de jour en jour. Par ailleurs, les outils modernes d’imagerie cérébrale commencent à donner des éléments de réponse sur certains dysfonctionnements dans la perception des émotions. D’autres chercheurs proposent des techniques innovantes pour activer certains réseaux neuronaux à l’origine de la communication. Car les autistes peuvent faire des progrès à tout âge.
Une conférence-débat : « Autisme, cerveau et communication », animée par Anne Reboul, docteur en linguistique, chargée de recherche au CNRS, et auteur du livre Langage et cognition humaine
 L’autisme se caractérise comme une pathologie affectant les capacités de l’individu à établir des relations sociales normales avec autrui. Il est diagnostiqué à partir de trois critères : difficultés de communication qui se manifestent notamment par un retard ou une absence totale de langage, intérêts limités et répétitifs et absence de jeu symbolique. Le diagnostic est souvent posé vers 3 ans, lorsque le retard de langage devient sensible. Les origines de l’autisme sont probablement en grande partie génétiques, même s’il est peu probable qu’une unique anomalie en soit la cause. Après un bref rappel des travaux des vingt dernières années, focalisés sur les difficultés sociales, la conférence abordera des études plus récentes mettant en lumière des particularités dans la perception, la catégorisation et la communication. Enfin, l’aspect cérébral sera abordé avec le cas des « neurones miroir » dédiés à la reconnaissance de l’action, et dont le dysfonctionnement chez les autistes expliquerait en partie les problèmes sociaux rencontrés chez ces patients.
L’autisme se caractérise comme une pathologie affectant les capacités de l’individu à établir des relations sociales normales avec autrui. Il est diagnostiqué à partir de trois critères : difficultés de communication qui se manifestent notamment par un retard ou une absence totale de langage, intérêts limités et répétitifs et absence de jeu symbolique. Le diagnostic est souvent posé vers 3 ans, lorsque le retard de langage devient sensible. Les origines de l’autisme sont probablement en grande partie génétiques, même s’il est peu probable qu’une unique anomalie en soit la cause. Après un bref rappel des travaux des vingt dernières années, focalisés sur les difficultés sociales, la conférence abordera des études plus récentes mettant en lumière des particularités dans la perception, la catégorisation et la communication. Enfin, l’aspect cérébral sera abordé avec le cas des « neurones miroir » dédiés à la reconnaissance de l’action, et dont le dysfonctionnement chez les autistes expliquerait en partie les problèmes sociaux rencontrés chez ces patients.
Afin d’alimenter cette réflexion, une bibliographie sélective vous est proposée.
Sommaire :
1- Connaissances sur l’autisme
2- Le syndrome d’Asperger
3- Approches biologiques de l’autisme
4- L’apport des neurosciences
5- Stratégies éducatives
6- Témoignages et récits personnels
7- Vivre autiste aujourd’hui
8- Des films
9- L’autisme expliqué aux enfants

- L’Uomo Cubo de Marino di Prospero
1- Connaissances sur l’autisme
Par Carole Tardif et Bruno Gepner, aux éditions Armand Colin, 2007.
L’autisme recouvre des entités cliniques différentes en fonction des personnes et du degré de
sévérité de leurs troubles.
Cette diversité amène à parler du » spectre autistique « , qui se situe au carrefour de la pédopsychiatrie, de la neurobiologie et de la psychopathologie développementale. L’autisme est présenté à travers son histoire, ses causes multiples, ses mécanismes développementaux complexes, ses modèles explicatifs, ses outils d’évaluation et ses approches rééducatives et thérapeutiques. Des exemples étayent les propos des auteurs et illustrent leurs rencontres avec les personnes autistes et leurs familles.
 L’autisme : de la recherche à la pratique
L’autisme : de la recherche à la pratique
Par Alain Berthoz, Christian Andres, Catherine Barthélémy, Jean Massion, Bernadette Rogé, aux éditions O. Jacob, 2005.
Ce livre témoigne des progrès accomplis dans la compréhension des aspects génétiques, neurologiques et cognitifs de cette maladie, et des handicaps qu’elle entraîne.
La grande diversité de ses symptômes, notamment les troubles de la communication et de la socialisation, rend difficile son diagnostic et son traitement.
Se pose également le problème de la prise en charge des enfants et du soutien de leur famille dans une société mal préparée à les accueillir.
 Autisme : état des lieux et horizons
Autisme : état des lieux et horizons
Sous la direction de Bernard Golse et Pierre Delion, aux éditions Erès, 2005.
L’autisme infantile précoce demeure, encore aujourd’hui, une question délicate.
Il est nécessaire de l’aborder avec le plus grand calme et le plus grand sérieux pour ne pas relancer des polémiques passionnelles et stériles. Par ailleurs, d’un point de vue éthique, il importe de manier avec prudence toute nouvelle information scientifique en ce domaine afin de ne pas faire naître des espoirs trop hâtifs, véritables surenchères à la souffrance des enfants et de leurs familles à l’origine de déceptions et de rancœurs parfois insurmontables.
Dans cet ouvrage qui reprend actualisé et complété, le dossier publié dans Le carnet/Psy. Les meilleurs spécialistes de l’autisme développent les principaux axes des études les plus actuelles et proposent donc un état des lieux complet sur la question. Les lecteurs disposent là d’un outil leur permettant de trouver, non pas l’ensemble des réponses à chacune de leurs demandes, mais au moins la ou les références dont ils auraient besoin pour les retrouver et les approfondir.
Par Rosine et Robert Lefort, aux éditions du Seuil, 2003.
Rosine et Robert Lefort abordent l’autisme à partir des repères cliniques que leur assure
l’enseignement de Jacques Lacan.
Leur clinique en vérifie l’empan. Comme des analystes ne peuvent y manquer, Rosine et Robert Lefort soutiennent cette orientation de la place qui leur est propre : confrontés à un autiste, ils prennent au sérieux son statut de sujet, c’est-à-dire d’être parlant. Ils assurent ainsi la transmission de leur expérience clinique, dont ils rendent inlassablement compte, comme en attestent leurs précédents travaux.
Aucune recette, mais une formalisation qui concerne chacun, dans un style dont le souffle tient dans l’attention au détail. Associer à la lecture des cas les plus connus à celle d’auteurs parmi les plus notoires de notre culture épingle la distinction de l’autisme. Et du même mouvement le distingue de toute autre psychose, de la schizophrénie notamment.
 Contreverses sur l’autisme et témoignages
Contreverses sur l’autisme et témoignages
Par Denys Ribas, aux éditions PUF, 2004.
À la fois fascinant et angoissant, l’autisme infantile fait depuis sa description l’objet de
polémiques passionnées qui mènent souvent à des impasses.
A partir du travail de Hans Asperger, plus complet que l’on ne le pense habituellement et précurseur du traitement en institution, à partir aussi et surtout de témoignages d’anciens autistes et de la psychothérapie analytique d’un enfant, Denys Ribas fait le point sur cette maladie énigmatique… Examinant toutes les thèses aujourd’hui en discussion, les progrès de la génétique et les conditions d’accès à la symbolisation, l’auteur, dans une constante confrontation à l’expérience clinique, instaure un véritable débat entre les points de vue traditionnellement opposés de la psychanalyse et des sciences cognitives.
Le syndrome d’Asperger est une forme atténuée de l’autisme, avec un développement normal de l’intelligence et du langage, voire même supérieur à la moyenne, mais où l’on retrouve néanmoins des problèmes d’interaction sociale et de communication.
 Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau
Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau
Par Tony Attwood, aux éditions Dunod, 2003.
Les toutes premières descriptions d’un groupe d’enfants présentant des caractéristiques inhabituelles nous ont été livrées, il y a plus d’une cinquantaine d’années, dans les travaux de Hans Asperger, clinicien autrichien et pédopsychiatre. Ces travaux ont été réactualisés pour définir le Syndrome d’Asperger et aboutir à une reconnaissance récente par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les personnes présentant ce syndrome ont une perception atypique de l’environnement, un mode de raisonnement logique, mais dépourvu du » sens commun « , ce qui les rend vulnérables socialement.
Il est indispensable de connaître et de reconnaître cette » manière d’être » différente, souvent qualifiée par l’entourage, de bizarre, décalée, excentrique, naïve, solitaire.
Tony Attwood, qui s’adresse aux proches et aux professionnels, nous livre ici la somme de plus de 25 années d’expérience passées auprès de personnes atteintes du Syndrome d’Asperger, de tous âges, de conditions et d’aptitudes très variées.
 La personne autiste et le syndrome d’Asperger
La personne autiste et le syndrome d’Asperger
Par Guy Hérault et Jean-Charles Juhel, aux éditions des Presses de l’Université de Laval, 2007.
Dans cet ouvrage, les auteurs présentent un bref historique de la prise en charge de la personne autiste ; l’essentiel des connaissances actuelles sur les causes possibles de l’autisme ; le diagnostic, sa raison d’être, ses limites ; les différents traitements possibles ; les particularités du développement de la personne autiste sur les plans physiques et cognitifs ; l’affectivité chez la personne autiste ; des moyens, des stratégies pour aider l’intervenant ; les aspects particuliers du développement de la personne atteinte du syndrome d’Asperger.
3- Approches biologiques de l’autisme
Dans la grande majorité des cas, les circonstances à l’origine de l’autisme demeurent inconnues. Plusieurs recherches suggèrent néanmoins des susceptibilités génétiques.

- Mélatonine
Autisme : la part de gènes, par l’Institut Pasteur.
Une équipe de l’Institut Pasteur vient d’identifier un nouveau gène impliqué dans l’autisme et jouant un rôle clé au niveau de la communication entre les neurones.
Il est probable que plusieurs gènes soient impliqués et qu’en outre les gènes responsables varient d’une famille à l’autre…
 Langage voix et parole dans l’autisme
Langage voix et parole dans l’autisme
Sous la direction de Bernard Touati, aux éditions PUF, 2007.
La question du langage, de son apparition, de son absence, de ses particularités est, depuis toujours, au centre des descriptions de l’autisme infantile précoce. Dans les traitements, le maniement du langage n’est pas non plus sans remettre profondément en question nos objets de connaissance et nos pratiques et dans le cas d’autisme, les thérapeutes sont confrontés à un patient qui ne parle pas ou très peu ou très bizarrement et qui reçoit ce qui lui est dit de façon totalement imprévisible. Ce qui interroge en permanence les aménagements du cadre et la « position » singulière de l’analyste, la nature du travail interprétatif et fondamentalement le processus spécifique attendu du traitement.
Le projet de ce livre est de re-dégager analytiquement les spécificités pathologiques autant que les richesses et les originalités mobilisables dans le cadre de l’analyse. Cet ouvrage reprend en partie la matière de deux journées d’études internationales organisées par le Centre Alfred Binet en lien avec les séminaires de recherche régulièrement organisés par le Centre Alfred Binet.
Par Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, aux éditions O. Jacob, 2008.
A l’évidence, faire quelque chose et imaginer le faire ne reviennent pas au même.
Et pourtant ! Il se pourrait bien que, pour notre cerveau, la pensée et l’action soient une seule et même chose.
Voilà ce que révèlent Giacomo Rizzolatti et son équipe, qui ont découvert des neurones étonnants : ils s’activent lorsqu’on effectue une action, mais aussi lorsqu’on voit quelqu’un d’autre la réaliser lui-même.
Ce livre décrit les stupéfiantes propriétés de ces « neurones miroirs « , explique leur mécanisme et souligne leur importance. Ils sont les promoteurs du langage, ils expliquent pourquoi nous parlons aussi avec nos mains. Ils rendent compte de l’expression des émotions ; ils sont le mécanisme de notre compréhension d’autrui. Au terme de ce parcours inédit dans le cerveau, une interrogation surgit : et si ces neurones miroirs étaient à la base de nos comportements sociaux ?
 Comment pense une personne autiste ?
Comment pense une personne autiste ?
Par Peter Vermeulen, aux éditions Dunod, 2005.
« Je ne présente pas dans ce livre une théorie générale sur l’autisme.
C’est plutôt un carnet de bord, une sorte d’album qui tente de décrire les méandres de la pensée particulière aux personnes autistes.
Au lieu de proposer des exposés traditionnels et théoriques, j’ai choisi deux analogies pour présenter l’autisme : l’ordinateur et l’humour.
Il n’est pas question de réduire le terrain de ce handicap. Mais la comparaison avec l’ordinateur rend la pensée autistique plus concrète et l’humour en donne un visage plus humain. »
 L’autisme : de la compréhension à l’intervention
L’autisme : de la compréhension à l’intervention
Par Theo Peeters, aux éditions Dunod, 2008.
Considéré comme l’une des plus complexes anomalies psychiques, l’autisme concerne en France environ 60 000 personnes.
Dans ce livre, Theo Peeters, qui compte parmi les pionniers de la prise en charge éducative, fait constamment le lien entre la compréhension théorique de l’autisme et ses conséquences pour l’intervention pratique.
Son livre constitue le premier module du programme européen Educautisme, principal programme de prise en charge éducative, alternative aux thérapies d’ordre psychiatrique ou psychanalytique.
 Comment aider l’enfant autiste
Comment aider l’enfant autiste
Par Marie-Dominique Amy, aux éditions Dunod, 2004.
Les enfants autistes ont besoin, pour être aidés au mieux, qu’on les approche dans leur totalité.
Dépasser les querelles d’école, faire le point sur l’état des connaissances, exposer les moyens thérapeutiques disponibles, tels sont les principaux objectifs de ce livre. Ces enfants ont besoin d’être entendus et reconnus psychiquement pour être éduqués et compris dans leurs failles cognitives extrêmes. Ces failles doivent être travaillées pour que l’approche psychique prenne sens : pratiques éducatives et pratiques psychothérapiques peuvent et doivent donc être menées en commun dans une alliance thérapeutique constante.
Ce livre présente d’abord ces différentes approches et explique clairement comment il est possible de les articuler. II redéfinit les principaux termes fréquemment utilisés dans les pathologies autistiques (communication, attention, mémoire, langage, pensée etc.). Il explique enfin avec de nombreux cas cliniques comment mettre en place le soin et la collaboration avec les parents. L’auteur relate notamment un parcours complet de psychothérapie avec François.
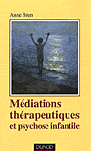 Médiations thérapeutiques et psychose infantile
Médiations thérapeutiques et psychose infantile
Par Anne Brun, aux éditions Dunod, 2007.
Les médiations thérapeutiques, comme la peinture, le modelage, les jeux d’eau, constituent un axe majeur du soin aux enfants psychotiques en pratiques institutionnelles, mais cette clinique manque souvent d’articulations théoriques.
Aussi l’auteur propose-t-elle une approche métapsychologique de la médiation dans la psychose infantile et dans l’autisme. Il s’agit d’une réflexion sur l’objet médiateur, sur les cadres-dispositifs à médiation et les modalités spécifiques des processus de symbolisation qui s’y déploient, ainsi que sur la technique du travail thérapeutique, individuel et en groupe. Les médiations thérapeutiques présentent l’intérêt de permettre aux enfants d’accéder aux processus de symbolisation à partir de la sensorialité.
L’originalité de ce cadre thérapeutique consiste à engager un travail de figuration à partir du registre sensoriel, tant de la sensori-motricité de l’enfant que des qualités sensorielles du » médium malléable « , en mobilisant de façon spécifique la dynamique transférentielle. S’appuyant sur une clinique concrète et diversifiée, cet ouvrage concerne tous les professionnels du soin psychologique dans les domaines de la prise en charge de la psychose et de l’autisme.
 Rencontrer l’autiste et le psychotique : jeux et détours
Rencontrer l’autiste et le psychotique : jeux et détours
Par François Hébert, aux éditions Vuibert, 2006.
Ce livre part d’un constat élémentaire : autistes et psychotiques sont comme étrangers à notre monde.
Et pourtant, il semble bien qu’ils nous lancent, à leur façon, des appels. La première tâche pour ceux qui partagent leur quotidien est alors d’établir le contact, l’échange réciproque. Parce que la relation directe leur est non seulement difficile mais essentiellement menaçante, il nous faut auprès d’eux réinventer les modalités de la rencontre. On propose ici d’explorer des pistes qui peuvent ouvrir une brèche dans le mur qui semble nous séparer d’eux : supports, attitudes spécifiques, façons de leur parler, détours qui évitent de faire intrusion dans leur monde et tentent de les rejoindre dans un espace commun.
C’est largement en nous impliquant sur le mode du jeu, qui leur manque tant, que nous créerons une scène où nous serons moins » dangereux » pour eux, et qu’une confiance pourra se construire, fondée sur le plaisir retrouvé de l’échange. Pour donner à nos tentatives consistance et pérennité, un effort de théorisation est nécessaire, fait d’hypothèses prudentes et provisoires. Enigmatiques, ces personnes nous demandent de suspendre notre volonté de les ramener directement dans notre monde, d’oublier ce que nous croyons savoir, de nous impliquer humainement et intellectuellement pour apprendre pas à pas ce qu’elles attendent de nous.
 Autisme et A.B.A. : une pédagogie du progrès
Autisme et A.B.A. : une pédagogie du progrès
Par Ron Leaf et John McEachin, aux éditions Pearson Education, 2006.
La découverte de l’autisme provoque toujours un choc et un bouleversement des habitudes familiales.
Parmi les méthodes destinées à favoriser le développement, l’A.B.A. (Applied Behavior Analysis), également appelée méthode béhavioriste ou comportementaliste, lorsqu’elle est appliquée à l’autisme, est la plus efficace à ce jour. Sa stratégie est double : développer des compétences fonctionnelles avec la mise en œuvre des moyens de communication, et diminuer les comportements problématiques tels que les accès de colère, l’auto-mutilation ou l’autostimulation.
Après des décennies de recherches, Ron Leaf et John McEachin exposent ici le programme qu’ils ont mis en place afin d’enseigner les compétences nécessaires à l’autonomie de la personne autiste. La première partie rappelle les techniques behavioristes à maîtriser : le renforcement, la diminution progressive des aides, la technique de l’essai distinct multiple et l’enseignement fortuit. La seconde partie reprend chacun des objectifs visés en les décomposant en petites étapes successives.
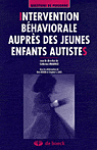 Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes
Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes
Dirigé par Catherine Maurice, aux éditions De Boeck, 2006.
Les causes de l’autisme demeurent aujourd’hui encore incertaines et l’observation directe du comportement du jeune enfant reste donc à ce jour le seul moyen de diagnostiquer ce trouble.
De nombreux parents ne découvrent ainsi que vers la troisième ou quatrième année de vie de leur enfant la nature du trouble qui l’affecte et il est souvent difficile d’entreprendre un programme précoce d’intervention structuré et intensif. Afin d’aider les intervenants et les parents à agir le plus tôt possible, le présent ouvrage fait le point sur les programmes d’intervention actuels et présente des stratégies pour analyser et évaluer (analyse béhaviorale appliquée : A.B.A.) le comportement du jeune enfant autiste et lui permettre de développer ses habiletés au maximum.
 Il y a quelqu’un là dedans : des autismes
Il y a quelqu’un là dedans : des autismes
Par Howard Buten, aux éditions O. Jacob, 2003.
» Certains jours, je me dis qu’en fin de compte, je vais acheter une île déserte ; que je vais prendre tous les autistes de la terre et les emmener avec moi […].
La souffrance, de quoi est-elle faite, au juste – la nôtre, la leur ? Qu’est-ce qui distingue l’une de l’autre ? Combien pèse-t-elle ? Qu’est-ce qui constitue le contraire de la souffrance ? Et si, en fin de compte, c’était le partage, l’apprentissage, la découverte, l’ouverture de l’horizon ? »
Dans son livre, Howard Buten décrit ce qu’il a vu et compris du monde dans lequel les enfants autistes ou psychotiques sont enfermés, comment il a essayé, et souvent réussi, à enter en contact avec eux.
A partir de son expérience il fait le point sur l’autisme.
Sous la direction de Pierre Delion, aux éditions Erès, 2007.
Enracinée dans les différentes cultures du maternage et de l’hydrothérapie à travers le monde, la technique du packing a été récemment réintroduite en pédopsychiatrie.
Ces enveloppements thérapeutiques très encadrés se révèlent très utiles dans le soin des enfants autistes et psychotiques, voire de certaines anorexiques, à condition d’en penser précisément les indications, la mise en œuvre et les conditions institutionnelles. Cet ouvrage vise à donner une information objective sur cette technique en partant d’expériences multiples et en prenant en compte les aspects psychopathologiques, les ouvertures
neurophysiologiques et les problématiques institutionnelles.
Si le packing peut être considéré comme un » organisateur thérapeutique » dans la prise en charge de ces enfants en grande souffrance, il livre aussi, par les observations cliniques qu’il suscite, des hypothèses de compréhension de l’autisme dans ses aspects à la fois corporels et psychiques, et contribue ainsi au développement de la recherche.
Par Fabienne Cassiers, aux éditions du Non-verbal, 2003.
L’auteur de cet essai s’inscrit, certes, dans le territoire des psychothérapies et de la musicothérapie, mais elle ne nous laisse pas dans le vague. Car elle affirme très clairement ce qui l’anime et l’oriente : une formation à la psychologie clinique référée à la psychanalyse dont elle assume pleinement l’éthique et le souci critique. Mais cette formation elle-même est nourrie d’une passion pour la musique. L’expérience personnelle dont elle témoigne avec une frappante simplicité donne le ton de cet essai qui veut à la fois faire le récit d’un parcours et de découvertes subjectives et montrer l’exercice nécessaire et indispensable d’une vision critique – ce qui passe par la reconnaissance d’illusions, d’erreurs et d’ignorances autant que par l’aveu d’un enthousiasme sans réserve pour une forme originale de psychothérapie. Celle-ci s’appuie sur la médiation de l’univers sonore le plus individuel mais aussi le plus partageable avec l’autre – et tout particulièrement cet autre qu’est l’enfant prisonnier de ses défenses autistiques.
 L’enfant autiste et le modelage
L’enfant autiste et le modelage
Par Sophie Krauss, aux éditions Erès, 2007.
« J’ai constaté l’intérêt des enfants autistes les plus régressés pour la pâte à modeler (objet malléable par excellence).
Cette activité leur permet d’exprimer leurs angoisses corporelles et permet à l’adulte de repérer les modalités d’expression et les étapes de la construction puis de l’évolution de leur image du corps. En effet, leurs productions plastiques semblent refléter certains aspects du développement (dimensionnalité psychique, enveloppes psychiques, Moi-corporel), d’un autisme profond jusqu’à l’individualisation.
Pour mettre à l’épreuve cette hypothèse, j’ai élaboré une grille relative au modelage qui établit une correspondance entre les productions plastiques et les étapes du développement de l’enfant autiste (état autistique réussi, récupération de la première peau, phase symbiotique et individuation). Une vingtaine de prises en charges étalées sur sept ans (thérapies à médiation) confirment la pertinence de la grille pour repérer certains aspects du développement de l’enfant à travers ses productions plastiques.
En mettant en évidence les processus psychiques en jeu dans l’utilisation du modelage ainsi que des profils évolutifs, la grille peut aider les professionnels de l’autisme à l’identification des angoisses autistiques. En plus d’être un médium thérapeutique, la pâte à modeler pourrait devenir ainsi un outil de diagnostic et de pronostic. »
 La pataugeoire : contenir et transformer les processus autistiques
La pataugeoire : contenir et transformer les processus autistiques
Par Anne-Marie Latour, aux éditions Erès, 2007.
Le dispositif et la technique de la pataugeoire ont été élaborés par Pierre Lafforgue et son équipe de l’hôpital de jour La Pomme Bleue à Bordeaux pour aider au traitement des enfants autistes et psychotiques.
Anne-Marie Latour, qui a participé à cette création, propose ici un manuel pratique, clinique et théorique à l’usage de tous ceux qui s’intéressent à la médiation par l’eau. La pataugeoire est une technique originale fondée sur l’expérimentation et le dépassement des préoccupations archaïques que ces enfants forment à propos de leur rapport au monde et aux objets. Par la manipulation de l’eau et des objets simples facilitant la symbolisation – proposés dans la pataugeoire, l’enfant figure ses préoccupations, explore et expérimente avec l’aide des soignants les limites de ses propres constructions, souvent bizarres, répétitives et sans ouverture à la communication.
 Autismes et psychoses infantiles : quel accompagnement à l’âge adulte ?
Autismes et psychoses infantiles : quel accompagnement à l’âge adulte ?
Par Catherine Defives-Jeantoux, aux éditions Erès, 2001.
L’auteur, orthophoniste de formation, psychothérapeute, rapporte ici le déroulé, au très long cours, de prises en charge individuelles d’adultes souffrant d’autisme ou de psychoses de l’enfance, et pour la plupart, sans langage verbal.
Bien que reposant sur des éléments de théorisation, cet ouvrage prend le parti d’un témoignage au quotidien d’une pratique institutionnelle. Ainsi, le lecteur se trouve introduit dans l’univers très particulier et trop peu connu des Maisons d’accueil spécialisé. Il y découvre les résonances que cette institution peut avoir avec les pathologies des personnes qui y sont hébergées, et avec les problématiques existentielles fondamentales (le temps, l’abandon, la séparation, les morts psychiques et corporelles…) qu’elles génèrent.
6- Témoignages et récits personnels
 Un chemin de langage dans le lacis de l’autisme
Un chemin de langage dans le lacis de l’autisme
Par Pierre Gilbert, aux éditions l’Harmattan, 2007.
Anne-Christine perd le langage à l’âge de trois ans et devient étrange, considérée atteinte de schizophrénie, puis d’autisme, mal qui serait inguérissable, un entrelacement de phénomènes angoissants toujours renaissants, de jour et de nuit. Pendant des dizaines d’années, ses parents multiplient, en dépit de séparations imposées et nocives, les tentatives de soins les plus diverses trop souvent décevantes. Anne-Christine a déjà 42 ans lorsqu’elle rencontre la « communication facilitée », méthode désormais largement pratiquée. En un instant se révèle une personne inconnue jusqu’alors. Des centaines de pages dont la signification est constamment validée. Sa première demande : « Écris un livre sur moi, j’existe ».Elle dévoile les terreurs de sa naissance, « la peur immonde de l’abandon », la force étrangère qui la pénètre et la « saccage ». Si l’autisme n’est pas pour autant vaincu, les comportements aberrants sont peu à peu explicités. Récemment, elle retrouve, au-delà de l’angoisse, le sens d’une vie perdue, « ma nullité de vie » : aimer infiniment ses proches.
Par Temple Grandin, aux éditions O. Jacob, 1994.
« J’avais six mois quand ma mère s’est rendu compte que je me raidissais dès qu’elle me prenait dans ses bras.
Quelques semaines plus tard, alors qu’elle me câlinait, je la griffai, comme un animal pris au piège, pour échapper à son emprise. » Le diagnostic tombe comme un couperet : Temple est autiste. Pourtant, des années plus tard, se jouant du verdict des experts, elle entreprenait des études supérieures et menait à bien une carrière internationale comme conceptrice d’équipements agro-alimentaires. Si les mots de Temple Grandin nous touchent, c’est parce qu’ils nous montrent l’autisme de l’intérieur, dans ses manifestations les plus intimes ; si son témoignage nous étonne, c’est parce qu’il proclame que cet autre monde mental n’est pas si éloigné du nôtre.
Par Tamara Morar, aux éditions O. Jacob, 2004.
Paul a quatre ans quand les médecins annoncent à ses parents qu’il est atteint d’autisme.
Alors, confrontée à une maladie réputée incurable, à des médecins pessimistes, à une Éducation nationale qui exclut son enfant, Tamara Morar refuse d’accepter l’irrémédiable. Elle décide de se battre et met au point, en s’appuyant sur de nombreuses études spécialisées, une méthode de rééducation. Des centaines d’heures de travail, portées par une endurance et une obstination hors du commun. Dans ce livre, elle nous explique comment peu à peu Paul retrouve la conscience de son corps, le langage, l’interaction avec les autres.
Il se métamorphose. Il reprend une scolarité normale. Aujourd’hui, on peut presque parler de » guérison « . Source d’espoir pour tous les proches d’enfants autistes, ce livre est un appel à une autre prise en charge thérapeutique et sociale de ce trouble envahissant du développement.
 Je suis né un jour bleu : à l’intérieur du cerveau extraordinaire d’un savant autiste
Je suis né un jour bleu : à l’intérieur du cerveau extraordinaire d’un savant autiste
Par Daniel Tammet, aux éditions des Arènes, 2007.
Ce témoignage est un voyage aux côtés d’un jeune homme aux capacités hors du commun.
Comme le héros de Rain Man, Daniel Tammet est un autiste savant, un génie des nombres. Son cerveau lui permet d’effectuer des calculs mentaux faramineux en quelques secondes. Pour lui, les nombres sont des formes et des couleurs. Il a ainsi mémorisé les 22 514 premières décimales du nombre pi, un exploit qui a nécessité plus de cinq heures d’énumération en public. Daniel est également un linguiste de génie : il parle sept langues et a appris l’islandais en une semaine. Bien qu’autiste, il n’est pas coupé du monde : il est capable d’avoir une vie sociale et de raconter ce qui se passe dans sa tête.
Les plus éminents neuroscientifiques s’intéressent à son cas. Daniel décrit avec une simplicité bouleversante son enfance à Londres, dans une famille de neuf enfants. Il raconte ses années d’école, la découverte de sa différence, le soutien aimant de ses parents, la conquête de l’indépendance, la route vers la célébrité.
Par Katia Rohde, aux éditions Imago, 2006.
Katia Rohde est autiste.
Considérée comme » handicapée mentale » jusqu’en 1994, elle fréquente des institutions spécialisées jusqu’au jour où une éducatrice, Marie, découvre, grâce à la méthode de » communication soutenue « , sa vive intelligence et sa prodigieuse mémoire. En fait, à l’insu de tous ceux qui la côtoient, Katia sait lire depuis très longtemps sa langue maternelle, l’allemand. Elle connaît aussi le français, l’anglais, l’arabe, a des notions de latin, de russe, d’italien…
Avec l’aide de sa mère, Katia écrit alors son » autobiographie » – racontant ses terribles tourments, livrant ses étranges sensations, ses désirs inassouvis. Murée dans son silence, enfermée sous le regard des autres, Katia le hérisson – c’est ainsi qu’elle se surnomme, nous offre dans ce texte d’une grande richesse poétique, nourri d’images singulières, un témoignage exceptionnel sur la vie intérieure d’une autiste.
7- Vivre autiste aujourd’hui : une prise en charge encore difficile !
 Les troubles autistiques : du repérage précoce à la prise en charge
Les troubles autistiques : du repérage précoce à la prise en charge
Par Alain Lazartigues et Eric Lemonnier, aux éditions Ellipses, 2005.
Les troubles autistiques – ils sont si divers dans leur expression et leur évolution qu’on ne peut pas parler d’autisme au singulier – constituent un problème de santé publique auquel la société porte une attention croissante, même si elle peut paraître encore insuffisante.
En effet, grande est la souffrance des enfants, des adolescents et des adultes présentant des troubles autistiques, comme celle de leurs parents. Les progrès accomplis dans la compréhension de l’origine des troubles autistiques, dans la connaissance de leur physiopathologie et de leur psychopathologie, ont permis d’améliorer leur prise en charge. Mais beaucoup reste encore à faire, aussi bien en terme de dépistage précoce que pour les prises en charge.
En effet, elles doivent être précoces, plus spécifiques, s’appuyer dès le départ sur les résultats d’une évaluation précise des compétences, des émergences et des déficits de l’enfant, et s’organiser autour d’un projet individualisé. Les auteurs se sont attachés dans cet ouvrage sur l’actualité des troubles autistiques à faire le point sur l’ensemble des questions que pose cette pathologie, afin d’aider les parents, les professionnels et le grand public à prendre la mesure du phénomène et à préciser les moyens actuels pour y répondre.
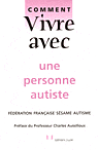 Comment vivre avec une personne autiste
Comment vivre avec une personne autiste
Par la Fédération française Sésame Autisme, aux éditions J. Lyon, 2005.
Tout le monde finit par croire que l’on sait ce qu’est l’autisme puisque ce mot est utilisé par les médias, les politiques et le grand public, pour dire de quelqu’un qu’il ne s’intéresse pas aux autres, qu’il ne cherche pas à les comprendre.
Mais les troubles autistiques chez un enfant, un adolescent, un adulte, c’est bien plus compliqué. Et c’est pour être à même de se situer face à la complexité de ce qui arrive à leur enfant que les parents font, individuellement et en couple, mais aussi au sein d’associations, le point de tous les problèmes que leur enfant et eux-mêmes rencontrent dans la vie quotidienne.
Savoir tout ce que l’on peut savoir est indispensable pour la très grande majorité des parents pour se sentir capables d’exercer leur fonction primordiale pour l’éducation, la socialisation et les soins de leur enfant. Ils se sentent alors mieux à même d’être les concepteurs du projet de vie de leur garçon ou de leur fille, avec l’aide des professionnels de soins ou d’éducation spécialisés dans l’autisme, mais aussi grâce à tous ceux dont le métier est de s’occuper d’enfants ou qui sont engagés à une place dans la vie sociale qui les amène à les rencontrer.
Par Jacqueline Berger, aux éditions Buchet Chastel, 2007.
L’autisme n’est pas une fatalité.
Tel est le fil conducteur de cet essai à contre-courant d’une époque qui renonce à soigner les difficultés psychiques et étiquette les individus dès le plus jeune âge. Jacqueline Berger examine pourquoi et comment la croyance en une » Cause » génétique à l’autisme est devenue dominante. Elle s’insurge contre l’abandon de ces enfants qui ne se construisent pas comme les autres dans un monde avide de vitesse, de rentabilité, de puissance et de jouissance.
Sortir de l’autisme concerne tout le monde, parce que les » autistes » sont le signe autant que le produit de la désagrégation du lien à autrui. Miroir grossissant de nos propres souffrances, ils sont peut-être notre ultime chance d’ouvrir notre regard.
Par Philippe Forest et Olivier Menanteau, aux éditions Actes Sud, 2002.
Personne ne sait vraiment ce qu’est l’autisme et de l’autisme adulte, personne ne veut
Rien savoir.
Un écrivain, Philippe Forest, et un photographe, Olivier Menanteau, ont vécu de nombreux séjours au pavillon des acacias. Leurs récits, textes et photographies, enrichissent le débat sur la maladie mentale et sa place dans notre société.
Un film de Michel Viotte, produit par la Compagnie des Indes, 1995.
A « L’eau vive », hôpital psychiatrique de la région parisienne, l’unité Victor Marcia accueille des déficients mentaux adultes, dont la majorité sont des autistes. Le film témoigne de la façon dont le corps médical, au quotidien, tente d’approcher ces patients, en construisant une petite passerelle entre ces deux mondes fondamentalement différents : notre monde dit normal, social, parlant, et leur monde à eux, dans lequel les mots et les gestes semblent revêtir d’autres significations …
Un film réalisé par Valérie Urréa, produit par la Bibliothèque Publique d’Information, 2005.
Le film de Valérie Urréa s’attache à suivre la relation engagée entre la chorégraphe Mathilde Monnier et Marie- France Canaguier, jeune autiste de vingt-six ans. Il y a les moments d’un spectacle donné par elles deux accompagnées par Louis Sclavis et le travail dans le cadre des ateliers de mouvements menés depuis quatre ans en collaboration avec l’association Les murs d’Aurelle à l’hôpital de la Colombière. La relation entre Mathilde et Marie-France évoquée par les pédopsychiatres, médecins et kinésiologues, transite essentiellement par le corps : c’est au-delà de la parole, mais dans un langage propre. Propre à révéler les capacités physiques étonnantes de Marie-France, lui permettant d’adopter les positions que même un danseur ne peut refaire.
Un DVD du spectacle écrit et interprété par Mary et Michel Vienot, produit par la Compagnie Le Puits, 2005.
Mary et Michel Viénot sont comédiens et parents de cinq enfants. Le quatrième Igor est différent… Il est atteint d’autisme. C’est son histoire et tout ce qu’ils ont appris auprès de cet enfant qu’ils ont choisi de raconter dans le spectacle : « Le Pays d’Igor ».
 Elle s’appelle Sabine
Elle s’appelle Sabine
Un film de Sandrine Bonnaire, 2007.
Sous la forme du regard sensible d’un parent proche, ce documentaire aborde la question de la prise en charge de l’autisme, et plus généralement des troubles mentaux. Il témoigne, au nom des accompagnants d’handicapés mentaux, de leur long parcours du combattant pour trouver des structures adaptées à leurs enfants. Ce film montre les dommages irrémédiables que peut engendrer un mauvais diagnostic et un traitement inadapté, liés à la défaillance du système français.
9- L’autisme expliqué aux enfants
 Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes
Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes
Par Howard Buten, aux éditions Gallimard, 2001.
Les enfants autistes que j’ai rencontrés, j’ai pensé qu’ils avaient une culture à eux.
Qu’ils chantonnaient une musique à eux, qu’ils faisaient des bruits et c’était leur langue à eux, qu’ils se balançaient et c’était leur danse à eux. Bizarre, quoi, un peu comme s’ils venaient d’un autre pays – et même d’une autre planète. Mais justement non, ce qui est bien, c’est qu’ils sont de chez nous. On les a sous la main. Ils ont forcément plein de choses à nous apprendre, quand ce qu’ils font nous effare.
Faut savoir en profiter.
Par Sylvaine Jaoui et Aurélie Guillerey, aux éditions Casterman, 2003.
Emma est une pré-adolescente comme les autres. Mais, elle cache pourtant un secret trop lourd pour elle : Aliénor, sa petite soeur est autiste. Outre la peur du regard des autres, elle souffre de la préférence de sa mère pour Aliénor. Dépassée par sa jalousie, Emma s’enfuit de la maison…
Par Kochka, aux éditions T. Magnier, 2006.
Michka et sa cousine Louna ont le même âge mais ne se sont jamais vues.
Ce n’est pas la distance qui les sépare, mais la différence. Louna est autiste. Michka rêve de rencontrer sa cousine sans toutefois imaginer combien la rencontre peut être éprouvante. Quand enfin la famille se réunit pour les douze ans de Louna, l’anniversaire vire au cauchemar. Il faudra du temps à Michka pour accepter de refaire un bout de route avec Louna, tantôt si proche et tantôt si lointaine.
L’autisme est devenu un sujet d’intérêt majeur tant sur le plan scientifique que sur le plan médico-social. Devant la complexité de ses manifestations, les cliniciens sont confrontés à la difficulté du diagnostic des formes frontières et à la nécessaire prise en compte des pathologies associées. Toutes ces questions interpellent à la fois les chercheurs, les cliniciens, les professionnels de l’éducation et les familles, chacun contribuant ainsi à apporter de nouvelles pièces au puzzle.
Car l’Autisme recèle encore bien des mystères…





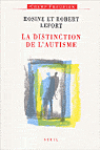


















Partager cet article