Moi, ce bourreau
Publié le 08/11/2006 à 00:00
-  8 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
8 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
Quelques jalons documentaires pour accompagner la lecture des « Bienveillantes » :
[actu] L’Allemagne, d’une guerre à l’autre : [actu]
La défaite de 1918, la fragilité du régime démocratique et la crise économique ne suffisent pas à rendre compte d’une catastrophe qui a marqué l’histoire du 20ème siècle.
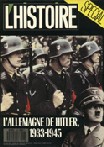
- Allemagne
- L’Histoire
L’Allemagne de Hitler 1933-1945, numéro spécial de la revue « L’Histoire » Comment Hitler a-t-il pris le pouvoir et séduit tout un peuple ? Quelles ont-été les transformations de la société allemande et les réalisations du 3ème Reich ?
Histoire d’un allemand : souvenirs, 1914-1933, par Sebastian HAFFNER, Actes Sud Récit par un témoin oculaire de ce qu’était la vie des allemands pendant l’instauration du nazisme. Ce témoignage écrit par l’auteur en 1938, alors exilé en Angleterre ne sera publié qu’en 2000.
Récit visionnaire s’il en est : « On voit bien qu’il est facile de remplacer « les Juifs » par les « Tchèques », les « Polonais ou n’importe quoi d’autre. Il s’agit d’inoculer systématiquement à un peuple entier – le peuple allemand – un bacille qui fait agir ceux qu’il infecte comme des loups à l’égard de leurs semblables ou qui, autrement dit, déchaîne et cultive ces instincts sadiques que plusieurs millénaires de civilisation se sont employés à éradiquer. J’aurai l’occasion de montrer dans un chapitre ultérieur que de grandes parties du peuple allemand – nonobstant sa veulerie et son indignité générales – sont encore capables de mobiliser des anticorps contre cette peste, sans doute poussées par l’obscure prescience de ce qui se joue. S’il en était autrement, si cette tentative des nazis – qui est au centre de tous les efforts – devait véritablement réussir, cela conduirait l’humanité à une crise de toute première importance qui remettrait en cause la survie de l’espèce humaine… »
[actu] La campagne de Russie : [actu]
Le 22 juin 1941, l’armée allemande s’est lancée à l’assaut de l’URSS pour une véritable guerre d’extermination (« ein Vernichtungskrieg ») : les bolcheviks, les juifs soviétiques , propagateurs du virus communiste, étaient directement visés par cette ambition expansionniste qui serait comme la « seconde révolution » du national-socialisme.
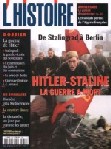
- Hitler/Staline
- L’Histoire
Hitler-Staline : la guerre à mort , numéro spécial de la revue « L’Histoire » Plan d’invasion, chronologie, Stalingrad ; comment et pourquoi les soviétiques ont-ils gagné la guerre ; la prise de Berlin : tous ces articles font le point de la question, sans oublier le témoignage de Vassili Grossman, qui a passé plusieurs mois dans Stalingrad assiégé et en a fait le récit dans son roman, Pour une juste cause.
La guerre à l’est : histoire d’un régiment allemand 1941-1944, par August von KAGENEK, Perrin Raconte l’histoire significative d’une unité : le 18e régiment d’infanterie-grenadiers, qui a combattu sur le front de l’Est d’un bout à l’autre de la guerre. Aussi suit-on celle-ci au plus près du quotidien de ces soldats.
[actu] Un passé qui ne passe pas : [actu]
Benoît XVI aux Jeunesses hitlériennes, Günter Grass soldat de la Wehrmacht, aujourd’hui les 250.000 exemplaires de Jonathan Littell, nos indignations et l’attrait d’un roman qui fait la part belle à l’horreur nous rappellent que si la tentation génocidaire reste toujours présente (Tchétchénie, Irak , Darfour…), c’est toujours dans l’ambivalence que nous la considérons.
Reflets du nazisme, par Saul FRIEDLANDER, Seuil Depuis la fin des années soixante, pour bon nombre de cinéastes et de romanciers européens, le nazisme n’est plus ce qu’il était. Saul Frieländer décèle à travers leurs œuvres – sans qu’il y ait volonté apologétique – le renouveau d’une certaine fascination dont le ressort, hier comme aujourd’hui, est un réseau d’émotions contradictoires. Il découvre aussi une impossibilité à affronter l’inacceptable, d’où un recours à l’exorcisme, à l’inversion des signes et des situations dont le dernier avatar est la négation même de l’holocauste.
L’exposition des fantasmes et le refoulement des faits, indissociablement liés, autorisent cette fascination qui dès lors peut tracer son chemin dans nos consciences.
La fascination du nazisme, par Peter REICHEL, O Jacob Comment le peuple allemand a-t-il pu à ce point idéaliser le Troisième Reich, pourtant fondé sur la violence, la destruction et l’horreur ?
Peter Reichel dévoile l’incomparable habileté avec laquelle les nazis ont créé un monde d’illusions qui leur a permis d’entraîner les Allemands au désastre. Il analyse l’esthétique nazie et ses racines culturelles.
La seconde histoire du nazisme dans l’Allemagne fédérale depuis 1945, par Alfred WAHL, Armand Colin Un ouvrage sans équivalent : « la seconde histoire du national-socialisme » selon Peter Reichel. L’après guerre n’a pas été seulement une période de reconstruction, elle a été aussi celle du traitement des séquelles du passé, de la dénazification, mais surtout de la continuité des élites, les cadres du régime nazi ayant contribué à l’édification de la RFA. D’où une double exigence de rupture et de permanence concernant les hommes et les institutions.
[actu] Voix de la fiction : [actu]
Selon la formule de Toni Morrison, Prix Nobel de Littérature 1993, les écrivains, parce qu’ils « donnent voix à la vérité humaine », seraient-ils « les historiens les plus fiables… » ?
Quel rôle la littérature et les écrivains peuvent-ils jouer dans l’exploration et la transmission des évènements historiques, en particulier dans un contexte de guerre et d’atrocités ? Au-delà du phénomène médiatique suscité par « Les Bienveillantes », plusieurs livres parus ces dernières années peuvent susciter la réflexion. En voici une sélection :
Un livre de fond :
À qui appartient une histoire ?, par Norbert GSTREIN, Laurence Teper Qui a le droit d’écrire sur quoi, et qui en décide ? Comment raconter aujourd’hui ? Comment fonder une éthique artistique au droit et au devoir d’écrire sur le passé et sur la guerre. Comment transmettre en travestissant le moins possible ? En réponse aux vives réactions suscitées en Allemagne et en Autriche par son roman « Le métier de tuer », N. Gstrein se livre ici à une réflexion sur les liens entre histoire, littérature et journalisme…
Entre « mission » et remords, trois romans parmi d’autres mettent en évidence le point de vue de quelques bourreaux de l’Histoire et démontent chacun à sa manière, les mécanismes de la destruction programmée :
Confession du bourreau, par Iouz ALECHKOVSKI, Stock Chibanov, le narrateur, membre du KGB, véritable machine à tuer surnommé « La Pogne », « confesse » au fonctionnaire soviétique Gourov, sa dernière victime (à qui il réserve les raffinements ultimes de la torture physique et morale), quels traumatismes de jeunesse ont façonné sa vocation… Mais n’existe-t-il jamais de lassitude chez un bourreau ?

- Murambi
- Ed. Stock
Murambi, le livre des ossements, par Boubacar Boris DIOP, Stock L’enjeu de ce livre, œuvre d’un romancier et journaliste sénégalais qui a sillonné le Rwanda pendant plusieurs mois, est de donner à voir (à comprendre ?) la folie meurtrière qui s’empara de ce pays entre avril et juillet 1994. Au-delà des destinées de deux amis d’enfance, la narration multiple donne la parole à divers acteurs du conflit : citoyens ordinaires, traqués et abattus comme du bétail, témoins impuissants, représentants de l’étranger, mais aussi tueurs de tous grades, aveuglés par la cruauté collective ou la volonté d’en finir (« Il s’agit de savoir ce qu’on veut », et passer outre les désagréments)… Au terme de la tragédie surgit cette inquiétante question : les génocides ne révèlent-ils pas à toute société humaine son essentielle fragilité ?

- Morts
- Ed. Fosse aux ours
Morts et remords, par Christophe MILESCHI, La Fosse aux Ours Au terme de sa vie, Vittorio Alberto Tordo, le narrateur, écrivain italien reconnu et célébré né à la fin du XIXe siècle, entreprend de rédiger sa confession-testament. Tenaillé par l’angoisse d’avoir laissé une oeuvre qui a passé sous silence ce qu’il considère comme l’essentiel, il évoque alors de front sa participation active et consciente à des engouements collectifs meurtriers (Guerre de 14-18, fascisme, guerres coloniales, lois raciales) et la culpabilité inextinguible qu’il en nourrit :
« Qui pardonne ? Qui délivre ? Qui fait que ce qui fut cesse d’avoir été ? »










Partager cet article