C'est pour lire !
Publié le 08/12/2007 à 00:00
-  17 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
17 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
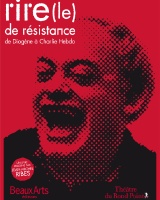
- Le rire de résistance
Le Rire de Résistance, de Diogène à Charlie Hebdo, Collectif, Beaux-Arts Ce livre a été imaginé par Jean-Michel Ribes pour donner écho à la saison théâtrale du Rond-Point consacrée au Rire de Résistance.
Cette saison, nous célébrerons à travers « le Rire de Résistance » tous ceux, fils et filles de Rabelais, Molière, Jarry, Dario Fo, Coluche, Picabia et autres dadaïstes, qui par le rire, la raillerie et l’insolence ont su résister à toutes les dictatures de la réalité et à l’hégémonie du sérieux. Ce sérieux qui solidifie les idées, que la morale fortifie et que le bon goût engraisse au point qu’il en finit par boucher la pensée.Extrait du site internet du Théâtre du Rond-Point
[actu]Histoire(s) de rire(s)[actu]
Histoire du rire et de la dérision, par Georges MINOIS, Fayard Du rire des dieux de l’Olympe à la société humoristique de consommation, une synthèse sur la place du rire dans la société et sur ses bons et mauvais usages. « Le rire fait partie des réponses fondamentales de l’homme confronté à sa situation existentielle. Retrouver les façons dont il a fait usage de cette réponse à travers l’histoire, tel est l’objet de ce livre. Prôner le rire ou le condamner, placer l’accent comique sur telle situation, sur telle caractéristique, tout cela révèle les mentalités d’une époque, d’un groupe, et suggère sa vision globale du monde.
2000 ans de rire : permanence et modernité, Actes de colloque organisé par l’association CORHUM :Recherches sur le Comique, le Rire et l’HUMour. Ensemble de contributions sur le concept d’humour et ses formes classés en quatre thèmes : culture et société, littérature d’hier et d’aujourd’hui, linguistique, actualité du rire. L’approche est tant sémiotique que culturelle ou sociologique, ce qui élargit le champ de la réflexion.
Site Internet de l’association CORHUM
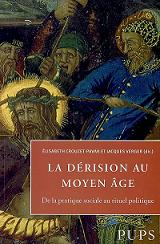
- La dérision au Moyen Age
Rire au Moyen âge, par Jean VERDON, Perrin Rires, plaisanteries, chahuts, divertissements font partie de la vie quotidienne, du petit enfant qui exprime sa gaieté aux vieillards qui se racontent d’amusantes histoires le soir à la veillée en passant par les adultes qui rient bien souvent pour se moquer. Et cela tout au long de l’année, avec des temps forts comme la fête des fous ou le carnaval, mais aussi lors des nombreuses occasions qui émaillent la vie familiale (mariage et charivari…) ou sociale (fêtes aristocratiques, entrées princières. Quant aux textes destinés à faire rire (fabliaux et nouvelles, théâtre profane comique), ils permettent de repérer la spécificité du rire médiéval.
La dérision au Moyen Age : de la pratique sociale au rituel politique, dirigé par Elisabeth CROUZET-PAVAN, Jacques VERGER, Presses de l’Université Paris-Sorbonne En trois parties, l’ouvrage cerne les pratiques de la dérision au Moyen Age et leurs enjeux sociaux. Que ce soit dans les pratiques politiques, dans les pratiques judiciaires, dans l’expression artistique voire dans une manière d’aborder la religion en glissant subtilement de la dérision à la compassion, l’art dérisoire est un art et un état d’esprit propre à l’univers médiéval.
Les éclats du rire : la culture des rieurs au XVIIIe siècle par Antoine DE BAECQUE, Calmann-Lévy Les Lumières sont un « âge du rire », car une culture spécifique s’est constituée autour du fait de rire, avec ses pratiques et ses représentations. Ce livre explore les manières de rire, ses valeurs, ses débats et polémiques à travers les destins croisés de groupes de rieurs qui ont donné consistance aux éclats de rire du siècle. Mais c’est aussi un essai politique : il tente de démontrer combien le rire (satire, farce, gaieté…) a compté dans les habitudes et les représentations politiques du pays, jusqu’à la Révolution, qui s’ouvre avec une véritable guerre du rire.
François Lebrun publiait dans la revue l’Histoire (n°251) un article intitulé : Je me presse de rire de tout… dans lequel il évoque quelques figures du rire au XVIIIe : Pasquin, Ramponneau, le Régiment de la calotte ou encore le marquis de Bièvre que l’on considère comme l’inventeur du calembour, enchaînement de mots ou de syllabes à effet comique. Protége de Louis XV, il est une figure célèbre du monde parisien : on peut lire ses textes moqueurs dans Calembours, et autres jeux sur les mots d’esprit, Payot
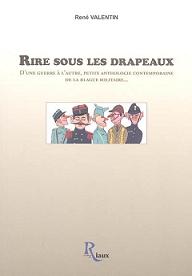
- Rire sous les drapeaux
Rire sous les drapeaux : d’une guerre à l’autre, petite anthologie contemporaine de la blague militaire par René VALENTIN, Ed, des Riaux L’auteur a réuni, en vue de les conserver, des blagues militaires qui se racontaient parmi les hommes lors du service militaire. Ce recueil forme, d’une guerre mondiale à l’autre, un témoignage social et historique d’une époque contemporaine maintenant révolue, et d’un langage voué à disparaître.
Prolétaires de tous les pays, excusez-moi : dérision et politique dans le monde soviétique par Amandine REGAMEY, Buchet & Chastel
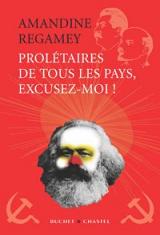
- Proletaires de tous les pays…
- Buchet & Chastel
Les histoires drôles et la dérision ont toujours été parmi les principaux recours des peuples confrontés au drame, à l’adversité, à l’oppression. De la révolution d’Octobre à l’effondrement du régime, le communisme a donné lieu, en URSS et dans les pays satellites, à une profusion d’anecdotes humoristiques dont beaucoup sont ravageuses. Elles couvrent les différents aspects de la vie, depuis la répression politique jusqu’au casse-tête de la vie quotidienne, sans oublier la sexualité ou l’idéologie dont les travers sont passés au crible. Et surtout, elles en disent long sur l’état d’esprit d’une société qui avait appris à pratiquer, comme un grand art, le double langage – parfois jusqu’à la schizophrénie. On découvrira, au fil des pages et des éclats de rire dont leur lecture sera émaillée, que si le ridicule n’a pas vaincu le communisme, il a largement contribué à sa défaite.
[actu]Qui rira verra[actu]
Si quelques affaires récentes donnent à penser que les croyants n’ont pas un grand sens de l’humour, il n’y a pas si loin du fou au saint, de la spiritualité au spirituel. Rire et humour peuvent être une voie d’accès au divin, ou plus largement, un chemin vers la sagesse, la connaissance.
Le rire dans la revue Etudes, 3/ 2003, tome 398.
. Un long article qui parcourt toutes les variétés et variations du rire, avec le rappel de la vocation politique du rire (« Car le rire est une arme non seulement contre la sottise, mais aussi contre la censure et le terrorisme intellectuel. C’est la voix des sans-voix, l’arme des désarmés. Toutes les victimes l’ont utilisée, de Socrate au soldat Chveik et… à Charlot. La dérision fait vaciller les puissants : mettre les rieurs de son côté, c’est remporter une victoire. »), mais aussi de son importance dans les religions :
« Comme le dit Vladimir Jankélevitch : « L’humour exige de l’homme qu’il se moque de lui-même, pour qu’à l’idole renversée, démasquée, exorcisée, ne fût pas immédiatement substituée une autre idole. »
C’est en cela que l’humour autodénigrant se rapproche de la spiritualité. « L’humour est un mélange d’humeur et d’humilité », écrivait François Varillon ; et les plus grands saints – François d’Assise, Thérèse d’Avila, Thomas More, Philippe Neri, François de Sales – pratiquaient cette forme d’humour qui dégonfle l’ego. En tant que démystificateur de nos prétentions et de nos illusions, l’humour religieux est un moyen d’éviter à l’homme de se prendre trop au sérieux.
L’humour tient une grande place dans le judaïsme – du rire de Sara aux jeux de mots du Talmud -, et l’on a pu parler du rôle pédagogique de l’humour juif, voire de « l’enseignement par l’humour ». Souvent proche des larmes, l’humour juif n’est pas seulement un mécanisme de défense, il a aussi une valeur thérapeutique. On se moque de la misère, de la faim, de la persécution pour conjurer sa peur. Le soufisme également, école spirituelle et mystique de l’islam, possède une dimension humoristique. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel humour. Le rire à travers lequel le soufi rejoint Dieu n’est pas un éclat de rire, encore moins un fou rire, plutôt un sourire. Comme le dit le soufi Hujwiri : « Le rire suprême ne rit point./Terrible est son regard./Abyssal, Son amour. »

Le rire au pied de la Croix : de la Bible à Rabelais, par Michael Andrew Screech, Ed. Bayard « Aujourd’hui, en son âge troisième, devenu prêtre anglican, M. A. Screech relit ses auteurs préférés dont il est un spécialiste reconnu. Ainsi Rabelais, Montaigne et Erasme notamment, sur ce fond d’Humanisme et de Renaissance auquel ils appartiennent et qui est l’univers familier de leur critique en littérature comparée, revivent-ils au fil des pages à partir d’un thème, inattendu peut-être mais important, le rire – un rire chrétien, parce que référé certes à cette « littérature » qu’est la Bible, mais surtout à la figure même du Christ qu’il ne s’agit à aucun moment d’édulcorer, surtout en ce qui constitue son mystère central, la Croix. Cela nous vaut un livre brillant, on a envie de dire époustouflant, tant est grande l’érudition de l’auteur, tant est fine son intelligence, et inépuisable son enthousiasme qui le fait passer de l’Antiquité en ses classiques (Platon, Lucrèce…) comme en ses esprits curieux, voire bizarres, aux heures de la Renaissance, de ses joies, de ses fêtes et paillardises, sans se départir du sérieux et de l’humour tout ensemble que, de ce côté-ci du Channel, on attend d’un brillant esprit de l’autre côté. » Pierre Gibert (Etudes, n°6, 2003)
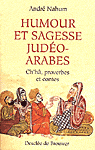
Humour et sagesse judéo-arabes, par André Nahoum, Ed. Desclée de Brouwer Anthologie d’histoires, d’expressions et de proverbes utilisés par les juifs de Tunisie, avec de nombreuses occurrences du personnage nommé en Tunisie Jeha ou Ch’ha, tantôt stupide, tantôt rusé, figure d’une sagesse populaire décillante.
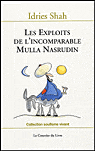
Les exploits de l’incomparable Mulla Nasrudin, par Idris Shah, Ed. Le courrier du livre « Le corpus des histoires de Mulla Nasrudin est un des trésors de la tradition orale. Contées depuis des siècles du Maroc à la Chine, de l’Asie centrale au Proche-Orient, elles gardent tout leur pouvoir et continuent de faire rire et de faire voir. Personnage légendaire, Nasrudin transcende les cultures et les époques. Tour à tour idiot et sage, retors et ingénu, il est le miroir de l’humain. »
Quelques extraits de ce livre et d’autres aventures de Nasrudin sur le site Etudes soufies

Sagesses et malices de la Chine ancienne, par Lisa Bresner, Ed. Le courrier du livre Petit recueil d’histoires courtes et enjouées. Ces contes traditionnels, sous forme d’anecdotes, illustrent un humour proche de la sagesse :
« Le nouveau pantalon :
Huan Chong détestait porter des vêtements neufs. Alors qu’il terminait de prendre son bain, sa femme lui fit apporter un nouveau pantalon. Huang Chong se mit en colère et le renvoya. Mais sa femme le lui fit immédiatement rapporter avec ce message :
Si les vêtements ne sont pas neufs un jour, comment pourront-ils devenir vieux ?
Huan Chong rit et s’habilla. »
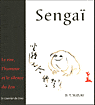
Sengaï : le rire, l’humour et le silence du zen, par Daisetz Teitaro Suzuki, Ed. Le courrier du livre Des dessins de figures légendaires, historiques, de poètes et de citadins saisis dans la vie quotidienne, réalisés à l’encre de Chine par le moine zen et peintre Sengaï (1750-1837), accompagnés de textes qui invitent à un parcours informel de l’univers du bouddhisme et du bouddhisme zen. Un humour parfois pour nous déroutant, proche du burlesque ou du grotesque, avec des grenouilles au sourire humain en guise de Bouddha et des humains semblant parfois pourvus d’un groin. Le zen se moque de lui-même et c’est là son enseignement.
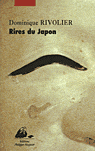
Rires du Japon, par Dominique Rivolier, Ed. Philippe Picquier Toutes les facettes et fossettes du rire au Japon, légende de la déesse Amaterasu, raguko (railleries paillardes), senryu (haiku satirique), personnages grotesques de la peinture, dessin d’humour, zen encore, dans une tentative passionnante d’expliciter le « rire jaune » : « Rire pour un japonais, c’est vivre l’éphémère au présent, comprendre l’incompréhensible, se protéger de l’étranger, trouver l’unité en soi-même et l’harmonie. Peut-être. »

Le rire des grecs : anthropologie du rire en Grèce ancienne, sous la direction de Marie-Laurence Desclos, Ed. Jérôme Millon Un sommaire très riche pour cet ouvrage qui explore bien sûr le rire des grecs mais aussi celui des dieux, de Zarathustra, le rire des masques africains ou le rire ouvrier. En filigrane, la profonde ambiguïté du rire, éminemment social et facteur de cohésion et profondément subversif et quasi anarchiste.
[actu]Lira bien qui lira le dernier[actu]
« Wittgenstein dit un jour à Keynes : « J’aurais aimé écrire une œuvre philosophique exclusivement composée de blagues. »
Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? demande Keynes.
Malheureusement, je n’ai pas le sens de l’humour, rétorque Wittgenstein. »
Luc de Brabandere rapporte ce propos du philosophe et justifie ainsi la rareté des propositions philosophiques sur le rire. A part le livre, pas très drôle, de Bergson, le philosophe ignore le rire. « Ceux qui cherchent des causes métaphysiques au rire ne sont pas gais » disait Voltaire.
Le sérieux de la philosophie, recul critique, doute méthodique, s’accommode mal de l’impertinence rieuse, même si, constatation d’Aristote, reprise par Rabelais, « le rire est le propre de l’homme ». Saluons donc ce petit opuscule, émaillé d’histoires amusantes, qui nous introduit à une logique parallèle. Autre citation : « la puissance du rire est dans le rieur, nullement dans l’objet du rire » (Baudelaire). Comme dirait Toto : « – c’est loin la fin du Point d’actu ? » « – tais-toi et lis ». Alors, un réflexe, le rire ? « Le rire naît d’un hiatus, rupture du temps social sérieux et quotidien » (Eric Blondel).
Humoristerie philosophique :

La métaphysique du mou, par Jean-Baptiste BOTUL, Ed. Mille et une nuits « En 1938, considérant que la philosophie des ” choses mêmes ” ne s’est pas assez intéressée aux choses molles, Botul crée et explore le concept de mouïté. Il en tire des idées étonnantes, qui bouleversent la phénoménologie ambiante, sur l’Etre, le néant, la charcuterie, le fromage, les seins des femmes, le transport des valises et les années trente. »
Les Archives botuliennes contiennent une mine d’informations sur l’énigmatique auteur qui, selon la légende, « est un philosophe de tradition orale dont on ne connaît ni la vie ni l’œuvre ».

L’idiot de la Sorbonne, par Frédéric PAGES, Ed. Maren Sell Etudiant raté en philosophie, Max de Kool est chauffeur de taxi place du Panthéon. Au volant de sa DS noire, il attend le client. Ce sera Oscar von Balthazar, son ancien professeur qui cherche un taxi pour mener l’assaut final contre la Sorbonne et cette France inerte qui a perdu le goût de l’éloquence, du concept et de la suspension hydropneumatique. Voici nos deux héros embarqués à travers l’Europe, en quête de sublime et d’une pompe haute pression à sept pistons. En chemin, ils résoudront plusieurs questions ardues, telles que le mystère de l’Immaculée Conception et l’importance du placenta pour penser.

Eclats de rire philosophiques, par Lucien GUIRLINGER, Bernard LACORRE, Didier CAILLETEAU, Marie HUMEAU, Ed. Cécile Defaut « Le commun imagine mal que les philosophes, gens austères et graves, puissent s’abandonner au rire, ou même qu’ils daignent s’interroger sur la signification et la désirabilité de ce comportement frivole. Rire est-il pour l’homme un privilège ou une tare ? Si les dieux d’Homère s’esclaffent dans l’Olympe, Jésus lui n’aurait jamais ri. Repoussant les réserves de Descartes, Spinoza a pris résolument le parti du rire. Et si Nietzsche nous demande de rire à la vie, c’est par contre au nom de la vie que Bergson intente un procès au rire. Tout se passe comme si ces appréciations contradictoires du rire, loin d’être d’une importance secondaire, traçaient une nette ligne de partage entre les philosophes, révélant peut-être des divergences décisives entre leurs options fondamentales. »

Du rire. Comique, esprit, humour, par Claude SCHNERB, Ed. Imago « Retenu, saccacé ou explosif, le rire, par son expression primitive, nous affranchit des contraintes de l’ordre et nous amène, en un éclair saisissant le corps et l’âme, à la révélation quasi métaphysique d’une liberté absolue… »










Partager cet article