Vae victis!
Malheur aux vaincus !
Mots que Brennus, chef de Gaulois, aurait adressés aux Romains lors de la prise de Rome en 390 av. J.-C.
Publié le 02/06/2017 à 10:43
-  11 min -
Modifié le 11/10/2019
par
Département Civilisation
11 min -
Modifié le 11/10/2019
par
Département Civilisation
« Les vainqueurs sont ceux qui écrivent l’Histoire », a-t-on souvent affirmé. Mais qu’en est-il des vaincus ? La défaite est-elle vraiment sans histoires ? Longtemps seuls les historiens du fait militaire ont tenté de comprendre la défaite. Elle sort désormais des champs de bataille pour devenir un lieu d’expériences et de mémoires. La défaite prend aujourd’hui sa revanche.* Un certain nombre d’historien.ne.s se sont penchés sur la question. A partir de quelques extraits de leurs travaux, petit panorama sur la défaite et ses acteurs.
Les règles du jeu
La question de l’humanisation des conflits par la mise en place de règles se posa rapidement. Elle fut reconnue par tous et entérinée par des traités ou des conventions. Contre toute logique, les hommes imaginèrent qu’il était possible de tuer leurs adversaires selon des règles, et que l’on pouvait combattre et tuer, mais pas n’importe comment. Aussi, les hommes ont-ils vite convenu que la guerre devait être déclarée dans des formes compréhensibles à tous afin que celui qui était attaqué puisse se mettre en situation de défense. Cette pratique paraît absurde à celui qui veut d’emblée user de la violence et qui pense que surprendre un adversaire non préparé est un avantage précieux, mais elle se comprend après une période de négociations, après un ultimatum et dans le cadre assez fermé de communautés semblables qui, pouvant être alternativement assaillantes et assaillies, y trouvaient leur avantage. Les Grecs avant le début des hostilités envoyaient un héraut déclarer la guerre aux adversaires et Édouard IV envoya son héraut défier le roi de France. Déterrer la hache de guerre est devenu synonyme de déclaration de guerre et les Indiens d’Amérique avaient des coutumes bien établies pour commencer et terminer les guerres.
Cette tradition se perpétue, à travers les siècles, pour aboutir à la troisième Convention de La Haye qui exige qu’une déclaration soit faite et qu’un ultimatum soit accompagné de délais afin de chercher par d’ultimes négociations une solution à la crise. Force est d’admettre que cette vision légaliste, juridique, se heurte par la force des choses à la réalité de guerres qui n’entrent pas toutes, loin s’en faut, dans ces cadres formels. La plupart des déferlements Barbares se firent sans préalables et les guerres de libération, les guerres révolutionnaires, sont par nature étrangères à des règles de la sorte. Les États aussi commettent des agressions par surprise et certains peuples guerriers, de l’Antiquité à nos jours, n’eurent pas de tels scrupules dans la mesure où leur façon de vivre était de faire la guerre. Le mythe du bon sauvage, de la non-violence des sociétés primitives, a fait imaginer des périodes (ou des peuples) pacifiques ou pratiquant des guerres sans grandes tueries. À titre d’exemple, l’on cite les Aborigènes d’Australie aux guerres et paix codifiées, les « guerres sacrées» et les « guerres courtoises» des sociétés féodales. (cf. “Faire la guerre : la guerre dans le monde, de la préhistoire à nos jours” de Claude Nières)
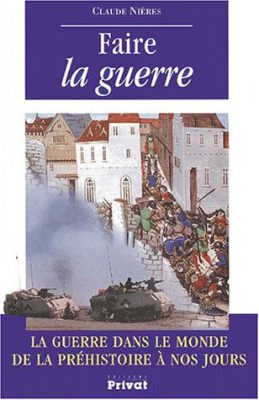
Perdu !
La défaite a beaucoup à nous dire. Elle semble moins être un échec qui a bien eu lieu qu’une victoire qui s’est dérobée. Elle laisse une large part à la surprise et à l’imprévu. Même annoncée par des avertissements, en général peu entendus parce que suspectés, les réalités de la défaite ne prennent que rarement les formes envisagées avant son irruption. Pour l’immense majorité des contemporains de l’événement, la réception de la défaite se construit dans la stupeur, la violence et le désarroi des ruptures.
La conscience de la défaite et les usages des situations de défaite entraînent toutes sortes de réactions collectives. Des tendances lourdes peuvent être dégagées, grossièrement. À un bout de la corde se place le camp du refus et de la résistance, de ceux qui se raidissent contre la soumission ou se révoltent ; à l’autre bout, ceux qui, au contraire, rallient le camp du vainqueur, exultent ou se réjouissent d’obtenir ce qu’ils souhaitaient en secret. Entre les deux, tout un spectre d’attitudes qui entrent dans le vaste champ des stratégies d’arrangement, d’adaptation à la défaite, et des différents niveaux des modes de consentement. (cf. “Penser la défaite” sous la dir. de Patrick Cabanel et Pierre Laborie)
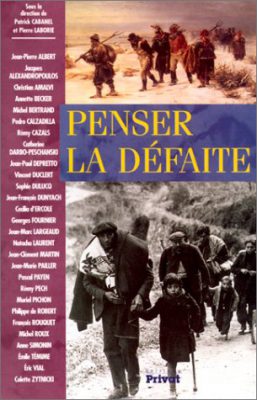
De l’avantage d’être vaincus ?
Du côté des vainqueurs, l’historien est facilement enclin à interpréter un succès remporté à court terme par une finalité de longue durée.
Il en va autrement des vaincus. Leur expérience consiste tout d’abord en ceci que tout est arrivé autrement qu’ils ne l’avaient prévu ou espéré. Pour peu qu’ils se mettent à réfléchir méthodiquement, ils sont confrontés à une indigence de preuves encore plus grande lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi une chose est arrivée autrement qu’on ne l’avait prévu. Ce qui peut les conduire à rechercher les causes à long et à moyen terme qui pourraient inclure et peut-être expliquer le hasard de leur surprise singulière. Elle ne manque donc pas d’intérêt l’hypothèse selon laquelle des jugements pourraient précisément naître des gains d’expérience singuliers imposés aux vaincus. A court terme, il se peut que l’histoire soit faite par les vainqueurs mais, à long terme, les gains historiques de connaissance proviennent des vaincus. Naturellement, l’hypothèse selon laquelle les jugements sur l’histoire provenant des vaincus seraient d’une plus grande pertinence ne nous autorise pas pour autant à en tirer la conclusion inverse qui consisterait à dire que toute histoire écrite par les vaincus est plus fructueuse. (cf. “L’expérience de l’histoire” de Reinhart Kosellecke)
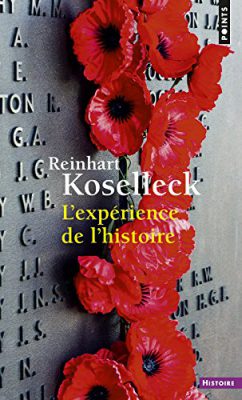
Mais aussi des inconvénients…
Les peuples qui vivaient de la guerre n’usaient d’aucune précaution envers leurs adversaires, préféraient envahir leurs terres sans préavis, ne faisaient pas de quartier sauf s’ils y trouvaient avantage en gardant des femmes, en faisant payer des rançons ou en vendant les prisonniers valides comme esclaves. Maintenir les populations en vie pour leur faire payer un tribut et pouvoir recommencer régulièrement est une attitude que l’on trouve dès l’Antiquité, en Égypte et dans les cités grecques, macédoniennes. Mais, la guerre menée par les plus courtois des hommes, les plus téméraires, les plus avides d’exploits, n’est pas ludique et ne l’a jamais été, elle est toujours faite de sang, de morts, de blessés.
Pendant des millénaires, le traitement des ennemis au sens large, des combattants en particulier, fut à la discrétion des belligérants et in fine du vainqueur. Il fallut des siècles pour que les hommes se préoccupent du sort des combattants et des vaincus. Ils le firent pour des raisons morales et utilitaires.
Nous n’avons ni le témoignage ni la trace du moment où les hommes cherchèrent à limiter les effets dévastateurs des guerres. Nous savons néanmoins que le problème se posa parmi les Grecs puisque nous le trouvons dans les comédies d’Aristophane.
Selon les époques, les sociétés, les antagonistes et le type de guerre, l’attitude des combattants les uns envers les autres diffère. Certains peuples traitaient les combattants adverses avec une grande cruauté, d’autres considéraient qu’une opération militaire avait pour but la victoire et non l’humiliation ou l’annihilation de l’adversaire. Ce n’est qu’au cours du XVIIIe siècle qu’un traitement plus humain fut envisagé pour aboutir dans la seconde moitié du XIXe siècle à la création d’organismes et à la recherche de conventions. D’abord des blessés avec la création de la Croix Rouge par Henri Dunan en 1863, pour aboutir à la décision de la 4e Convention de la Haye 1907 qui interdisait de tuer les prisonniers de guerre et à l’ article 2 de la Convention de Genève de 1929 qui réglait aussi les conditions de leur détention.
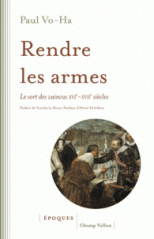
Les vaincus dans tous leurs états
Les combattants, les troupes régulières et non régulières, sont rarement traités de la même façon. Pendant les derniers siècles on prit de plus en plus l’habitude de distinguer les combattants en uniforme des autres. Les premiers considérés avec plus de considération que les seconds souvent assimilés à des espions, voire à des bandits, des terroristes auxquels il serait inutile sinon dangereux d’appliquer les lois de la guerre. Or le développement de formes de guerre nouvelles, ou plutôt leur élargissement, oblige à considérer autrement les résistants, les guérilleros et à leur appliquer les usages, et les conventions en usage pour les troupes conventionnelles. Il n’en demeure pas moins que l’assimilation du combattant de l’ombre et le résistant au terroriste fut encore le cas au cours de la Seconde Guerre mondiale mais aussi par la suite. Les résistants à I ‘occupation allemande furent pour la plupart, quand ils étaient pris, torturés, déportés ou fusillés. La Convention de Genève du 12 août 1949, décida que les membres des troupes irrégulières bénéficieraient du statut des prisonniers de guerre. Mais cette reconnaissance fut assortie de conditions: avoir un responsable, porter un signe tel un brassard les identifiant, porter ses armes ouvertement, respecter des lois de la guerre et en particulier de la . Or comment dans le cas de guerre anticolonialiste, pour l’indépendance, voire dans le cadre d’une guerre révolutionnaire se désigner ainsi à la répression…
Le sort des non-belligérants dépendait aussi des objectifs des belligérants, surtout des envahisseurs, il en était de même des résidents ennemis en territoire adverse. Dans l’Antiquité, s’ils n’étaient pas massacrés, ils pouvaient fournir des esclaves. Au Moyen Âge, leurs biens étaient confisqués et ils étaient emprisonnés. Seuls les intérêts économiques conduisirent à épargner les marchands si la réciprocité existait. En ce qui concerne les civils, l’attitude des gouvernants et des belligérants varia pendant des siècles au gré des adversaires. Massacres mis à part, la situation des civils ne s’améliora que très lentement et leur situation pendant la Seconde Guerre mondiale fut, surtout en Pologne et en URSS, mais pas seulement, fort pénible. Non seulement, ils subirent privations matérielles, politiques et morales, mais ils purent être détenus comme otages, fusillés, pendus, massacrés, comme à Châteaubriant, Oradour, Tulle, Lidice, Asq. Ils furent, comme en France, forcés au travail. L’évolution des guerres modernes fait que les civils en sont de plus en plus les victimes. Il fallut attendre 1949, pour qu’un accord multilatéral de protection des civils fût signé. À l’heure actuelle, selon le secrétaire général adjoint des Nations unies, nous assistons à des « guerres à l’envers», soldats contre civils aux pertes considérables. La prise d’otages, le détournement d’avion, l’attentat aveugle, sont devenus des moyens de pression très employés : quelquefois par des États contre d’autres États, mais surtout par des groupes révolutionnaires, des guérilleros. (cf. “Faire la guerre : la guerre dans le monde, de la préhistoire à nos jours” de Claude Nières)
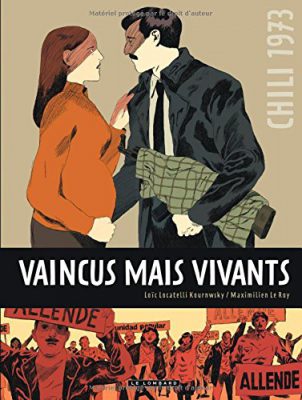
Fin / capitulation / déroute de la défaite
La défaite est progressivement repoussée hors du champ du militaire: on le trouve dans les quotidiens sportifs les lendemains de match, dans les médias d’information au soir des élections. L’expression « être défaitiste» s’est elle-même affadie. La défaite qui emportait tout sur son passage se fait plus discrète. Comment expliquer ce nouveau statut, cet apaisement relatif? Est-il le fruit d’une perte d’enjeu?
On peut chercher une première clé d’explication dans les modalités de la guerre et surtout dans sa sortie. Avec l’utilisation de l’aviation et l’élaboration de théories militaires limitant au maximum l’emploi des troupes au sol, la guerre change de forme. Elle perd aussi de sa matérialité. On peut sans doute parler de défaite américaine au Vietnam. Le fait-on? La sortie de guerre devient également plus confuse: la défaite ne renvoie plus à la débâcle, à la catastrophe. L’ambiguïté des sorties de guerre devient la norme. Parle-t-on des défaites dans le conflit yougoslave? Il n’y a pas en réalité de véritable déclaration de guerre. La fin de la guerre est floue. Il s’agit le plus souvent de ne plus humilier les peuples vaincus, de refuser la responsabilité collective. Le discours s’ingénie à distinguer les criminels que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie doit juger, et les peuples qui, eux, ne sont pas mis au ban de la société européenne.

Quand les vaincus sont supplantés par les victimes
Les défaites sont désormais plus morales que militaires. Les causes et enjeux de la bataille s’effacent. Les discours sur la défaite deviennent alors moins virulents voire disparaissent. Ne reste alors que la compassion. Ce sont tout d’abord les civils “sans défense ou pourvus de moyens de défense sans commune mesure avec les armes des agresseurs ” qui occupent l’espace public, notamment dans le droit international. Pour autant, on assiste également à la victimisation des protagonistes de conflits militaires. On évoque les « désastres de la guerre ». Dans cette logique, les buts de guerre s’estompent. Bien des écoliers français seraient en peine d’exposer aujourd’hui les buts de guerre de 1914. Le poilu de Verdun n’est plus un vainqueur, mais davantage un pauvre hère pataugeant dans la boue, plongé dans un enfer qui a perdu son sens. Comme si le temps faisait disparaître le sens des combats. Il y a bien là une défaite des vaincus, comme ailleurs, une défaite des vainqueurs.
Aussi bien sur le champ de bataille que dans la rue, les vaincus ont pourtant eu leur heure de gloire. Le mouvement ouvrier a chanté les siens. Il s’est même construit sur ses défaites. Les vaincus de la Commune de Paris, les canuts ou ceux de 1905 en Russie ont été autant de vecteurs de mobilisation dans les nouveaux combats du mouvement ouvrier. Leur mort a servi de justification ou de mots d’ordre à la poursuite de la lutte. Ce rôle aujourd’hui passe au second plan. Les vaincus ne parlent plus, ne se défendent plus, ne construisent plus l’espoir sur les défaites passées. Il n’y a plus que des victimes de la barbarie.
La lecture américaine de la défaite au Vietnam est symptomatique. Le Vietnam est presque une guerre sans bataille qui se termine dans l’évacuation d’une ambassade. Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino, l’un des premiers films à dire cette défaite en 1978, se recentre sur l’individu, sur ses faiblesses, ses cassures. Ce sont ces prolétaires de Pennsylvanie, victimes malgré eux de la guerre, qui en écrivent l’histoire. Où est donc la défaite?
Il s’agit d’insister sur les souffrances des combattants, d’aller de l’idéal à l’individu, de faire de cet individu le symbole de l’injustice et de la violence de la guerre, au risque de perdre le sens de l’ événement en cours ou passé pour ne garder que sa perception individuelle. Enzo Traverso le note fort justement:
Tout se passe comme si le souvenir des victimes ne pouvait pas coexister avec celui de leurs combats, de leurs conquêtes et de leurs défaites.
Il ne s’agit plus en effet de minorer l’échec, voire de le transformer en victoire. Le discours contemporain se complaît dans la victimisation de la défaite, « continuité-éternité rassurante ». La victime est par définition vaincue, quel que soit le camp auquel elle appartenait.
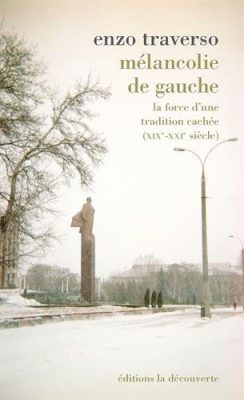
A lire une appréciation sur cet ouvrage: Mélancolie de gauche.
Le régime mémoriel victimaire
Le temps des défaites n’a donc peut-être eu qu’un temps. Restent des événements, une mémoire recentrée autour des victimes. Regardons du côté des interventions de l’ONU; des commémorations inter et transnationales. Depuis 1945, ce qui reste des défaites dans nos sociétés contemporaines sous divers motifs interprétatifs, sont donc des histoires de victimisation : victimes de la trahison des autres (les fautes originelles de Trianon et de Munich, l’abandon de l’Italie par ses alliés lors de la signature des traités de la banlieue parisienne de l’après-Première Guerre mondiale, etc.), victimes d’un plus fort: le mythe de David contre Goliath (Finlande, Austerlitz, Alésia), victimes d’une injustice de l’histoire, celle de la défense d’une identité européenne: une identité chrétienne refusée aux Serbes face aux Turco-Ottomans, une identité démocratique refusée aux Tchèques ou aux Hongrois à Trianon et Munich.
Pour autant, est-on encore pleinement dans le « régime mémoriel victimaire» dominant il y a encore une dizaine d’années? On assiste à un certain regain d’intérêt pour les bourreaux comme en témoignent les combats de la justice internationale, les nouveaux procès, notamment contre les derniers nazis en Allemagne …
La défaite n’est désormais plus une histoire diplomatique ou militaire. Elle est fondamentalement une histoire humaine. (cf. “Vaincus ! : histoires de défaites : Europe, XIXe-XXe siècles” sous la direction de Corinne Defrance, Catherine Horel et François-Xavier Nérard)
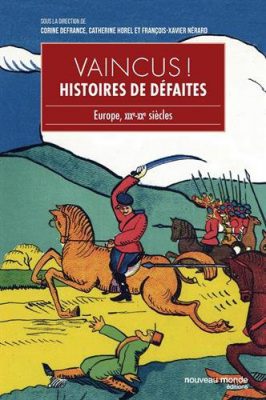
*(cf. labex-ehne.fr)
Sur Internet
- La mémoire des vaincus entretien avec Enzo Traverso
- « Le regard des vaincus est toujours critique » (Enzo Traverso, “Mélancolie de gauche”)
- Mémoire des vaincus, Mémoire des vainqueurs dans le bassin méditerranéen (de l’Antiquité au XXIe siècle)
- Vainqueurs et vaincus en Europe : Des constructions historiques










Partager cet article