Le cinéma expressionniste allemand
Publié le 07/12/2006 à 00:00
-  16 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
16 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
[actu]Quelques préliminaires[actu]
« Le cinéma expressionniste n’est qu’une forme d’un mouvement esthétique plus vaste qui, de 1907 à 1926, a concerné plusieurs arts. Situé à l’opposé absolu du naturalisme et des esthétiques de la vraisemblance, l’expressionnisme est intimement lié à la 1ère Guerre Mondiale, qu’il l’ait annoncée ou qu’il ait (ce fut le cas du cinéma) reflété le désarroi de l’Allemagne de la République de Weimar. Si le nombre de films purement expressionnistes est limité, l’expressionnisme a profondément métissé le cinéma ultérieur aussi bien allemand qu’américain et même soviétique et français. »
Barthélémy AMENGUAL, in : Les grandes écoles esthétiques, Cinémaction, n°55, avril 1990.
Toujours selon Amengual, les grands thèmes de l’expressionnisme sont : la ville ; l’automate et le pantin ; le cercle, l’angle et la spirale ; le double, le reflet et l’ombre ; la révolte morale contre le bourgeois ; le thaumaturge (magicien ou sorcier de la science, dictateur en puissance, tyran et/ou criminel).
Autre définition, dans l’article expressionnisme du
Dictionnaire théorique et critique du cinéma, de Jacques AUMONT et Michel MARIE, Armand Colin :
« Le courant expressionniste […] doit sans doute son importance dans les histoires du cinéma au choc que provoqua Le Cabinet du Docteur Caligari de Robert Wiene, dans lequel trois peintres cherchèrent consciemment à créer des décors expressionnistes. Les diverses définitions que l’on a données de l’expressionnisme cinématographique […], sont généralement assez arbitraires, mais reviennent toutes sur quelques éléments : le traitement de l’image comme « gravure » (fort contraste noir et blanc) ; les décors très graphiques, où prédominent les obliques ; le jeu « de biais » des acteurs…
Malgré l’imprécision de sa définition, le cinéma expressionniste est toujours apparu comme cultivant des images fortes, violentes, expressives. »
[actu]Sites internet[actu]
Une exposition en ligne faite par la BIFI (Bibliothèque du film) Très riche, complète, avec des filmographies, des bibliographies, une foule de références éclairantes, une navigation agréable.
Le dossier de la Cinémathèque française Où il est dit : « Le cinéma expressionniste est extrêmement protéiforme et trouve des prolongements aujourd’hui dans les productions les plus récentes. C’est ce qui fait son profond intérêt. »
[actu]Livres[actu]
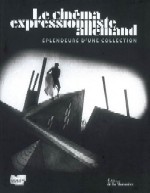
- Cinéma expressionniste allemand
- (La Martinière)
Le cinéma expressionniste allemand : splendeurs d’une collection, éd. de la Martinière Catalogue de l’exposition présentée à la Cinémathèque française. Outre une partie consacrée au mouvement, à ses définitions, ses historiens et ses acteurs, une collection de dessins préparatoires aux décors et costumes des films est présentée, qui est passionnante.
De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, de Siegfried KRACAUER, L’Age d’homme, 1973 (1ère édition 1947) Critique et essayiste, figure en exil de la République de Weimar, Siegfried Kracauer écrit la première histoire du cinéma expressionniste.« Kracauer voit dans la thématique des films les plus saillants de cette époque une « procession de tyrans » qui manifeste une terreur-désir de la dictature et prépare sur le plan psychologique le terrain au nazisme. » Bernard Eisenschitz, in : Le cinéma allemand, Nathan.
Ce livre, tout comme L’Ecran démoniaque, a eu un impact profond sur l’image que l’on s’est fait de ce cinéma.
L’écran démoniaque de Lotte EISNER, Losfeld, 1981 (1ère édition 1952) Pour Lotte Eisner, autre exilée, les films expressionnistes sont aussi sont un reflet de l’âme allemande et de l’époque qui les voit naître. Mais elle les analyse très précisément du point de vue du style, les rattachant aux autres courants de l’art et de la pensée allemande, dans la poésie, la peinture, la littérature, citant Goethe, Hölderlin, Novalis… C’est elle qui a élargi la notion de cinéma expressionniste. Des chapitres complets sont consacrés à Fritz Lang, à Murnau, à Pabst.
[actu]Films[actu]
Malheureusement, quelques films importants ne sont pas édités en DVD, comme Le cabinet des figures de cire de Robert Wiene, De l’aube à minuit de Karl-Heinz Martin, ou bien encore Les trois lumières de Fritz Lang. Mais l’édition est tout de même asez riche.
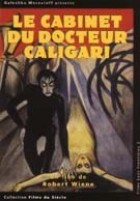
- Le cabinet du Dr Caligari
- (Films sans frontières)
Le cabinet du Docteur Caligari, de Richard WIENE, 1919 Le film manifeste du mouvement.
Les décors y jouent un grand rôle, ils ont été réalisés par des artistes du mouvement expressionniste côté peinture.
Perspectives tordues, rues en zig-zag… tout est artificiel dans ce film, et créé pour exprimer le cauchemar et la folie, la prémonition mortelle. Les éclairages très contrastés et la présence de l’acteur Conrad Veidt en somnambule ne jouent pas un rôle mineur dans l’impression étrange et dérangeante que laisse le film.
Voir la fiche du film élaborée par le Cinéma Le France (Saint Etienne).
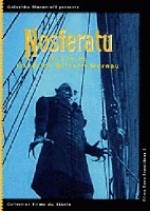
- Nosferatu
- (Films sans frontières)
Nosferatu, de Friedrich Wilhelm MURNAU, 1922 Le titre original est « Une symphonie de l’horreur »… tout un programme.
Ce film est devenu emblématique à la fois de l’expressionnisme et du fantastique. Max Schrek y incarne un vampire qui marquera l’histoire du cinéma, et les décors naturels, loin de rendre plus banal le propos, accentuent au contraire l’inquiétude et la frayeur.
« Nosferatu se distingue des autres films de vampire en ne présentant non plus une créature bourgeoise malicieuse dans la tradition judéo-chrétienne, mais bien un être torturé, pris entre son état d’agresseur et de victime des hommes. Il est le simulacre humain expressionniste, condamné à la solitude et vivant dans un manoir en ruine. Victime de son désir inassouvissable, il est enfermé dans un corps rongé et pourri en phase de réification, évoluant dans le monde des objets. » Emile Baron, in : article de Cadrage.net sur le film L’ombre du vampire. Voir aussi, sur ce même site, l’article sur Nosferatu proprement dit.
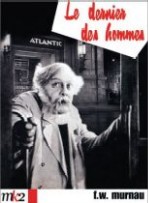
- Le dernier des hommes
- (MK2)
Le dernier des hommes, de Friedrich Wilhelm MURNAU, 1924, avec Emil Jannings. Un portier de grand hôtel, jugé trop vieux, est relégué à l’entretien des toilettes du sous-sol. « Il y a dans Le dernier des hommes, un des très rares films muets à être dépourvus de tout intertitre, la plus formidable concentration d’énergie, de talent et de procédés stylistiques divers mis en œuvre pour exprimer par le dehors des hommes et des choses, le dedans de l’homme et de la réalité. Les attitudes infiniment variées de Jannings qui pousse à leur paroxysme la plasticité et le don de métamorphose des grands acteurs expressionnistes, l’utilisation de tous les types de cadrages et d’une gamme illimitée de mouvements d’appareils, le recours aux plans subjectifs et oniriques, la prolifération des effets de montage (parallélisme, métaphore, etc….), la magie abstraite et pourtant terriblement précise des décors, l’importance dramatique et symbolique accordée aux objets servent un thème de caractère intime et universel ; la déchéance d’un homme vue tout à la fois de l’extérieur et de l’intérieur de lui-même. » in : Dictionnaire du cinéma : les films, de Jacques Lourcelles, éd. Laffont.
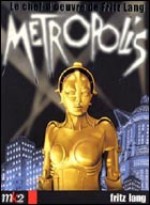
- Metropolis
- (MK2)
Metropolis, de Fritz LANG, 1927 En 2026, dans une ville du futur, deux classes bien distinctes : une aristocratie, et des ouvriers déshumanisés, au tâches mécaniques. Une femme-robot incite les « esclaves » à la révolte… L’architecture joue un grand rôle dans ce film, Fritz Lang lui-même ayant une formation d’architecte.
Les décors sont de Otto Hunte, qui a étudié dans une école ayant servi de vivier aux décorateurs de l’expressionnisme, le Theater-Atelier Hartwig de Berlin. Quant au robot, il est créé par Walter Schulze-Mittendorff, un autre décorateur… Ce robot est comme un symbole de l’objet-vivant ou l’être vivant-mécanisé qui est l’une des caratéristiques du cinéma expressionnisme. Expressionniste, ce film l’est aussi par son goût des symboles, et par sa vision apocalyptique.
Voir la fiche du film élaborée par le Cinéma Le France (Saint Etienne).
Voici quelques prolongements de l’esthétique de l’expressionnisme : des films importants où apparaissent certains traits caractéristiques du mouvement.
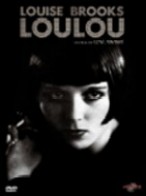
- Loulou
- (Carlotta)
Loulou, de Wilhelm PABST, 1929, avec Louise Brooks. Adaptation de deux livres de Wedekind (dont La boîte de Pandore), portrait d’une fille belle, capricieuse, insouciante qui vit et séduit pour aimer sans se soucier des convenances et des conséquences. Le jeu inoubliable de Louise Brooks, vanté par Henri Langlois (« Elle est l’intelligence du jeu cinématographique, elle est la plus parfaite incarnation de la photogénie, elle résume à elle seule tout ce que le cinéma des dernières années du muet cherchait : l’extrême naturel et l’extrême simplicité. Son art est si pur qu’il devient invisible », disait-il en 1955), ainsi que le montage du film, semblant montrer une réalité plus loin que la réalité, plus encore que les cadrages et les éclairages, en font une œuvre qu’on peut qualifier d’expressionniste.
Voir la fiche du film, élaborée par le Cinéma Le France (Saint Etienne).
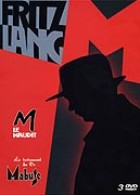
- M
- (Opening)
M le Maudit, de Fritz LANG, 1932, avec Peter Lorre. Un tueur et violeur d’enfant en série, à son tour victime d’une chasse à l’homme. Où est le bien, où est le mal ? Analyse d’un fait-divers, le film se rattache en partie au courant expressionniste par son utilisation de la lumière et de l’obscurité et par sa façon de s’emparer de la réalité, de lui donner du sens… mais au sein et au service d’un réalisme scrupuleusement étudié et rendu.
Voir la fiche du film élaborée par le Cinéma Le France (Saint Etienne).
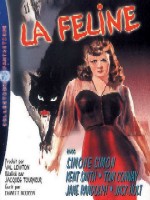
- La Féline
- (Montparnasse)
La Féline, de Jacques TOURNEUR, 1942, avec Simone Simon. Une jeune femme craint, selon une légende de son pays d’origine d’Europe centrale, qu’elle ne puisse avoir une relation avec un homme sans se transformer en « féline ». La RKO produit ce film avec peu de moyens, en utilisant surtout un fantastique de suggestion. Les créatures surnaturelles sont toutes en ombres et en traces… Le jeu des ombres et des lumières est d’ailleurs au centre de ce film, ainsi que le personnage de femme jouet de forces qui la dépassent.
Comme beaucoup de films noirs de cette époque, La Féline intègre des acquis de l’expressionnisme et la psychanalyse.
Voir la fiche élaborée par le Cinéma Le France (Saint Etienne), ainsi que l’article sur le site Devildead.

- La maison du Dr Edwardes
- (Aventi)
La maison du Dr Edwardes, d’Alfred HITCHCOCK, 1945, avec Ingrid Bergman et Gregory Peck. Le nouveau patron d’une clinique psychiatrique s’avère être un amnésique imposteur. Une belle psychiatre va l’aider à résoudre ses problèmes. Les objets, le décor (dont celui du rêve dessiné par Salvador Dali, aux perspectives étranges), la blancheur de la neige masquant les ténèbres de l’amnésie, la forte présence de lignes vertigineuses, le noir et blanc marqué, tout cela concourt à faire de ce film une œuvre au psychisme perturbé.
Article sur le site du Ciné-club de Caen.
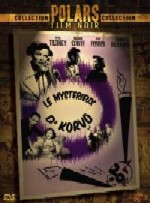
- Le mystérieux Dr Korvo
- (Carlotta)
Le mystérieux Dr Korvo, d’Otto PREMINGER, 1949, avec Gene Tierney et Mel Ferrer. Un homme mystérieux, le Docteur Korvo, manipulateur machiavélique, hypnotise une belle kleptomane afin de la faire accuser d’un crime qu’elle n’a pas commis. Les thèmes du puissant manipulateur aux prétentions scientifiques, de sa marionnette hypnotisée, les ambiances nocturnes, la présence de la maladie mentale matérialisée par des disques enregistrés, le jeu minimal des acteurs, font de ce film noir une oeuvre influencée, consciemment ou non, par l’expressionnisme.
Une critique sur le site DVD Classik.
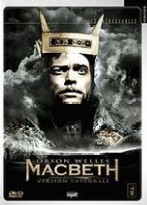
- Macbeth
- (Wild side)
Macbeth, d’Orson WELLES, 1950. Adaptation de la pièce de Shakespeare, avec Orson Welles dans le rôle titre.
« Avec Macbeth, Welles réalise un poème fantastique d’une beauté grave et douloureuse. Le génie baroque et expressionniste mis à l’œuvre confère au récit une puissance visuelle qui donne à voir la souffrance intérieure du personnage suite à sa trahison, de même que la sauvagerie – les personnages paraissent vivre dans des grottes – résultante des conflits historiques et religieux (le profane et le sacré s’opposent dans un monde en proie aux tourments de l’enfer sur Terre). » Extrait de la critique de DVD classik.
L’édition de ce DVD chez Wild side vidéo est particulièrement soignée.
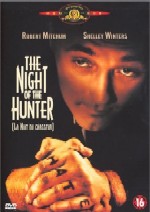
- Nuit du chasseur
- (MGM)
La nuit du chasseur, de Charles LAUGHTON, 1955, avec Robert Mitchum. John et Pearl ont juré à leur père de garder un secret, juste avant sa mort. Un homme étrange, qui se dit pasteur, séduit leur mère, et tente de leur faire avouer leur secret…
Robert Mitchum incarne le mal absolu sous des dehors séduisants.
Plus que le scénario, c’est l’atmosphère qui prime dans ce film : elle est irréelle et le fantastique du cauchemar côtoie le conte pour enfants, une morale rigide (et dévoyée) cohabite avec le rêve et la folie.
Notons que la lumière est entre les mains de l’opérateur du film d’Orson Welles La splendeur des Amberson. A un moment où le technicolor est en vogue, Charles Laughton a choisi le noir et blanc, évoquant à la fois l’expressionnisme allemand et l’œuvre de Griffith (avec la présence de l’actrice Lillian Gish).
Voir la fiche du film élaborée par le Cinéma Le France (Saint Etienne).










Poster un commentaire
One thought on “Le cinéma expressionniste allemand”
Comments are closed.