Si le temps nous était conté
Publié le 03/01/2007 à 00:00
-  13 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
13 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
L’origine de notre calendrier est complexe, d’autant plus que chaque civilisation a fixé ses propres repères. Mais dans chacune d’elles on perçoit l’importance de se repérer dans l’histoire et de mesurer le temps.

- Calendrier
[actu][*D’où vient notre calendrier ?*][actu]
Le mot calendrier vient du latin calendae , premier jour du mois chez les Romains. Il désigne un système de division du temps en années, mois, semaines, jours.

- Histoire du calendrier
- Ed. Seuil
Histoire du calendrier – Images du temps, catalogue d’exposition présentée à l’Abbaye de Noirlac du 5 mai au 2 octobre 2000, Seuil Mesurer le temps a toujours été un souci pour l’homme : il a besoin de se situer temporellement pour les divers actes de sa vie. Les efforts des hommes pour maîtriser le temps, les instruments et les pratiques inventés par les sociétés humaines à cet effet sont un grand chapitre de l’histoire de l’humanité. L’observation la plus évidente repose sur l’opposition et l’alternance entre le jour et la nuit. Par ailleurs, la lune a rapidement été utilisée dans le calcul du temps : grâce à la modification de son apparence, elle matérialise l’idée même de cycle, en passant par quatre formes différentes avant de revenir à son point de départ.
Si on s’intéresse de près à ce sujet, on s’aperçoit rapidement que la mesure du temps dans les sociétés s’accorde à leur histoire religieuse. Le temps terrestre dépend du temps divin, des dieux dans les polythéismes et de Dieu dans les monothéismes. Les calendriers sont d’abord des calendriers liturgiques et les chefs religieux jouent un rôle dominant dans les efforts de maîtrise du temps.
Histoire du calendrier – de la liturgie à l’agenda de Francesco MAIELLO, (Seuil) Si l’homme s’est toujours intéressé au temps qui passe, le calendrier est un outil relativement récent. Pour les premières civilisations le temps était surtout rythmé par la lune, les fêtes liturgiques et les récoltes. Cette histoire du calendrier revient sur le rôle joué par l’astrologie et la religion, à une époque où le calendrier n’était pas un outil commun à chacun.
Le temps compté, le temps conté, la grande aventure de la mesure du temps de David Ewing DUNCAN, (NiL éditions) Ce livre pose la question de la mesure du temps au cours des siècles, ce sujet a été à l’origine de beaucoup de calculs et de controverses. Les plus grands hommes de l’Histoire se sont intéressés à la question, remettant parfois en cause la « logique » du temps. Le pape Grégoire XIII supprima ainsi onze jours au calendrier de Jules César. De nombreuses fois, le calendrier fut remis en question par des savants, des intellectuels, prenant position sur le rôle de la lune ou du soleil pour mesurer le temps.
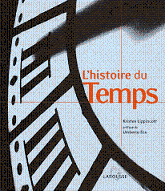
- Histoire du temps
- Ed. Larousse
L’histoire du temps de Kristen LIPPINCOTT, (Larousse) Parce que la notion de « temps » est difficile à définir et complexe, cet ouvrages empreinte cinq grandes directions : les mythes de la création, les méthodes et les instruments de mesure, la représentation artistique, l’expérience humaine, et l’idée apocalyptique de la fin du temps. Tous ces thèmes se croisent pour essayer de comprendre comment l’homme appréhende le temps depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
De même l’article de Anne LOGEAY et Françoise LABALETTE Les maîtres du temps, extrait de la revue Historia de janvier 2007 rappelle les différences entre les calendriers solaires, qui se basent sur le soleil, et les calendriers lunaires qui dépendent de la lune. Un aperçu de la logique des calendriers depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
[actu][*Notre calendrier Grégorien*][actu]
Notre calendrier est dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII qui l’a mis en place en 1582. Le calendrier grégorien est de type solaire. Il a été créé en 1582 par le pape Grégoire XIII pour corriger le retard que prenait le calendrier julien sur le Soleil, retard qui atteignait 10 jours au moment de cette réforme. Ce calendrier est défini par rapport au calendrier julien de la manière suivante : le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 (julien) fut le vendredi 15 octobre 1582 (grégorien), la succession des jours de la semaine étant respectée.
Le calendrier grégorien ne diffère du calendrier julien que par la répartition entre années communes (365 jours) et années bissextiles (366 jours). Il a été adopté dès 1582 en Italie, en Espagne, au Portugal et dans les Pays-Bas catholiques. En France la réforme a été appliquée en décembre 1582, le lundi 20 décembre succédant au dimanche 9 décembre. En Grande-Bretagne, c’est seulement en 1752 que le 14 septembre a succédé au 2 septembre et que le calendrier grégorien a été adopté. Adopté progressivement jusqu’au début du XXème siècle par tous les pays, ce calendrier est maintenant en usage dans le monde entier où il coexiste avec des calendriers religieux traditionnels.
Dossier de l’Institut de Mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) sur les concepts de « chronologie, ères et calendriers ».
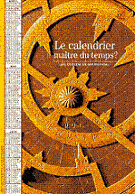
- Le calendrier maître du temps
- Ed. Gallimard
Le calendrier maître du temps de Jacqueline BOURGOING, (Gallimard) Le calendrier est devenu l’outil indispensable de la vie en société. Mais notre calendrier grégorien est le fruit d’une longue et tumultueuse histoire, Jules César, le pape Grégoire XIII et même la révolution française ont participé à son histoire. Le calendrier est à la fois un objet scientifique et technique dont la complexité a réservé bien des péripéties.
[actu][*Jours de l’an*][actu]
Le début de l’année romaine, comme chez tous les peuples usant d’un calendrier solaire, a toujours été fixé par pure convention et commençait avec le mois de mars ; Jules César, sur les conseils de Sosigène, avança de trois mois cette date : l’an 709 de Rome (-45 av JC) commença le 1er janvier, et c’est la date initiale de la réforme julienne, que Rome et avec elle les nations soumises à sa domination appliqua pendant 345 ans. Mais, au fil des siècles, l’année n’a pas commencé partout au 1er janvier, et son début a varié au gré des Églises, des époques et des pays.
Ce n’est qu’en 1564 que, par édit de Charles IX, le début de l’année fut obligatoirement fixé en France au 1er janvier ; et les fausses étrennes et « poissons d’avril » sont un lointain souvenir des dates révolues.
La République ayant été proclamée le 22 septembre 1792, date qui se trouvait être le jour équinoxial d’automne, le calendrier républicain fixa le début de l’année « au jour civil où tombe l’équinoxe d’automne au méridien de Paris ». En Russie, l’an commençait le 1er septembre ; à compter du règne de Pierre le Grand, il commença le 1er janvier. Quant à l’Angleterre, où l’an débutait le 25 mars, elle n’accepta le 1er janvier qu’avec la réforme grégorienne : l’année anglaise 1751 ne comporta que neuf mois et une semaine.
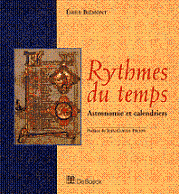
- Rythmes du temps
- Ed. De Boeck
Rythmes du temps astronomie et calendrier de Emile BIEMONT, (De Boeck) « Dans l’Antiquité, le début de l’année était essentiellement déterminé à partir des observations du ciel. S’imposèrent tout naturellement les moments privilégiés de l’année astronomique, ou agraire, à savoir les équinoxes de printemps ou d’automne et également les solstices d’hiver ou d’été. Après la réforme julienne, le premier jour de l’année fut fixé arbitrairement au 1er janvier, une date qui ne s’imposa définitivement qu’au Moyen Age suite à un décret de Charles IX en 1564. Il est assez surprenant de constater qu’à notre époque, alors qu’il est possible par l’observation de déduire avec une grande précision le début de l’année astronomique, celui-ci est fixé de manière presque universelle au premier janvier qui ne correspond plus à aucun moment privilégié de l’année astronomique, ce jour étant cependant proche du solstice d’hiver. »
Fêtes et calendriers, les rythmes du temps de Hélène BENICHOU, (Mercure de France) « Dans presque toutes les civilisations, les fêtes les plus importantes sont celles qui marquent le début et la fin de l’année. Leurs dates dépendent du climat, du lieu géographique ou du type de culture. Par leurs retours réguliers elles soulignent la nature cyclique du calendrier. Le rituel du Nouvel An vise toujours à la rénovation du monde. »
[actu][*De multiples calendriers*][actu]
De nombreux calendriers ont été expérimentés dont certains sont d’ailleurs toujours utilisés.
Calendrier julien
Le calendrier julien est, dans ses principales dispositions, conforme au calendrier romain réformé par Jules César. Ce calendrier est de type solaire. Il pose les bases de notre calendrier grégorien, en définissant le mois, la semaine et l’année, ainsi qu’en différenciant années communes et année bissextiles. Le calendrier julien a été en usage dans la plupart des nations d’Europe jusqu’au XVIème siècle. Il a été remplacé ensuite par le calendrier grégorien mais il est encore utilisé de nos jours pour déterminer les fêtes religieuses orthodoxes.
Calendrier copte
Ce calendrier est aussi de type solaire. L’année se compose de douze mois de 30 jours, suivis, trois années de suite, de 5 jours complémentaires dits épagomènes et la 4ème année de 6 jours épagomènes. La durée moyenne de l’année (365,25 jours) est donc la même que dans le calendrier julien. L’année copte commence le 29 ou le 30 août julien. Ce calendrier est encore utilisé de nos jours en Egypte.
Calendrier musulman
Le calendrier musulman a été adopté, sous sa forme actuelle, vers 632 après J.-C. Il définit l’ère musulmane dont l’origine correspond au vendredi 16 juillet 622 julien. C’est un calendrier de type lunaire. Les années sont de 12 mois. Le cycle lunaire des musulmans est de 30 ans. Il comporte 19 années communes de 354 jours et 11 années abondantes de 355 jours. Le cycle actuel a commencé le 1 Mouharram de l’an 1411 de l’ère musulmane qui correspond au mardi 24 juillet 1990. Les mois sont d’une durée de 30 et 29 jours alternativement, le premier mois de l’année étant de 30 jours et le dernier de 29 jours (année commune) ou 30 jours (année abondante). La durée moyenne du mois est voisine de celle de la lunaison. Il arrive que pour la détermination des fêtes religieuses, le début du mois soit défini par l’observation du premier croissant de lune suivant la nouvelle lune. Les calendriers sont alors locaux et dépendent des conditions d’observation.
Pour retrouver un descriptif des différents calendriers d’hier et d’aujourd’hui, consulter ce dossier en ligne sur
l’histoire du calendrier.
[actu][*Révolution et calendrier*][actu]
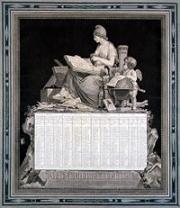
- Calendrier républicain
Les aléas de l’Histoire ont beaucoup influencé l’évolution des calendriers. Ainsi la révolution française a donné naissance à un calendrier révolutionnaire.
La proclamation en France de la République le 22 décembre 1792 affirma brutalement la rupture avec l’ordre ancien, la royauté. Les députés souhaitèrent concrétiser cet évènement par la modification du système officiel de datation. Un groupe de travail composé de mathématiciens, historiens et chimistes fut chargé de la refonte du calendrier.
Ils créèrent le calendrier républicain, calendrier solaire dont la durée moyenne est 365 jours, avec tous les 4 ans une année de 366 jours. L’année comporte douze mois égaux de trente jours et cinq à six jours de complément selon les années ; ces jours appelés sans-culottides portent des noms de valeurs morales, travail, génie, vertu. Chaque mois comprend trois décades de dix jours. Le nom des mois et des jours est complètement changé. Le nom des jours correspond à leur ordre dans la semaine, de primedi à décadi ; chacun porte un deuxième nom, plante, animal, outil, qui remplace le nom des saints de l’Église catholique. Fabre d’Églantine, auteur dramatique et poète, a imaginé des noms de mois ayant la même terminaison et le même nombre de syllabes pour une même saison.
Automne : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire.

- Pluviose
Hiver : Nivôse, Pluviôse, Ventôse.
Printemps : Germinal, Floréal, Prairial.
Été : Messidor, thermidor, Fructidor.
Par souci d’égalité et de rationalité, on a même prévu de changer la durée des heures : la journée devait être divisée en 10 heures de 100 minutes. Ainsi, une heure républicaine durait 2 h 24 minutes.
Le début de l’ère nouvelle est fixé au 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République. C’est aussi un jour d’équinoxe où le jour et la nuit sont égaux.
Mais ce calendrier, utilisé par l’État et l’armée, ne s’est jamais imposé dans la vie quotidienne et le calendrier grégorien qui n’a jamais cessé d’être utilisé redevient le calendrier officiel le 9 septembre 1805.
Le calendrier républicain par le Service des Calculs et de Mécanique Céleste du Bureau des Longitudes (Editions de l’Observatoire de Paris) Le calendrier républicain se voulait « parfait » sur le plan astronomique, mais également simple d’utilisation. Il fut conçu avec des intentions politiques clairement exprimées. Mais si il doit sa création à la Révolution, son abolition en 1806 découle aussi des bouleversements de l’histoire.
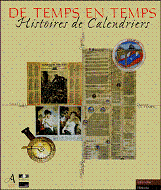
- De temps en temps
- Ed. Tallandier
De temps en temps – Histoires de Calendriers, (Tallandier) « Les propositions du Comité étaient présentées sous formes de décret, instituant que l’« ère des Français » commencerait à la fondation de la République, le 22 décembre 1792. Le commencement de chaque année serait fixé à minuit du jour où tombe l’équinoxe d’automne. L’année serait divisé en douze mois de trente jours chacun, après lesquels suivraient cinq jours complémentaires. Chaque mois serait divisé en trois parties de dix jours appelés décades. Le système décimal s’appliquerait également aux heures : le jour serait divisé en dix heures, chaque heure en dixièmes, chaque dixième ne centièmes. »
Pour en savoir plus sur le calendrier républicain.
1er avril / 1er janvier
Voir
Datation, mention après Jésus Christ
Voir
Calendrier grégorien, ville de Genève
Voir
Calendrier julien, mois de février
Voir










Partager cet article