Le conservateur Felipe Calderón remporte l'élection présidentielle mexicaine.
Publié le 07/07/2006 à 23:00
-  9 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
9 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
Mexique, à gauche vraiment ?,Courrier International, n°817 du 29 juin au 5 juillet 2006, p36 à42 L’enjeu de cette présidentielle ; la campagne violente des derniers mois ; les candidats ; la cas Almo, populaire ou populiste ; l’absence de débat sur la question indigène ; la situation socio-économique du Mexique ; le bilan de Vicente Fox, président sortant ; le regard posé par les américains sur ces élections.
Amérique latine, Polymnia ZAGEFKA, Les Etudes de la Documentation Française, n°5233-34, 2006 Ce numéro consacré à l’évolution politique en Amérique latine, présente la situation du Mexique à la veille des élections à la partie « Fiches pays ».
Amérique latine, Questions internationales, n°18, mars-avril 2006 Tableau d’ensemble sur ce vaste continent (le développement, les évolutions politiques et religieuses, les différents formes de violence, les rapprochements régionaux…) accompagné d’analyses plus individuelles de certains états comme le Mexique. L’article « Le Mexique à la croisée des deux Amériques » s’intéresse à la dualité de ce pays, interface entre l’ Amérique du Nord et celle du Sud, une réalité géographique et historique avec laquelle le pays doit composer en permanence.
 Mexique. Entre l’abîme et le sublime, Gaëtan MORTIER.
Mexique. Entre l’abîme et le sublime, Gaëtan MORTIER.
En commande à la bibliothèque. Radiographie de cette nation essentielle sur l’échiquier diplomatique mondial au plus près de sa réalité et de ses défis. Un portrait du Mexique, pays métis, pays de la révolution zapatiste, pays pétrolier, pays frontière et porte d’entrée vers les Etats-Unis, pays écartelé entre progressisme et conservatisme.
[actu]L’élection présidentielle de 2006[actu]
Roberto Madrazo, « le Dinosaure », candidat du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), parti hégémonique qui a gouverné le pays pendant 71 ans, de 1929 à 2000,
 incarnant la « politique à l’ancienne », soit le clientélisme et l’intimidation, la corruption et la fraude électorale, a été relégué en 3ème position. Le sous-commandant Marcos, porte-parole de la rébellion zapatiste, a participé à sa manière à « l’autre campagne » et a effectué une tournée de six mois à travers le pays pour critiqué le candidat de gauche, selon lui compromis et ne s’interresant pas assez à la cause indigène. Le duel s’est déroulé donc entre le candidat Felipe Calderón, candidat du Parti d’action nationale (PAN), le parti libéral du président Vicente Fox et Andrés Manuel Lopez Obrador (Amlo pour les mexicains) candidat de la gauche (Parti de la révolution démocratique, PRD).
incarnant la « politique à l’ancienne », soit le clientélisme et l’intimidation, la corruption et la fraude électorale, a été relégué en 3ème position. Le sous-commandant Marcos, porte-parole de la rébellion zapatiste, a participé à sa manière à « l’autre campagne » et a effectué une tournée de six mois à travers le pays pour critiqué le candidat de gauche, selon lui compromis et ne s’interresant pas assez à la cause indigène. Le duel s’est déroulé donc entre le candidat Felipe Calderón, candidat du Parti d’action nationale (PAN), le parti libéral du président Vicente Fox et Andrés Manuel Lopez Obrador (Amlo pour les mexicains) candidat de la gauche (Parti de la révolution démocratique, PRD).
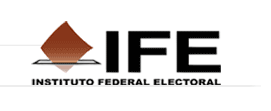
Lors de ces elections, un Institut fédéral électoral (IFE) indépendant, a tenu les bureaux de vote qui ont été contrôlés par des représentants de tous les partis, et les procédures correspondaient aux normes de transparence internationale.

- Felipe Calderon
- Wikimedia
Après un coude à coude serré, les bulletins des états du Nord favorables à Felipe Calderon, ont propulsé ce dernier devant le leader des pauvres soutenu par les « votos cambiantes » (vote des indécis). La victoire de l’ancien maire de Mexico n’a finalement pas scellé le renversement par palliers des pays d’Amérique latine à gauche.
Elections mexicaines Une présentation des candidats, des partis en lice, une mise à jour avec les derniers résultats, un lien vers l’article sur l’histoire politique du Mexique.
Instituto Federal Electoral Pour les hispanisants, le site de l’ Instituto Federal Electoral ou IFE (Institut Fédéral Éléctoral) ,organisme publique, autonome dont la responsabilité est d’organiser et surveiller les élections mexicaines au niveau fédéral, c’est-à-dire, celles concernant les Députés, les Sénateurs et le Président de la République Mexicaine.
les articles du Monde consacrés aux élections mexicaines.
[actu]Mexique / Etats Unis : une relation ambivalente[actu]

- US-Mexico border (Tijuana). March 2004
- Wikimedia
La proximité des Etats-Unis ainsi que leur influence historique sur leurs voisins du sud en a fait un interlocuteur naturel mais a aussi créé une dépendance dont le Mexique aimerait parfois d’affranchir. Cette proximité et le différentiel économique qui sépare ces deux états sont à l’origine du flux migratoire le plus important au monde, créant par là-même une interdépendance entretenant ce système de mobilité actif, légal à 60 %.
Mexique à la croisée des deux Amériques, Laurent FARET. Lire sur la question des migrations vers les Etats Unis, l’encart « Miami, une métropole latina aux Etats-Unis ».
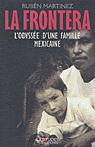 La frontera : l’odyssée d’une famille mexicaine, Rubén Martinez.
La frontera : l’odyssée d’une famille mexicaine, Rubén Martinez. L’auteur a passé 2 ans avec la famille Chavez qui après plusieurs tentatives et des morts sur la route d’El Norte, a pu rejoindre l’eldorado américain. Au delà de ce récit sur cette famille mexicaine, l’auteur dresse le tableau de l’immigration de milliers de migrants mexicains, de la mondialisation et des rapports Nord-Sud.
[actu]Intégration géopolitique et contexte économique[actu]
Dans sa relation aux Etats-Unis mais aussi au reste du monde, le Mexique privilégie des objectifs économiques (adhésion à l’ALENA) et géopolitiques plutôt que les aspects politiques et sociaux. En effet, le Mexique s’efforce d’afficher une appartenance aux pays développés alors que bon nombre de ses indicateurs sociaux le relient fortement aux réalités des pays du Sud et notamment des pays centraméricains.
Avec cette dualité de visage selon que le Mexique regarde au Nord ou au Sud, le pays doit faire face à des enjeux cruciaux qui sont au cœur de cette élection présidentielle.
La situation économique du pays s’est affaiblie sous la présidence de Vicente Fox. Le taux de croissance de 4,2% en 2004 a baissé de 1,5 point en 2005. La balance commerciale enregistre depuis 2004 un déficit (1,2% du PIB) et le Mexique subit de plein fouet la concurrence chinoise sur son terrain de prédilection, le continent nord-américain. La rente pétrolière et les transferts de revenus des émigrés mexicains constituent cependant une source de revenus stables la relance de la consommation associée à une baisse du chomâge contribuent à une croissance générale du pays ;
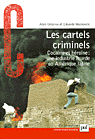 Les cartels criminels : cocaïne et héroïne : une industrie lourde en Amérique latine, Alain DELPIROU, Eduardo MACKENSIE
Les cartels criminels : cocaïne et héroïne : une industrie lourde en Amérique latine, Alain DELPIROU, Eduardo MACKENSIE L’Association nationale des institutions financières colombiennes publie, en mars 2000, un rapport révélant que le chiffre d’affaires de la narco-économie colombienne représentait 56 % du PIB de ce pays. Culture intensive, industrie lourde, milliards de dollars, assassinats, telles sont les réalités du cartel latino-américain de la drogue.
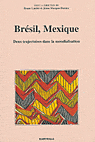 Brésil, Mexique : deux trajectoires dans la mondialisation, Bruno LAUTIER, Jaime Marques PEREIRA.
Brésil, Mexique : deux trajectoires dans la mondialisation, Bruno LAUTIER, Jaime Marques PEREIRA. La rédéfinition du rôle des Etats dans le cadre de la globalisation constitue l’intérêt central de cette étude. Analyse la mise en oeuvre des préceptes du libéralisme économique et politique dans ces deux pays et leur impact sur les problèmes sociaux.
 Exporter au Mexique, Olivier VASSEROT.
Exporter au Mexique, Olivier VASSEROT. Des conseils économiques, juridiques et pratiques pour les entreprises désirant exporter au Mexique.
[actu]Le Chiapas oublié ?[actu]

Durant cette campagne, les revendications indiennes n’ont pas été reprises dans les débats publics et la campagne de Marcos très peu médiatisée. Or les revendidations du groupe révolutionnaire mexicain constitué par plusieurs milliers d’indiens du Chiapas appelé l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) continue son action en faveur des droits des indigènes, tissant des liens avec l’alter-mondialisme.
 Marcos, la dignité rebelle : conversations avec le sous-commandant Marcos, Ignacio RAMONET.
Marcos, la dignité rebelle : conversations avec le sous-commandant Marcos, Ignacio RAMONET. Conversations entre Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique et le Sous-Commandant Marcos. Masqué par son célèbre passe-montagne, il explique ici les raisons de sa révolte, et se penche sur la marginalisation des pauvres du sud à l’heure de la mondialisation.
L’étincelle zapatiste : insurrection indienne et résistance planétaire, Jérôme BASCHET. Historien, maître de conférences à l’École des Hautes Études en sciences sociales, l’auteur dévoile le visage du mouvement zapatiste, au-delà du folklore et de l’image véhiculée par les médias. Mouvement anti-capitaliste, le zapatisme ouvre en 1994 la voie à une autre pensée révolutionnaire.










Partager cet article