Lyon se penche sur ses berges > le confluent, première période
Publié le 03/11/2011 à 00:00
-  80 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
80 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
Préface de Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon, pour Mémoires en mutation, premier cahier de La Confluence, avril 2008.
Liens
Les prisons de Lyon se font la belle (2009)
Du marché-gare de Perrache au marché de gros de Corbas : chronique d’un transfert annoncé (2008)
Port Edouard Herriot : la plaque tournante du trafic de fret en Rhône-Alpes ? (2008)
Morand et la place Lyautey (2008)
Miribel Jonage : le grand parc de loisirs (2006)
La Foire de Lyon, moteur de l’économie en région (2006)
et trois dossiers
Lyon se penche sur ses berges > le Confluent, seconde période (2011)
Lyon se penche sur ses berges > le Rhône (2008)
Les mutations d’un parc urbain, la Tête d’Or (2009)
3NB : Les visuels inclus dans cette page proviennent partiellement des sites Lyon Confluence et La Confluence qui nous ont aimablement autorisés à les utiliser. D’autres visuels proviennent des contributeurs qui s’associent à la Bibliothèque pour collecter les mémoires urbaines de Lyon. Ce projet est intitulé Tous photographes ! Les collections photographiques de la Bibliothèque et les apports des contributeurs sont réunis dans le portail Photographes en Rhône-Alpes. 3
Un écoquartier à la recherche de ses écocitoyens
3La recherche de la mixité… durable3
La Confluence est un quartier pluri-mixte : mixité sociale, bureaux et logements (2/3 contre 1/3), 60% d’espaces publics.
La première phase comporte 1500 logements, dont 20% de logements locatifs sociaux et 15% de logements intermédiaires, la seconde phase en proposera 50%, préservant la vocation populaire du quartier. Dans sa globalité, le projet Confluence doit offrir 30% de logements sociaux, contre 8% actuellement sur le 2e arrondissement de Lyon. La méthode ? Sur un programme, les bailleurs sociaux sont désignés en amont par les collectivités, puis ils formulent leurs besoins (x logements de telle configuration pour tel public) et indiquent le prix auquel ils s’engagent à acheter. Le tout est intégré dans le cahier des charges d’appel d’offres. Ce sont ensuite les promoteurs associés aux architectes qui sont mis en concurrence pour répondre à ces demandes. L’aménageur vérifie que le parc destiné aux bailleurs sociaux bénéficie des mêmes prestations, notamment HQE, que le parc libre… Une partie des programmes en accession sociale est réservée prioritairement aux locataires du parc social. La démarche vise à les aider à accéder à la propriété, libérant une place précieuse dans le parc HLM. (In Habiter à la Confluence, un quartier mixte et écologique, Lyon Confluence, 2009.
Des logements et des bureaux de haute qualité environnementale
Pour bénéficier du programme européen Concerto, les concepteurs ont rempli l’objectif de réduction de 40% des besoins énergétiques et de la couverture à 80% par des énergies renouvelables. La dotation de Concerto s’est élevée à 5,6 millions d’euros, 4,3 de l’Europe, 1,3 de la région Rhône-Alpes et de l’Ademe. Les bâtiments Hélianthe (siège d’Eiffage) et Eolis ont reçu le label HQE (Haute Qualité Environnementale). La forme parallélépipédique des bâtiments facilite l’isolation extérieure, en « matelas » de 30 cm d’épaisseur. « Bâtiments Hélianthe et Eolis sur Lyon Confluence : une opération exemplaire certifiée NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQR », in Bulletin d’information du BTP, avril 2009, n°377
Les immeubles labellisés Concerto (Saône Park, Lyon Islands, le Monolithe) ont été inaugurés le 14 octobre 2010. « Intelligence collective mise en œuvre pour créer ici le monde du futur » selon Serge Orru, directeur général de WWF, « projet fantastique » selon Jean-Marie Bemtgen, directeur général Energie de la CE. Cette gigantesque opération d’urbanisme vert de 150 hectares, vient d’achever une première étape de 660 logements (1 500 habitants), 15 000 m2 de bureaux et 4 000 m2 de commerces avec énergies renouvelables et conception bioclimatique à tous les étages. Les logements, qui fonctionnent pour 80% aux ENR (bois, isolation extérieure, chauffe-eau solaires…) consomment moitié moins que les normes de la réglementation thermique actuelle. Pour la deuxième phase, Lyon Confluence s’est engagé avec le WWF dans un Plan d’Action Durabilité, prévoyant entre autres critères zéro carbone, zéro déchets et la mobilité durable. « Lyon Confluence à la pointe des quartiers éco-durables ». In La Tribune, 15 octobre 2010, n°4578
La Confluence est-il pour autant un quartier de ville « positive » ?
Rodolphe Deborre, directeur associé de BeCitizen, cabinet de conseil stratégique et financier en environnement, pense que l’urbanisme peut réparer l’environnement. La ville est alors dite « positive ». La ville positive a pour objet de créer ou maintenir de la biodiversité. La ville positive doit se construire sur des espaces urbains existants, ou mieux, sur des morceaux de villes inhabités en friches (friches portuaires, industrielles, militaires)… C’est le cas pour les quartiers Confluence de Lyon ou de Bonne à Grenoble qui ont remis en circulation des morceaux de villes existants. Bâtir une ville positive, c’est d’abord reconstruire la ville sur elle-même. Bâtir une ville positive, c’est également valoriser le sol comme ressource rare et précieuse. Il faut donc bâtir dense. Mais c’est aussi réduire l’usage du véhicule individuel, dont l’impact écologique direct et sociologique est très important au profit de la mobilité douce : à pied, à vélo, en transports en commun…le choix du site et l’organisation urbaine de la ville positive permet à la ville existante de se régénérer… Cela exige une vision politique à long terme du territoire à atteindre… et une mise en œuvre progressive des solutions en accompagnant les changements de mentalités héritières des développements urbains négatifs de ces 50 à 100 dernières années…. Sur le site du Moniteur.fr
3 Ecorésidents de la république…3
La grogne de ceux qui y travaillent…
L’arrivée de 1 400 agents du Conseil régional a relancé la polémique sur la circulation et le stationnement. Dans un dossier publié dans le journal La Tribune de Lyonle 19 mai 2011, intitulé « Au secours ! Ils arrivent », François Sapy et Antoine Lecomte mettent en cause les rêves écolo du Grand Lyon, chiche en places de parking, le dogme étant les gens n’ont qu’à prendre les transports en commun. La première étape a été de généraliser le tout payant pour lutter contre les voitures-ventouses. L’opérateur immobilier Unibail, qui va gérer le pôle de loisirs, prévoit d’instaurer des navettes fluviales électriques entre le quai de la Pêcherie et la Confluence, dès son ouverture en mars 2012. Le syndicat CGT des personnels du conseil régional propose que les agents terminent le travail à 15 h 45 au lieu de 16 h 00, ce qui a fait bien rire la Région… sinon, il propose que la prise en charge des abonnements des transports en commun passent de 50 à 70%.
Les journalistes rappellent qu’en 2020, la Confluence devrait avoir accueilli 25 000 habitants et 20 000 emplois. Les responsables de Lyon Confluence se veulent rassurant. Le parc du Pôle de loisirs proposera 1500 places et pourrait ouvrir partiellement fin 2011 avant le centre commercial (mars 2012), celui des Archives 632, le nouveau siège du Conseil 430, avec la possibilité de prévoir plus de stationnement en phase 2, ou de miser sur le développement des parc-relais, ou encore sur le développement d’Autolib. Selon la dernière enquête « ménages-déplacement », citée par les journalistes de la La Tribune de Lyon, les Grands lyonnais effectuent malheureusement encore 47% de leurs déplacements en voiture. On évoque par ailleurs un péage urbain. La Mairie du 2e arrondissement tente de défendre son intervention dans un projet qui se joue principalement au niveau de l’agglomération : voir les propos de Denis Broliquier, du 22 juin 2006. Il revenait sur ses inquiétudes concernant les capacités de déplacements et de stationnement dans un article du Progrès du 16 mars 2009.(4)
Lyon Confluence et la nature : Stéphane Autran propose une réflexion sur la place réelle de la nature dans le chantier dans Les Infrastructures vertes à l’épreuve des plans d’urbanisme, publié par le CERTU, p.283-296.
… et ceux qui y aimeraient y habiter
Le prix du mètre carré à la Confluence démarre à 2 200 euros pour l’accession sociale, et jusqu’à 10 000 euros dans les logements haut de gamme, avec un prix moyen de 4 500 euros, largement supérieur à 3 700 euros, prix moyen pour le reste de l’agglomération. Selon un article du journal Lyon Capitale de juin 2010, La Confluence est devenue « the place to be » : des étrangers ont investi dans le quartier et récemment, la famille d’un dignitaire iranien se serait portée acquéreur de deux duplex et aurait envisagé d’acheter l’ancienne capitainerie, future boite de nuit du quartier.
L’attribution des logements locatifs sociaux dépend des bailleurs sociaux qui informent les personnes intéressées, instruisent les dossiers et gèrent les demandes des réservataires institutionnels. Pour s’installer à la Confluence… déposer une demande auprès d’un réservataire institutionnel : Ville de Lyon (mairie centrale) – service habitat – tél. 04 26 99 64 00 ; Mairie du 2ème arrondissement – service logement – tél. 04 78 92 73 00 ; Préfecture du Rhône – service Inter Administratif du Logement – tél. 04 72 60 55 25
déposer un dossier auprès d’un bailleur : cf. liste des bailleurs sociaux de Rhône Alpes
Voir aussi le dossier de presse Un jeudi au bord de l’eau , réalisé à l’occasion de la mise en eau de la darse, présentant les chantiers de logements
3Devenir écocitoyen3
Jusqu’en 2004, la communication de la SEM Confluence a porté sur l’innovation, les grands architectes remportant les concours avec quelle inventivité… Si les cahiers des charges destinés aux opérateurs et aux concepteurs faisaient état d’exigences environnementales, celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une sensibilisation du public. Les dernières publications, au contraire, communiquent sur le développement durable en impliquant l’écocitoyen.
Les premiers habitants sont arrivés en septembre 2009. Ils ont reçu une brochure intitulée Bienvenue à la Confluence. Dans la préface, signée du maire Gérard Collomb, on peut lire : Vous avez choisi de vous installer à la Confluence… La Confluence est cette ville mixte et respectueuse de l’altérité, que nous appelons de nos vœux, une ville vivante et agréable où l’on fait le choix d’habiter, de travailler ou de se distraire ; de se déplacer en modes doux avec un tramway bientôt prolongé vers Gerland… La Confluence, pour vous, habitants, c’est le plaisir de la vie en ville… Pour ce grand quartier, nous avons fait le choix de la haute qualité environnementale, conscients des défis qui s’imposent à notre planète, et donc à l’avenir de notre métropole…A Lyon, nous voulons construire la ville de demain. Une ville qui rapproche les femmes et les hommes. Nous comptons sur vous pour contribuer à l’invention de ces nouveaux modes de vie urbains, respectueux de l’environnement, où vivre ensemble est, plus qu’une nécessité, un art de vivre. Et comment mettre à profit la qualité environnementale des logements et des bureaux ? La brochure propose quelques prescriptions : faire respirer son appartement, bien régler son thermostat, préserver l’eau, tirer parti de toutes les sources de lumières, consommer différemment, économiser l’électricité… Il n’existera pas d’écoquartier sans écorésidents… Concertation, phase 1
Concertation, phase 2
Bienvenue à la Confluence : clés d’entrée pour mon quartier, publication de Lyon Confluence préfacée par Gérard Collomb.
Lyon, La Confluence. 03 : Mémoires en mutation, consacré aux « habitants de la Confluence ».
La Confluence, phase 1 en cours
Le chantier du confluent, de la place Carnot à la pointe de la Presqu’île représente une superficie totale de 150 hectares.
Le premier acte, la première phase, concerne un territoire de 41 hectares, un programme de construction de 400 000 m², 1/3 logements (130 000 m² dont environ 20 % de social, représentant au total 3000 habitants), 2/3 d’activités soit 12 000 emplois. 22,5 hectares sont consacrés aux espaces publics et 17 hectares aux espaces verts.
3Une nouvelle conception de l’urbanisme3
L’urbanisme… affiche son goût pour les rivages et les berges, soulignant la « curieuse sympathie envers les ponts bâtis qui font découvrir le plaisir d’être suspendu entre l’eau et le ciel… L’histoire des villes est liée à leurs multiples rapports avec l’eau. Nous vivons un retour à des dimensions sensibles après une période plus fonctionnaliste et nous essayons de comprendre cette relation à l’eau. » De l’histoire de la ville et de l’eau, il s’agit d’écrire un chapitre supplémentaire, celui de notre époque : sur la Confluence, le projet urbain valorise les docks, le port et donne naissance à une place nautique et à des jardins aquatiques… La démarche d’urbanisme est « progressive », selon la théorie de Grether. Comme la ville, elle se nourrit d’enrichissements au fil du temps : « L’urbaniste écrit le scénario auquel les acteurs peuvent ajouter un éclairage nouveau. C’est le reflet de notre époque où s’exprime la diversité des regards. Mais pluralité ne signifie pas désordre. Chaque maître d’oeuvre tient compte de l’architecture de son voisin ». Quel projet préfère François Grether ? On s’attache à tous, répond-il, sans en être le propriétaire. Le projet urbain est une oeuvre collective, « Il n’a pas d’auteur ». Portrait de François Grether, publié le 1er janvier 2007 dans l’Indicateur Bertrand, p. 48.
Selon Pierre Lefèvre et Michel Sabard, l’équipe Grether-Desvignes a travaillé sur quatre thèmes majeurs : la qualité de vie, la mixité, les usages et l’entretien des espaces publics. La densité recherchée est proche du centre historique, près de 200 logements à l’hectare, avec des immeubles à R+7, un coefficient d’occupation des sols supérieur à 3. Les écoquartiers : l’avenir de la ville durable , de Pierre Lefèvre et Michel Sabard.
Voir toutes les dates du projet Lyon confluence, de 1995 à 2006.
Dès l’origine du projet, il est nécessaire de soutenir la renaissance du quartier par les liaisons urbaines adéquates. Pour des raisons de coût, on a préféré finalement le tram au métro. En 2005, la ligne T1, ouverte en 2001, est prolongée jusqu’à Montrochet.
3La phase 1, pas à pas3
Prémilinaires
La réhabilitation du bâtiment des Archives municipales puis la réalisation de la place qui porte son nom constituent l’ouverture de cet opéra urbanistique. Le bâtiment, ancien hôtel des postes construit en 1905 a été réaménagé par Albert Constantin dans un but principal de fonctionnalité.
Le nouvel espace de mémoire, inauguré en 2001, se tient sur une place piétonne entièrement repensée par l’agence HYL : la Place des archives. Le projet combine deux espaces successifs, une place jardin, préfiguration d’une promenade vers le Rhône et une place parvis. Le parvis a une fonction d’interface piétonne entre les différents moyens de transports, la gare, le tramway… Un parc de stationnement de 630 places a été construit sous la place.
Autre préliminaire : la dépollution du site. GRS Valthec (filiale du Groupe Veolia Propreté) a traité dans son centre de résorption thermique de Saint-Pierre-de-Chandieu une partie des terres faiblement polluées du site de la Confluence, en les chauffant à 500° afin de faire évaporer les hydrocarbures. 70 000 tonnes de terre très faiblement polluées mais considérées comme non inertes ont été traitées sur place dans une unité mobile, par ajout de stabilisants. Une petite quantité a été évacuée afin d’être enfouie. Source : un article paru le 28 août 2008 dans l’Usine Nouvelle, intitulé « Lyon Confluence traite ses sols pollués ».
Les Docks
Ce territoire des Docks se situe à l’emplacement du Port Rambaud, le long de la rive gauche de la Saône.
Construit dans les années 20, le long du Cours Rambaud, en amont du viaduc de la Mulatière, le Port Rambaud est progressivement équipé pour stocker charbon, potasses, chaux et ciments, bois, fer, mais aussi sucre, denrées coloniales, vins et céréales. 54e port fluvial français en 1970, il ne cessera ensuite de reculer, jusqu’en 1995 où son activité s’interrompt.
Cet espace est concerné par la construction de nouveaux bâtiments comme celui du journal Le Progrès ou du groupe Espace, la réhabilitation de bâtiments anciens – la Capitainerie, les Salins, les Douanes, la Sucrière – et la réalisation d’un parc des bords de Saône de 4 hectares qui constitue la première étape du réaménagement des berges de la Saône. La mise en valeur des Docks privilégie la culture et les loisirs.
Une consultation d’architectes sélectionnés sur référence a été lancée pour les Salins et trois pavillons à construire, au Sud du Port Rambaud. Son objectif : hisser l’ambition architecturale de l’ensemble des édifices et avoir une vision globale pour l’ensemble des constructions futures, dans le cadre du cahier des charges de la SEM Lyon Confluence, défini par F. Grether et M Desvigne. L’architecte urbaniste François Grether souligne les points suivants : Comme tous les Docks, les pavillons (à construire) doivent être nettement distincts des formes urbaines des ilôts voisins. Leurs programmes et leurs expressions architecturales doivent être indépendants et singuliers , ajoutant qu’ une recherche particulière sur la manière de capter la lumière et de laisser passer les vues compatibles avec l’unicité de façades devra être entreprise . 5 équipes ont remis fin 2005 des esquisses, d’une grande créativité. Il s’agit de Rudi Riccioti, Jacob et Mac Farlane, Odile Deck et Benoit Cornette, Didier Faustino, Shigeru Ban et Jean de Gastines. Dossier de presse sur les projet des Docks : Les Docks : un partenariat public privé original au service d’un ambitieux projet de ville
3 Le Cube orange3
Le Cube orange de Dominique Jakob et Brendan MacFarlane est avec le Monolithe le bâtiment qui contribue le plus au buzz territorial. L’immeuble propose 4590 m2, dont 900 m2 de commerce. Il renoue avec le vocabulaire portuaire avec sa double peau couleur minium. Paradoxalement, celle-ci semble ne pas avoir empêché ses sept types de panneaux d’aluminium thermolaqué (1,35 x 3,20 m) d’avoir été comme dévorés par la rouille au vu de leur perforation numérique en nid-d’abeilles que trouent à leur tour des penta, hepta et nonagones réguliers ! Cette dentelle se prolonge en voilette protectrice de la terrasse ceinturant le dernier étage règlementairement en retrait de 5 m. Sa médiatique appellation se révèle trompeuse, car il s’agit en fait d’un hexaèdre (29 x 33 m au sol x 22 m environ de haut) dont trois cônes entaillent l’intégrité volumétrique. Le plus grand ébrèche largement ses façades orientales et septentrionales sur leurs quatre étages intermédiaires pour rejoindre celui évidant le niveau supérieur. Transcrivant le patio imposé par le cahier des charges, cette béance géométrale se révèle surtout un dispositif bioclimatique des plus performants en aspirant l’air rafraîchi au nord par la Saône aux plus chaudes heures de l’été tout en canalisant la lumière du jour au cœur des vastes plateaux… Cette architecture iconique risque bien d’incarner quelque temps encore ce nouveau quartier de Lyon en pleine ébullition ! Revue Ulysse,. « Confluence, la porte du XXIe siècle », n°146, 3 avril 2011
Revue Archistorm,. « Lyon Confluence, puissance cube », n°46, janvier/février 2011.
Revue Architectural record, « Orange Cube », mai 2011
Le Monolithe
C’est l’immeuble le plus important de cette zone. Il est organisé autour d’une cour centrale ouverte par trois portes monumentales sur l’espace public. Il est issu du dialogue entre un maître d’ouvrage, ING Real Estate dirigé par Frédérique Monjanel et de cinq architectes qui se le sont partagés en autant de parcelles. 5 architectes, 5 matériaux, 5 textures, le bois, les bétons matricés, l’inox et l’aluminium juxtaposés créent la variété, la complexité des façades de la ville. Au nord, Erick Van Egeraat propose une façade constituée d’un mélange aléatoire et subtil entre de grands panneaux de mélèze naturel et de verre émaillé gris et blanc, des stores gris extérieurs ponctuent aléatoirement la façade. Emmanuel Combarel et Dominique Marrec (ECDM) réalisent la partie centrale en béton matricé lazuré ocre doré, la géométrie de la matrice fait référence au pop art. Les variations de lumière sur le motif font découvrir la grande rigueur géométrique du relief. Manuelle Gautrand a choisi l’inox miroir, et propose d’orner la porte ouest de fleurs d’inox, qui font face au jardin central et aux balmes. La sous face du pont et la façade en inox miroir reflètent le jardin et les passants du parvis. On retrouve avec Pierre Gautier du béton matricé lazuré gris anthracite façon « roche brute » vers l’ouest, ponctué de loggias et de grandes baies vitrées généreuses. La façade sud signée MVRDV (Winy Maas) est composée de panneaux d’aluminium gris naturel, chaque fenêtre possède un volet sur lequel est gravée une lettre perforé. Sur l’ensemble de la façade en position fermée, on peut lire le début de la constitution européenne, réaction de MVRDV au vote négatif de la France et des Pays-Bas en 2005, concernant ce texte.
Il propose des logements, des bureaux et des commerces. 33 logements sociaux y sont implantés dont une pension de famille de 16 logements d’Habitat et Humanisme, inaugurés le 5 septembre 2011. Ces appartements sont autonomes avec des parties communes animées par un responsable et son adjointe. Il comprend par ailleurs 17 logements individuels. Il permet d’accueillir des publics diversifiés, aux revenus modestes ou isolés socialement, pouvant s’appuyer sur des lieux de rencontres et de convivialité facilitant la réinsertion. sur le Monolithe, voir le dossier du Moniteur Architecture AMC, numéro 204 de mars 2011.
L’Hôtel de la région Rhône-Alpes
La région a acquis l’ancienne cité ferroviaire située cours Charlemagne pour construire l’Hôtel de région. Christian de Potzamparc, lauréat du Pritzker Prize en 1994, est retenu pour réaliser le projet. Comme pour le Musée des Confluences, le coût du futur siège de la Région fait polémique : Comme pour tout chantier d’envergure au coût plus ou moins fluctuant – a fortiori connoté politiquement – la question du prix du siège de la Région à Lyon, fait débat. Au départ, le coût avancé était d’un peu moins de 100 millions hors taxe, aujourd’hui il est de 135,8 millions. L’opposition UMP en fait ses choux gras, dénonçant en boucle « le palais de Jean-Jack Queyranne » sans oublier un geste de démagogie « on aurait pu construire au moins 3 lycées » avec le prix final qui, d’après Jean-Pierre Girard, et ses amis se situera entre 150 et 200 millions. Ce à quoi le vice-président, Thierry Braillard, répond : « nous n’avons pas varié, le solde final pour le contribuable – compte tenu de la revente du siège actuel et des économies réalisées – sera de 20 à 30 millions ». « Le siège actuel de la Région ne sera pas vendu avant 2011 » in Le Progrès du 9 août 2009.
Le déménagement des 1 400 agents et de leurs outils de travail s’est étalé de mai à juin 2011, avec journées portes ouvertes les 18 et 19 juin. Le bâtiment compte 45 650 m2 au total, dont 28 000 m2 pour un atrium central sorte d’agora publique d’où l’on peut suivre les échanges de la salle des délibérations… C’est dans l’organisation de ces espaces internes que Portzamparc exprime au mieux son talent. L’atrium, qui lui-même trouve son extension dans l’esplanade François Mitterand, joue à plein l’image d’une démocratie simple et ouverte. Pour les employés, un jardin intérieur apporte, outre le symbole de la norme HQE… la haute qualité d’usage (HQU) supposée prévenir crises de nerfs et raptus anxieux. Cette qualité se matérialise aussi dans les petites surprises que l’architecte sait créer : des salles de réunion imaginées comme un village, des passerelles aléatoires, de la verdure en veux-tu en voilà, etc. In Le Monde du 26 mai 2011, un article de Frédéric Edelmann intitulé « Christian de Portzamparc, éclaireur du nouveau Lyon ».
Le bâtiment est en cours de labellisation Très Haute Performance Energétique : double vitrage et isolation extérieure renforcée, panneaux solaires photovoltaïques en toiture produisant 7% de la consommation d’électricité (1 100 m2), capteurs solaires thermiques produisant 50% de l’eau chaude, pompe à chaleur, récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, le lavage des véhicules et les sanitaires, ventilation free-cooling…
Les Douanes
L’ancien bâtiment des douanes est réhabilité par Jean-Michel Wilmotte afin d’abriter deux galeries d’art, une agence de publicité et le restaurant La Plage, situé jusqu’ici dans le quartier d’Ainay. Le dessin à l’échelle 1/3 de l’ancien bâtiment sur la nouvelle construction ajoute à la dimension artistique et mémorielle du projet. Les Douanes sont désormais le siège du groupe Communiquez et de la galerie Georges Verney-Caron, ainsi que du groupe Nouveau Monde DDB
La Sucrière
L’ ancien entrepôt de sucre accueille les biennales d’art contemporain dont celle du 15 septembre au 31 décembre 2011, dont l’intitulé est « Une terrible beauté est née » et les manifestations musicales (les Nuits sonores)
Le bâtiment des Salins du Midi
Il abrite le nouveau restaurant de Nicolas le Bec (2 000 m2). Nicolas le Bec voisine désormais avec deux autres restaurants : le Do Mo, installé dans les Douanes, et enfin les Docs 40. La requalification du bâtiment a été pilotée par Dominique Jakob et Brendan MacFarlane, concepteurs du Cube orange.
Ce complexe proposera au public une succession de kiosques, à la manière des Halles, où il sera possible de prendre un café, déjeuner, boire un verre ou même acheter des fleurs. Le cœur de cet univers sera l’espace restauration de 200 places aménagé au rez-de-chaussée et prolongé par une terrasse en bord de Saône. A l’étage supérieur, un autre espace de 20 couverts sera voué à une clientèle souhaitant goûter à la cuisine gastronomique et où seront servis des produits d’exception. Source : l’ADERLY
Le pôle de loisirs
Sur un territoire, comme dans une huître, il faut quelque chose qui permette de cristalliser la perle. : pour Gérard Collomb, c’est la construction d’un pôle de loisirs attractifs qui contribuera à donner son dynamisme au quartier.
Le 20 décembre 2002, la SEM retient le projet de l’architecte Jean-Paul Viguier, auteur de Cœur-Défense à Paris. Deux sociétés immobilières néerlandaises, Mab et Corio, proposent un modèle original de pôle de loisirs, à vocation culturelle et commerciale. En 2003, l’investisseur Corio se retire et Unibail-Rodamco, groupe d’investissement français, lui succède. Ce groupe est déjà propriétaire des 132 000 m2 et 132 boutiques du centre commercial de la Part-Dieu.
Le pôle de loisirs et de commerces sera le poumon économique de la zone, avec 52 000 m2 de surfaces de vente pour dix moyennes surfaces… un multiplex de quatorze salle UGC et une soixantaine de boutiques dédiées au sport, à l’équipement de la personne et de la maison.. Il ne sera ouvert qu’en mars 2012, laissant au quartier le temps aux enseignes de s’installer et éventuellement à la crise économique de passer. En avril 2011, 50% des espaces étaient déjà commercialisés. In LSA, n°2178, 21 avril 2011
Le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial 2004-2010 se donne pour objectif le maintien, ou le rétablissement de situations équilibrées dans l’armature commerciale de l’agglomération lyonnaise. Fondé sur de multiples analyses prospectives (démographie, offre commerciale, comportements de consommation, stratégies des distributeurs) et intégrant la réalisation programmée de deux pôles de commerce et loisirs Confluence et Carré de Soie, il anticipe les potentialités de développement de chaque » bassin de vie » sur la base d’évolutions raisonnées de l’offre commerciale, respectueuses des centre villes et de la qualité de vie qu’on y trouve.
La place nautique et sa darse
En faisant pénétrer l’eau dans le tissu urbain, la place nautique se situe au centre de l’interaction entre la ville et le fleuve. Parce qu’ils souhaitent en faire un espace public majeur de la cité, ses concepteurs l’ont située dans la continuité des places de la presqu’île, Bellecour et les Terreaux. Prévue sur une étendue de 4 hectares (dont 2 de bassin), elle accueille une halte fluviale pour les plaisanciers de passage, des activités nautiques et des animations. Elle comprend des espaces de promenades autour d’un grand bassin ouvert sur la Saône : la darse.
Les immeubles en face du pôle de loisirs, au nord de la darse, se présentent comme un jeu de cubes, métaphore d’un empilement de conteneurs, rappelant le port.
Le quai qui longe la darse a reçu le nom de quai Antoine Riboud le 25 juin 2010.
Pour sa première année (2011), la marina a accueilli 327 bateaux de mai à fin septembre. Le taux de remplissage moyen est évalué à 50 %, tandis que la durée de séjour a été inférieure à deux jours pour deux tiers des embarcations.La très grande majorité des plaisanciers était d’origine étrangère. L’Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Hollande et l’Angleterre ont été les pays les plus représentés , précise le Grand Lyon. In Le Progrès, « Pour son premier été, la place nautique a séduit les plaisanciers », le 6 octobre 2011.
Dossier de presse Découverte de la place nautique – 4 juin 2007
« Gros œuvre darse », in Lyon citoyen de juillet-août 2008. Il s’agit d’un bassin de deux hectares et 900 mètres de quai, construit transversalement au cours de la Saône, qui irrigue le cœur du futur quartier. Le mur d’enceinte de la darse a été réalisé en premier. 12 mètres de profondeur et 1 mètre de largeur pour une paroi moulée en béton qui assure la solidité de l’ouvrage. Une fois le contenant réalisé, il « suffisait » ensuite de le curer, en évacuant le contenu par technique de dragage. La darse était donc pleine d’eau avant d’être ouverte sur la Saône ! Un système de pompage crée même une circulation de l’eau du bassin vers l’extérieur pour maintenir une qualité contrôlée plusieurs fois par an…. Vue aérienne de ladarse, site Lyon Confluence. Une passerelle piétonne a été posée en novembre 2008.
Lyon, La Confluence, Mémoires en mutation. Photographies, Jacques Damez ; texte, Jean-Pierre Nouhaud. Ce premier Cahier de la Confluence retrace l’évolution du nouveau quartier dans sa première phase de transformation. : construction de la place des Archives, creusement de la darse inauguré le 15 mai 2008…
Lyon, La Confluence. 02 : Mémoires en mutation. Mémoires de voir
Dossier de presse consacré à l’installation de la passerelle qui enjambe la place nautique (novembre 2008). La passerelle de 62 m de long et pesant 65 t a été transportée depuis Chateauroux en 5 morceaux, assemblée, mise en forme par contrainte puis posée sur ses piliers.
Une seconde passerelle a été installée le 5 juin 2009. Elle a été conçue par le bureau d’études Alto, fabriquée par Viry, et pèse environ 30 tonnes. L’acier dont elle est composée, le même qui est utilisé pour la construction des méthaniers, résiste à la corrosion et à la pollution. Elle se lèvera pour permettre aux bateaux d’accéder au plan d’eau.
Le parc des Berges de Saône
Conçu par Michel Desvigne, il se veut le signe d’une interpénétration entre les constructions, les fleuves et les espaces verts. A partir de son épine dorsale, une promenade située le long de la Saône, le parc se ramifie en places aquatiques, squares et rues arborées parmi les bureaux et les logements. Il s’étend sur 14 hectares au total. Le projet initial de renaturation des berges a été abandonné. En septembre 2009, et à l’arrivée des premiers habitants, la promenade entre le confluent et le pont Kitchener était en grande partie praticable. La ville de Lyon a voté le 23 juin 2008 une subvention exceptionnelle d’équipement de 670 000 euros à l’opération Lyon Confluence concernant le parc Saône et la place nautique. Conseil municipal. Séance du 23 juin 2008
Les ports de Lyon : redistribution des cartes
Nés à 10 ans d’intervalle sur deux rives différentes, le Port Rambaud et le Port Edouard Herriot ont cohabité pendant près de 50 ans avant que leurs destins ne divergent. Le premier connaît actuellement une vaste entreprise de reconversion dans le cadre de Lyon Confluence. Le second, après des années de polémiques, n’en poursuit pas moins son chemin vers la Méditerranée.
3Sur le quai Rambaud, l’industrie cède le pas à l’art3
Construit en 1926, le Port Rambaud constitue la dernière étape de port sur la Saône avant la construction en 1935 du port Edouard Herriot. Alors qu’il est exploité avec succès dans l’entre-deux-guerres, l’incendie de son port d’hydrocarbures, en 1940, l’oblige à resserrer ses activités sur le transport de marchandises générales après la seconde guerre mondiale. A partir de 1985, le site est progressivement abandonné au bénéfice de son rival situé sur le Rhône. Pour une histoire détaillée du port
En 2004, la fermeture des Salins du Midi met un point final à l’activité industrialo-portuaire du port Rambaud. Avant même cette fermeture, V.N.F. (Voies Navigables de France) (1) entame dès la fin des années 1990 une concertation avec la Communauté Urbaine de Lyon et la Caisse des dépôts et des consignations afin de transformer ce port en zone d’activités consacrée à la culture à la communication et à la création.
Cette concertation aboutit à un projet présenté en 2006 par Dominique Perben, Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer et porté par une filiale de V.N.F., Rhône-Saône développement. (2)Il s’agit à la fois de conserver le caractère industriel du lieu, de mettre en valeur son rapport à la Saône et d’apporter une touche artistique au projet. En 2003, l’accueil de la Biennale d’art contemporain dans l’ancien entrepôt de la Sucrière est le premier témoignage de cette reconversion.
Articles récents sur le port Rambaud
Maud Guillot, « Le Renouveau du Port Rambaud », dans Lyon Mag, n°167, Mars 2007, p.70-71.
Alice Géraud, « Architecture : le port épique du confluent », dans Le Point, n°1802, 29 mars 2007, p. 4-7.
3L’éphémère port de plaisance3
Le 13 avril 1997, un article du Progrès annonce que la restructuration du port Rambaud s’oriente vers la plaisance : il est question d’un espace sur lequel l’établissement public (V. N.F.) souhaite voir se développer des activités liées à l’eau et un port de plaisance. Et si ce n’est pas un grand port, étant donné la superficie du site, il faudrait au moins un mini port. Car ici, précise M. Fay (responsable de V.N.F.) transitent 2000 bateaux de plaisance chaque année.(3)
En juin 2004, le Magazine du Grand Lyon affirme dans un article consacré à la future place nautique de la Confluence : Le nouveau plan d’eau sera tout sauf un port de plaisance et encore moins une marina.
Il comportera certes une halte fluviale pour une trentaine de bateaux de passage mais se veut surtout un site dédié à l’animation avec des embarcations spécifiques le long du quai Sud.(4)
Du port de plaisance à la halte fluviale, que s’est-il passé ? Le dialogue entre V.N.F. et la Courly a évolué vers d’autres perspectives, incluant la construction d’un terminal croisière pour les paquebots fluviaux.
Définitions
Port de plaisance : Equipement portuaire lourd pour plus de 60 bateaux et doté de l’ensemble des facilités nécessaires au stationnement et à la maintenance des bateaux.
Halte fluviale : Equipement d’escale et de court séjour avec amarrage, eau, poubelles, sanitaires, pouvant recevoir jusqu’à 30 bateaux.(5)
3Edouard Herriot : un port dans la ville ?3
En 2004, alors même que toute activité cesse sur le Port Rambaud, son rival du Rhône enregistre un flux global de marchandises équivalent à 10 millions de tonnes par an. Il s’étend sur 187 hectares et ouvre sur 550 km de voies d’eau. Port avancé de Marseille, il concentre sur son site l’ensemble des moyens de transports modernes.
Pourtant le succès d’aujourd’hui n’a pas toujours été garanti. La place du port de Lyon a été discutée âprement ces vingt dernières années.
1933 : Naissance du port
Suite à la loi Rhône du 27 mai 1921 prévoyant l’aménagement du fleuve de la Suisse à la Méditerranée, l’Etat donne concession à la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) pour aménager et exploiter le fleuve. En 1934, la C.N.R. commence son premier chantier, la construction du port Edouard Herriot : construit en zone inondable, sur la rive gauche du Rhône, il s’étend sur 30 hectares à son ouverture en 1937.
A partir de l’incendie du port Rambaud, le déchargement des hydrocarbures s’effectue sur le port Edouard Herriot : l’activité pétrolière ne reviendra plus sur la Saône. Ainsi, tandis que le port Rambaud décline, le port du Rhône grandit en taille et diversifie ses activités.
Dates clés(6)
***1966 : Avec l’aménagement hydroélectrique de Pierre-Bénite, le port atteint une superficie globale de 184 hectares
***1968 : Raccord à l’oléoduc Méditerranée-Rhône
***1974 : La C.N.R. confie à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (C.C.I.) une zone banalisée de 10 hectares pour la construction d’un terminal à conteneurs
Années 80-90 : un port a-t-il sa place au cœur d’une ville ?
Décembre 1976, un car de ramassage scolaire se perd dans le brouillard. L’enceinte du port est mal balisée et le bus tombe à l’eau, provoquant la mort de 14 enfants. Juin 1987, le dépôt d’hydrocarbures de l’entreprise Shell explose, faisant 2 morts et plusieurs blessés graves. L’incendie frappe violemment les esprits, d’autant qu’il faudra 13 ans pour établir les responsabilités judiciaires.
Entre 1989 et 1995, Michel Noir, alors Maire de Lyon, pose la question de la localisation du port Edouard Herriot au sein de la ville de Lyon. La crainte d’un autre accident conduit la municipalité à envisager le déménagement du port et la transformation du site en espace vert. Le projet ne sera jamais mené à terme et l’élection de Raymond Barre amène un changement radical de politique.
Lyon Terminal : le développement des conteneurs
Le nouveau Maire voit dans la navigation fluviale une potentialité de développement pour la ville. Il encourage le développement d’une activité moderne de transports par conteneurs. En 1993, la C.N.R. avait créé une filiale, Lyon Terminal chargée de reprendre l’activité de conteneurs précédemment développée par la C.C.I. Le 24 mars 1997, un accord entre les collectivités locales, l’Union Française des Industries Pétrolières (U.F.I.P.) et la C.N.R. aboutit au transfert de l’ensemble des activités pétrolières sur la presqu’île de l’archevêque. Si le projet sert à libérer de la place pour les conteneurs, il permet aussi d’éloigner les activités dangereuses des équipements sportifs de Gerland. 1996 : « Marseille est bien le premier port de Lyon » (7)
Dans le cadre de son propre développement, le Port Autonome de Marseille (P.A.M.) entre en contact avec la C.N.R. afin de créer une base avancée en Rhône-Alpes. En construisant à Lyon une plate-forme multimodale de transports, le P.A.M. attire à la Méditerranée le trafic portuaire du Rhône au détriment des ports du Havre et de Rotterdam. D’année en année, le lien entre les deux ports grandit : en 2000, le P.A.M. entre à 16% dans le capital de Lyon-Terminal.
Les années 2000 : renforcement et remise en cause
Avec la cessation d’activités au Port Rambaud, le port Edouard Herriot demeure seul maître à bord : en 2002, pour faire face à l’explosion du trafic fluvial, Lyon Terminal met en chantier un second terminal dont l’inauguration a eu lieu en décembre 2006. Mais, malgré la croissance de l’activité et les tentatives d’intégration au quartier de Gerland (8), la sécurité des installations est encore régulièrement remise en cause (9) : en 2006, les dépôts pétroliers situés dans le 7e arrondissement sont toujours classés sites Seveso.
(1) V.N.F. est un établissement public sous la tutelle du Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer : il est chargé du développement des voies navigables de France et des sites portuaires situés sur des fleuves et appartenant à l’Etat.
(2) Présentation du projet par le cabinet Jakob MacFarlane, annexe à la présentation du projet par Dominique Perben.
(3) Aline Duret, « Urbanisme : confluent : Aménagement du port Rambaud : cap sur la plaisance », in Le Progrès, 13 avril 2007.
(4) « La place nautique prête pour le grand saut », in Magazine du Grand Lyon, Juin-Juillet 2004, p.7.
(5) Définitions prises dans la rubrique lexique du site de V.N.F.
(6) Extrait de l’article « Port Edouard-Herriot : 60 ans et des projets de lifting », in Le Tout Lyon et le moniteur judiciaire réunis, 1er juillet 1997.
(7) Titre d’un article de Jean-Claude Pennec, in Le Progrès, 25 avril 1998.
(8) « Lyon 7e : Port Edouard-Herriot : un nouveau terminal prévu pour 2005 », in Le Progrès, 25 août 2003.
(9) Voir notamment José Noya et Jean Ruffier, « Des boules de gaz hors la loi dans le port Edouard-Herriot », in Lyon Capitale, le 3 octobre 2001, suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse.
Du confluent à la Confluence
Il n’y a pas de grande métropole sans projet d’avenir. Nous avons besoin d’un quartier qui symbolise le passage au siècle nouveau, le développement de notre ville et le rôle important qu’elle doit jouer dans l’Europe du XXIe siècle. Lyon Confluence n’est pas une simple opération d’urbanisme. C’est un dossier de ville mais aussi de vie.
C’est par ces mots que Raymond Barre, alors Maire de Lyon, lance l’un des plus grands chantiers de l’hexagone de par sa durée et de par l’espace concerné : de la gare Perrache à la fin de la presqu’île, 150 hectares de friches industrielles à repenser et à reconstruire. En se penchant sur ce quartier à la jonction entre le Rhône et la Saône, le dossier aborde à présent les rives de l’autre fleuve.
3Pour un retour historique sur le quartier3
Itinéraires du patrimoine en Rhône-Alpes
Lyon le confluent « derrière les voûtes , Editions Lieux dits, Cahier du patrimoine, 1980.
3Le confluent avant la Confluence3
Il abrite des activités peu valorisées, comme les maisons d’arrêt de Saint-Paul et Saint-Joseph et le marché de gros, ou des activités méconnues, telles que la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) qui compte parmi les acteurs socio-éducatifs les plus dynamiques de la presqu’île.
Ce constat aboutit à l’élaboration de plusieurs projets successifs : en 1988, dans le cadre de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) Perrache-Quais de Saône, Thierry Schnadelbach propose un premier aménagement de la rive droite de la Saône. La majeure partie du projet reste cependant lettre morte : seul en subsiste l’amphithéâtre de verdure.
3La Confluence selon Oriol Bohigas et Thierry Melot : le temps de l’utopie ? 3
1996 : Raymond Barre inscrit l’aménagement du confluent dans ses objectifs de mandat, marquant ainsi le vrai démarrage du projet de Lyon Confluence. Le groupe Melot Bohigas Mosbach (MBM) est retenu pour élaborer un premier plan de développement et poser les principales pistes de la réhabilitation du quartier. Les objectifs sont de deux ordres : à l’échelle de Lyon, le projet vise à rendre au quartier sa visibilité et son activité tout en prolongeant le centre-ville. Mais, ainsi que l’a souligné Raymond Barre, il est également le symbole de l’entrée de la capitale des Gaules dans le XXI ème siècle.
Le projet prend donc en compte à la fois le caractère du site et l’esprit contemporain en matière d’urbanisme. Le quartier devra laisser la place belle aux espaces verts (97 hectares sur 150) et se laisser imprégner de l’atmosphère des fleuves, grâce à la renaturation des berges et à la création d’un port de plaisance. Mais pour exister réellement, il lui faudra également attirer des activités tertiaires et commerciales, édifier ce que les aménageurs appellent une ville mixte, où se côtoient le plus harmonieusement possible logements, bureaux, commerces ou équipements culturels.(1)
Pour Raymond Barre et l’équipe MBM, il est primordial de faire disparaître les entités responsables de l’isolement du quartier. Du désenclavement dépendent la poursuite de l’opération et sa réussite. Le projet ne se concentre donc pas tant sur les aménagements que sur la recherche de solutions permettant le déclassement de l’autoroute A6-A7 et la démolition du centre d’échanges (2). La construction d’un shunt, tunnel autoroutier qui relierait Ecully à Pierre-Bénite, et le contournement Ouest de la ville sont autant d’hypothèses qui attirent l’attention de l’Etat et des collectivités. Mais, malgré l’adhésion des citoyens consultés par concertation, la réalisation à court terme de ce projet se révèle être une utopie. Avec le retour à des ambitions plus réalistes, c’est une nouvelle phase de Lyon Confluence qui commence.
Le tronçon ouest du périphérique (TOP) est loin d’être lancé, la réunion de concertation entre Gérard Collomb et Michel Mercier d’une part, les maires des communes concernées d’autre part (Ecully, Tassin, Francheville, Chaponost…) ayant été annulée en février 2009.
3La SEM Lyon confluence : la phase opérationnelle3
L’équipe Bohigas Melot est remplacée par un tandem composé de l’architecte François Grether et de l’urbaniste Michel Desvigne le 1er avril 1999 : le journal Lyon Capitale parle d’un « débarquement » consécutif au manque de transparence financière (3). Le 19 avril, la Société d’Economie Mixte (SEM) Lyon Confluence est créée : elle a pour but de coordonner l’ensemble du projet et ses différentes phases.
La rupture est double : d’abord, la création de la SEM fait évoluer la fonction des responsables du projet : Le choix est de se limiter au pilotage stratégique et au management de projet en mobilisant à la carte les consultants et expertises externes, en fonction des diverses étapes de la mise en œuvre.(4) Le but est d’éviter les dérives financières dénoncées par Lyon Capitale et de clarifier les responsabilités de chacun.
La SEM Lyon Confluence devient en février 2008 une société publique locale d’aménagement (SPLA).
Au niveau des réalisations elles-mêmes, le déplacement des infrastructures devient un objectif de long terme, inscrit dans la phase 2 du projet. François Grether et Michel Desvigne insistent en effet sur la construction du projet dans la durée : il ne s’agit pas d’œuvrer dans l’urgence, mais d’échelonner les réalisations pour que le quartier puisse exister à terme.
En mars 2001, l’élection de Gérard Collomb conclut cette phase de transition : le chantier de Lyon Confluence peut enfin prendre forme…
(1)Aline Duret, « Lyon confluence : la maquette du confluent », in Le Progrès, 10 octobre 1998.
(2) « Enquête : les autoroutes de la discorde divisent Lyon », in La Tribune Grand Rhône-Alpes, le 16 octobre 1998.
(3) Philippe CHASLOT, « Urbanisme : le projet du confluent tombe à l’eau. », in Lyon capitale, 21 juin 2000.
(4) Alix Hoang, « Lyon-Confluence : une structure légère centrée sur le management du projet », in La Maîtrise d’ouvrage urbaine, p.114.
(5) Claire Bernole, « La ligne T1 joue les prolongations », in Lyon Figaro, 9 juin 2003.
(6) Gérard Collomb, maire de Lyon, cité par Agnès Benoist, « Urbanisme : Lyon confluent démarre par le ludique. », dans Lyon Figaro, 12 avril 2002.
Michel-Antoine Perrache (1726-1779) et l’émergence du quartier
Après avoir eu de nombreux précurseurs, Michel-Antoine Perrache fut le véritable créateur du quartier qui porte son nom explique Félix Rivet sur les origines du quartier Perrache
3M. Perrache et son quartier3
Depuis longtemps, le besoin d’espace se fait ressentir à Lyon. La population augmente, les activités croissent. En 1766, lorsque Michel-Antoine Perrache expose son projet d’agrandissement à la municipalité, la ville se limite aux remparts d’Ainay au Sud, aux coteaux de Fourvière à l’Ouest et de la Croix-Rousse au Nord. Le plan de ce sculpteur, membre de l’Académie de Lyon, reprenait l’idée déjà ancienne de Hardouin-Mansard (1677) et le dessin de Guillaume-Marie Delorme datant de 1738. En 1766, l’île Mogniat est séparée de la ville par le confluent du Rhône et de la Saône qui baigne les remparts de l’abbaye d’Ainay. L’idée de Perrache est de combler ce bras du Rhône et de reculer ainsi le confluent jusqu’à la Mulatière.

- Vue perspective de l’agrandissement
à la partie méridionale de la ville de Lyon - Fonds Coste, cote 245. BML
Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là. Il désir également doter ce nouveau quartier d’un canal, d’un pont et d’une gare d’eau abritée en liaison avec la Saône. Lorsque, cette même année 1766, Perrache adresse ses devis, mémoires et plans au Contrôleur Général des Finances, celui-ci le soumet à son tour au Consulat qui désigne huit commissaires-enquêteurs. Ceux-ci rendent alors un rapport défavorable, le 21 juin, soulevant de nombreuses critiques dont une évaluation du prix des matériaux trop vague et un manque d’études préliminaires concernant les conséquences sur les fleuves (la Saône large de 300 pieds sous le pont d’Ainay était supposé s’engouffrer dans un canal de 230 pieds). Ils précisent entre autres choses :
Les eaux stagnantes dans l’ancien lit du Rhône formeront une espèce d’étang où les crapauds, les grenouilles et autres reptiles qui y mourront dans les chaleurs répandront des vapeurs malsaines, engendreront des maladies communes aux lieux marécageux.
Un second projet, établit avec l’aide précieuse de l’architecte Jacques-Germain Soufflot prévoyant le creusement d’un nouveau lit bordé par le futur quai de la Charité et patronné par le gouvernement, est déclaré d’utilité publique et accepté en 1770 par le Consulat. Il prévoyait en outre qu’un cours planté d’arbres servirait à la fois de promenade agréable et de route pour le Languedoc. Le nouveau territoire serait divisé en deux parties par un cours de 72 m. de large. Le terrain situé entre ce cours et les remparts d’Ainay, dont la démolition était également prévue, serait d’une superficie de 252 000 m² et servirait à l’agrandissement de la ville. Au centre se situerait une place carrée de 185 m² autour sur laquelle figurerait une statue équestre du roi et l’Hôtel du Gouvernement. La municipalité concède alors à Michel Antoine Perrache les territoires au-delà des remparts.
Mais que pensait la fameuse opinion publique de ce projet pharaonique ? Il est qualifié « de projet d’assèchement de la Méditerranée par un apprenti maçon », montrant ainsi que le scepticisme touchait autant la municipalité que les lyonnais.
La « Compagnie Perrache » ou « Entreprise des constructions pour la partie méridionale de la ville de Lyon », rassemblant des actionnaires et associés de Perrache, est créée pour le financement de ces travaux le 28 décembre 1771. Les travaux débutent en 1772. En 1776 est construit le quai et en 1777 les remparts d’Ainay sont démolis. Avec la mort de Michel Antoine Perrache en 1779 s’arrêtent les travaux. La Compagnie Perrache est alors reprise par sa sœur Marie Anne Perrache, puis par le comte de Laurencin. La situation est difficile. La partie méridionale de la presqu’île est dans un état insalubre et inachevé, la compagnie est endettée et la crue de 1783 a emporté le pont de Belle Vue (pont de la Mulatière) nouvellement construit sur la Saône. Arguant l’intérêt public du projet, le comte de Laurencin parvient à conclure un traité avec le roi en vue d’un financement de la reconstruction du pont, de la poursuite des travaux et du remboursement des dettes contractées. Néanmoins, la Révolution viendra mettre fin à ces traités ainsi qu’à la Compagnie Perrache qui sera définitivement dissoute le 19 juillet 1826.
Les terres du confluent ont éveillé l’imagination de nombreux architectes. Pléthore de projets virent le jour mais peu devinrent réalité. La volonté de consacrer une partie du quartier Perrache à un parc date de l’Ancien Régime. Le premier grand projet est celui de Sain-Rousset, maire de la division du Midi. Félix Rivet le décrit ainsi : Sur un plan presque gigantesque, des rues, quais et ports apparaissaient le long de la Saône, en partant du pont de l’Archevêché, bordés d’une plantation identique à celle de la chaussée Perrache .Les allées parallèles le long des deux fleuves aboutiraient à d’autres parties ombragées avec lesquelles elles formeraient « un cours prolongé en spirale, et peut-être le plus magnifique qui ait jamais existé » .
Il est accepté par la municipalité le 23 février 1803 mais ne sera jamais réalisé faute d’une aide financière du gouvernement. Puis c’est au tour de l’architecte-paysagiste Curten Aîné de proposer son plan d’embellissement de la presqu’île qu’il développe dans son Mémoire descriptif du plan d’un projet d’embellissement de la partie méridionale de la Ville de Lyon en 1807. Il prévoyait de créer un parc avec des pavillons chinois, des statues grecques, des gondoles vénitiennes, des établissements de bain ou encore des salles de danse. Mais cette proposition ne sera jamais réalisée non plus puisqu’un autre dessein était réservé à cette partie de la ville.
En effet, le sénatus-consulte du 28 floréal An XII prévoyait que des palais impériaux soient établis aux quatre points principaux de l’Empire. Ce à quoi répondit le Conseil Municipal : [ Heureuse la ville de Lyon, si elle peut concevoir une aussi douce espérance ! ]. Ces plans non plus ne seront pas mis en œuvre, la chute de Napoléon Ier en 1815 venant mettre un point final à ce, pour le moins, majestueux projet.
3La grande ère de l’industrialisation3
Consacrer à des établissements industriels ou fabriques, […], tout le terrein de la presqu’île Perrache
Le début du XIXème siècle voit l’aménagement du nord du quartier en un « quartier neuf » et la reconstruction du pont de la Mulatière. Néanmoins, il faut attendre 1823 pour que la Ville puisse recouvrer son droit à la propriété sur la partie sud et ainsi en reprendre l’aménagement. Cette année est en effet votée la loi de rétrocession des terrains du sud de la presqu’île à la Ville de Lyon par le gouvernement royal.
L’implantation d’une ligne de chemin de fer est votée en 1826 par le conseil municipal : il s’agit d’un accord conclu avec les frères Seguin à qui la mairie confie les terrains pour l’implantation de ce chemin de fer.
Les frères Seguin, en échange, s’engagent à favoriser l’industrialisation du quartier : le programme établi par le marquis Jean de Lacroix-Laval, maire de Lyon (1826-1831), s’inspire largement de celui de Perrache.
en 1828, une ordonnance royale approuve la vente aux enchères publiques des terrains de Perrache. Les futurs acquéreurs sont engagés à implanter prioritairement des activités industrielles.
Le but affiché par la municipalité est de diversifier l’économie lyonnaise, exclusivement centrée sur la soie. Toutes les conditions sont réunies pour permettre l’application de cet ambitieux plan : l’arrivée prochaine du chemin de fer mais aussi les voies terrestres et fluviales, la proximité des matières premières et combustibles.
Le 7 mars 1827, une Ordonnance Royale approuve les statuts de la Compagnie Seguin entreprenant la construction d’un chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne. On ne rencontre dans la liste des actionnaires qu’une seule maison lyonnaise. Néanmoins, les milieux d’affaires de la ville sont très favorables, cet accueil pouvant s’expliquer par le besoin accru des usines et la lenteur et le coût du roulage. Un rapport de la Chambre de Commerce de Lyon datant du 1er mars 1827 l’explique d’ailleurs :
Au moyen du chemin de fer qui nous amènera les produits du bassin houiller du département de la Loire à si bas prix qu’il semblera qu’une mine à été découverte au milieu de nous, toutes les usines qui emploient les machines à vapeur pourront être mises en activité ; placées sur le Rhône et la Saône, débouchant par le Rhône à la Méditerranée, arrivant par la Saône aux canaux qui mettent cette rivière en communication avec le Rhin et la Seine, elles pourront expédier avec facilité et économie leurs produits dans le Midi et dans le Nord de la France et de l’Europe.
La première gare lyonnaise avec sa ligne Lyon-Saint-Étienne est inaugurée en 1846 à l’emplacement actuel du marché de gros. Le site accueil également les ateliers métallurgiques des frères Seguin et l’usine chimique de Claude Perret. Nous sommes bien loin des rêves de parcs exceptionnels et de palais impériaux avec l’installation en l’espace de dix ans de la prison Saint-Joseph (qui sera suivie 34 ans plus tard, en 1865 de la prison de Saint-Paul), de la brasserie Rink, future Brasserie Georges, de l’entrepôt des liquides et des abattoirs. L’abattage des animaux se faisait dans des tueries, dans les arrière-courts des bouchers ou dans les grandes boucheries. Quatre tueries sont recensées à Lyon avant 1840, à l’Hôtel-Dieu, aux Terreaux, à Saint-Paul et à Saint-Georges. Celles-ci font l’objet de nombreuses plaintes de la part des habitants mais vont aussi à l’encontre des nouvelles théories d’hygiène. Suite à leur suppression, un abattoir est créé à ¨Perrache dans la pointe de la presqu’île. Cet emplacement permet une relative proximité avec les lieux de consommation tout en étant à la périphérie de la ville.
Le quartier Perrache a été un terrain de jeu incroyable pour l’imagination des architectes. De projets grandioses, comme celui de Curten Aîné et de son parc exceptionnel où se mêlaient gondoles vénitiennes et statues grecques, cet espace gagné par la ville était devenu l’espace industriel de Lyon. N’aurait-on pas pu tirer mieux parti de ce site ? s’interroge Félix Rivet. En effet, les critiques ne manquent pas alors contre les lyonnais bien peu poétiques. Le journaliste Jules Janin, qui traverse la ville en mai 1838 écrit à ce sujet dans un article publié dans Les Débats :
Allons voir, s’il vous plaît, au bout de l’allée Perrache, la solennelle union de deux fleuves quand la Saône, lente et timide fiancée va se jeter dans les bras de son fougueux époux en bondissant d’orgueil. Hélas ! Même ce magnifique spectacle est troublé par l’industrie. Voyageur attentif à cette lutte sans fin de la rivière contre le fleuve, du flot bleu contre le fleuve jaune, du murmure contre le bruit, de l’onde ridée à peine contre la vague écumante, prenez garde ! car derrière vous et pour vous disputer le passage, tout à l’heure, va passer en grinçant des dents, le chemin de fer, l’esclave tout puissant du monde matériel.
Les conditions dans lesquelles se faisaient les voyages étaient plutôt rudimentaires. En effet, pour sortir de Lyon, il fallait atteler six chevaux de fiacres aux chars et les faire marcher au pas jusqu’à la première voûte. Puis, les chevaux sont remplacés par une machine à vapeur de petit calibre. Puis une alternance entre machine à vapeur et chevaux rythme le voyage. Néanmoins, malgré ces désagréments, le chemin de fer est un indéniable point fort pour le quartier Perrache.
3Au-dessus des voûtes, la gare…3
En 1846, la reconstruction du pont mixte de la Mulatière et le développement exceptionnel du chemin de fer détermine le destin du quartier Perrache.
La gare Perrache sera la gare centrale de Lyon pendant plus d’un siècle, jusqu’à l’inauguration de la gare de la Part-Dieu au début des années 80.
Construite en 1857, la gare Perrache accueille non seulement les marchandises mais aussi les voyageurs. Il est doté d’un accueil des diligences, d’un service de messageries, d’une réception des cargaisons.
L’architecte Cendrier, qui dirige le projet pour le compte de la Compagnie des chemins de fer, est chargé de trouver une solution à un épineux problème. La situation géographique particulière de Perrache oblige les trains à franchir deux cours d’eau. Il faut alors constituer un remblai permettant à la gare d’atteindre le niveau élevé des viaducs. C’est la raison pour laquelle les voies ferrées sont élevées au-dessus du cours Charlemagne et que l’accès au quartier même se fait par les voûtes.
Le grand projet du XXème siècle, promu par Edouard Herriot (maire de Lyon de 1905 à 1942 puis de 1945 à 1957) est l’extension de la ville moderne avec la construction des abattoirs et du stade de Tony Garnier dans le quartier de Gerland. Ce projet a pour conséquence la suppression de la gare d’eau de Perrache, trop insalubre, au profit de celle de Vaise, à l’activité plus intense. À la place, la municipalité y construit le port Rambaud en rive gauche de la Saône, port public inauguré en 1926. Perrache perd également ses abattoirs, tout comme Vaise, au profit cette fois de Gerland et des abattoirs de la Mouche conçus également par Tony Garnier. Dans les premières décennies du XXème siècle, le quartier de Perrache se révèle également être une terre d’asile pour la population ouvrière lyonnaise. On y construit quatre ensembles d’habitations collectives de plus de 600 logements au total, le tout entre le cours Charlemagne et l’église Sainte-Blandine. La fermeture des abattoirs libère de la place pour la construction d’une cité HBM (Habitat Bon Marché) comprenant 282 logements.
De nombreux sites se développent dans le quartier, profitant de la proximité des rails de chemin de fer : le port Rambaud et son approvisionnement en charbon en provenance de Saint-Étienne ou encore le centre de tri postal de Montrochet en 1978. Le marché gare est implanté quant à lui sur la partie est de la gare d’eau désaffectée, le 9 mai 1961. Sa superficie totale est de 16 hectares. Avant 1961, le marché de gros avait lieu sur les bords de la Saône. Mais, afin de débarrasser le centre-ville des problèmes de circulation et de stationnement, le conseil municipal charge en 1955 l’architecte en chef de la ville Louis Weckerlin de déménager le marché dans le quartier de Perrache.
3Louis Pradel et la « machine à échanger »3
Durant l’après-guerre, la ville se heurte à un problème de circulation important, autant au niveau est-ouest avec la difficile circulation dans la montée de Choulans qu’au niveau du tunnel de la Croix-Rousse qui abrite les nationales 6 et 7. Pour y remédier, un second tunnel est percé sous Fourvière afin de faciliter le transit est-ouest. En 1963, sur une demande de l’Etat, le maire de Lyon Louis Pradel (1957-1976) autorise, provisoirement, l’emprunt de ce tunnel par l’autoroute A6 entre Paris et Lyon et la jonction de l’A6 et l’A7 sur le cours Verdun.
Cette solution permettait de diminuer les charges des collectivités locales. Cette jonction autoroutière en plein centre-ville isole encore plus le nord du sud de la presqu’île. L’impact urbanistique n’est pas vraiment mesuré par la municipalité. Louis Pradel, très largement influencé par l’architecture des grandes cités nord-américaines, se targue d’être le maire de la seule ville au monde, avec Los Angeles, que l’on peut traverser sans feu rouge.
En 1969, l’architecte René Gagès est chargé de concevoir un centre d’échange à Perrache permettant une organisation de la circulation des voitures sur les deux axes ainsi que des trains. Après un premier projet de « gare-pont urbain » rejeté, un second projet de l’architecte est approuvé en 1972. La Communauté Urbaine délègue alors à la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) sa maîtrise d’ouvrage et la SEM Lyon Parc Auto, filiale de la CDC, supervise ce chantier.
Il s’étendra de 1972 à 1976. Cet échangeur, « mille-feuilles », « machine à circuler », faite d’acier, de verre et de béton est achevé en juin 1976. Il est au départ défini comme avant-gardiste, mais très vite, ce cube de béton placé en plein cours Charlemagne finit par avoir mauvaise presse auprès des lyonnais. Si son côté fonctionnel est indéniable (il accueil le train, le tramway, le métro et les bus, tout en ayant une galerie marchande, un parking automobile et même une garderie et un jardin suspendu), son aspect esthétique lui vaut entre autres surnoms celui de « verrue de la Presqu’île ».
Clôturons le sujet avec les paroles de Jean-Louis Maubant, directeur de musée, critique d’art et d’architecture et Régis Neyret, journaliste lyonnais, tirées de l’ouvrage de Bernard Marrey, Les Ponts modernes :
Voilà donc Perrache exemple « archétypique » d’un urbanisme contraint et non totalement volontaire, et le projet initial, déplacé, rogné, dénaturé, pour aboutir à un programme assez rare : un Centre d’échanges avec commerces, desservant une gare ferroviaire, apportant un terminal métro, une gare routière, un parking de trois cent places, et des espaces verts en terrasse, remplaçant un vaste cours planté d’arbres comme un mail provençal.
Il fallait un architecte téméraire pour accepter des données aussi dangereuses. Or l’opinion ne pouvait juger que du résultat « urbanistique » : une gare engoncée, la liaison de part et d’autre des voûtes non résolue, et la perspective verdoyante du cours de Verdun perdue. Il eut fallu que les élus et les médias séparent deux pans d’une même réalité : la responsabilité d’un projet parfaitement absurde – faire passer l’autoroute Paris-Marseille au coeur de la ville de Lyon – est à mettre au compte du maire de l’époque, Louis Pradel, initiateur des travaux, et des services du Ministère de l’équipement. Quant à la réalisation elle-même, René Gagès a eu le mérite de concevoir une architecture qui n’a pas la raideur de ses fonctions, et qui, pourtant, répond le mieux possible à ses missions. Le Centre d’échanges a la force des oeuvres sans compromis.
3Sources3
Myriam Boyer, Delphine Favre, Pourquoi pas Perrache ? , Archives municipales, Lyon, 2002.
Jean-Pierre Gutton (dir.), Les Lyonnais dans l’histoire , Privat, Toulouse, 1985.
Henri Hours, Lyonnais célèbres : Tome II , Lyon Mag’s édition, Lyon, 1998.
Françoise Moiroux, De mémoire de presqu’île : Perrache XVIIIe-XXe , Lyon Confluences, Lyon, 2002.
Félix Rivet, Le quartier Perrache (1766-1946) : étude d’histoire et de géographie urbaines , Audin, Lyon, 1951.
A la recherche de la confluence
La localisation de la confluence principale fut l’objet de nombreuses recherches depuis le milieu du XIXème siècle et jusqu’à la fin du XXème siècle. L’archéologie locale est depuis longtemps fondée sur la conviction qu’une étude des deux fleuves qui traversent Lyon est déterminante pour tenter de comprendre l’implantation humaine sur le site. Si tous les auteurs s’accordent pour situer le lieu de confluence dans l’Antiquité quelque part au nord de l’actuelle place Carnot, sa position changera beaucoup entre l’hypothèse formulée en 1846 d’un bras situé au pied de la colline de la Croix-Rousse puis creusé et aménagé par l’homme, et la théorie présentée au milieu du siècle suivant selon laquelle un large bras du Rhône traversait la Presqu’île du nord-est au sud-ouest à l’époque celtique et isolait au sud « l’île d’Ainay. »
L’ouvrage dirigé par C. Arlaud, Lyon, les dessous de la Presqu’île (1), présente les tracés de ces hypothèses successives. A partir des années 1980, des méthodes de recherche s’appuyant sur les observations de plusieurs disciplines scientifiques et sur les fouilles de sauvetage opérées lors des travaux d’aménagement (notamment la construction du métro), ont montré la faiblesse des arguments présentés jusqu’alors. Les différents tracés élaborés depuis le siècle précédent présentent l’inconvénient de sous-estimer l’aspect dynamique de la plaine alluviale lyonnaise. La topographie de la Presqu’île, soumise à de forts mouvements des fleuves, s’avère beaucoup plus complexe qu’on ne pouvait le supposer. Lors de la construction du kiosque de la place Bellecour, des analyses ont mis en évidence les vestiges d’une crue de la Saône entre 40 et 60 ap. J.-C . dans une partie centrale de la Presqu’île, par exemple. Par ailleurs, aux éléments géomorphologiques s’ajoute l’influence humaine des populations qui ont colonisé puis tenté de maîtriser les rives tout au long de l’histoire.
3De la plaine inondable du début de notre ère…3
Le site de Lugdunum avant notre ère est constitué par une presqu’île sous la contrainte du Rhône et de la Saône. Progressivement, entre 450 et 50 av. J-C., le Rhône se retire sur sa rive gauche et ne s’infiltre plus qu’à travers d’anciens chenaux en cours de remblaiement naturel à l’occasion de crues assez fortes. Ce sont néanmoins ces chenaux – habituellement répartis en trois « bras » dénommés en fonction de leur emplacement : celui de la Bourse, celui de la République et celui de Bellecour – qui ont déterminé la topographie caillouteuse de ces terres abandonnées par le fleuve. On peut imaginer un paysage de lônes (les bras morts du fleuve qui s’est retiré) caractérisé par des ilôts inondables et en constante évolution, les fameux « brotteaux » dont quelques-uns se distinguent encore sur les cartes du XVIIIème siècle, et des étendues de « vorgines », lieux où poussent la « vorge », saule typique de cet environnement aquatique.
Dans le même temps, la Saône, jusqu’alors limitée au flanc de la colline de Fourvière, peut étendre sa rive gauche et commencer ainsi l’édification d’une nouvelle berge qui formera la limite de la Presqu’île. Lors d’une phase de répit, le site des Célestins redevient un milieu terrestre. Au début du Ier siècle ap. J.-C., les deux fleuves confluent à cet endroit à l’époque des hautes eaux et lors des crues du Rhône. Lorsque les cours d’eau sont à leur niveau le plus bas, les terres basses peuvent être fréquentées. Les bancs émergés offrent au moins un espace de circulation. Dès cette époque, des aménagements destinés à l’assainissement de ces terres gorgées d’eau sont entrepris par les hommes : ils viennent renforcer le remblaiement naturel qui comble tout ou partie des anciens chenaux. On a dégagé une couverture d’amphores imbriquées les unes dans les autres sous la rue Childebert (site de la République) : il apparaît qu’elles étaient destinées à assécher ce lieu inondable et marécageux probablement afin de ménager un lieu de passage, un « gué ».
3… à l’installation des premiers habitants3
Les Gallo-Romains accélèrent le comblement des chenaux : le bras de la Bourse est fermé vers le tournant de notre ère, celui du site République au milieu du Ier siècle, alors que celui de Bellecour draine encore les crues à la fin du Ier siècle. Par ailleurs, le dépôt d’alluvions fines contribue à élever les terres basses. Tout ceci conduit à une stabilisation de la Presqu’île qui adopte peu à peu sa forme définitive et semble à l’abri des crues à partir du IIème siècle. Au pied de Fourvière, la Saône se retire et dégage un espace colonisable. Son lit primitif sera peu à peu assaini par les hommes. L’ancien chenal ne sera définitivement remblayé, grâce à un apport massif de matériaux qu’à la fin du IIIème siècle. C’est là que s’installera dès le IVème siècle, sur la rive droite de la Saône, le nouveau lieu de pouvoir, la cité épiscopale, alors que l’habitat des pentes sera peu à peu délaissé. Sur la rive gauche du Rhône, c’est à l’approche du règne de Claude que seront aménagés des remblais caillouteux pour maintenir les espaces hors d’eau. Durant la deuxième moitié du siècle les crues ne pénètrent plus la bande de terre que par les bras de la République et de Bellecour qui marquent encore une dépression du terrain. En rive gauche de la Saône, la berge semble stabilisée au milieu du Ier siècle.
3Du côté des Terreaux : la reconversion d’un fossé bourbeux en siège du pouvoir3
A mi-distance des deux fleuves, ce site de « bas des pentes » est au contact de deux formations, la plaine alluviale et le plateau de la Croix-Rousse. Il a suscité de nombreuses interrogations : lieu de confluence, canalisation naturelle ou aménagée durant l’Antiquité ? Il est établi que la partie septentrionale de la Presqu’île a été colonisée au début du Ier siècle : aussi le processus de sédimentation naturel à l’œuvre au pied du plateau a-t-il probablement été relayé par un phénomène de comblement d’origine humaine en relation avec l’urbanisation croissante du plateau qui déstabilise les versants. Ces facteurs conduisent à une élévation du niveau du site qui permet de penser qu’il est de moins en moins vulnérable aux inondations et qu’il est probablement fréquenté par l’homme dès le règne d’Auguste comme ce fut le cas sur d’autres sites de la Presqu’île. Néanmoins le terrain reste boueux et traversé par des grands fossés, topographie qui donne son nom à la place actuelle : « Terreau » signifie « boue », « terre de remblai ». Au Moyen-Age, des remparts protègent, entre Saône et Rhône, la partie nord de la ville ; ils bordent ces fossés appelés « Fossés de la Lanterne » ou « Vieux Fossés ». A la Renaissance, les fossés s’envasent et ils sont transformés en un vaste dépotoir domestique et artisanal lorsque le processus naturel se ralentit. Entre 1540 et 1563 des travaux permettent d’achever le comblement et d’entreprendre un nivellement préalable à l’installation de commerces. Dès la fin du XVIème siècle et pendant le XVIIème la place s’urbanise : elle est pavée et lorsque le pouvoir municipal décide de quitter l’hôtel de la Couronne (actuel musée de l’Imprimerie) et de construire un nouvel Hôtel de Ville (1645-1651) à l’est, elle est définitivement consacrée centre de la vie administrative de la cité.
3Le reste de la Presqu’île : une lutte constante entre les hommes et l’eau3
L’île des Canabae
En s’appuyant sur les découvertes archéologiques, on a pu situer au sud des Terreaux une île délimitée au nord par un bras du Rhône orienté du nord-est vers le sud-ouest, c’est-à-dire de l’église Saint-Bonaventure jusqu’au nord de la place des Célestins. Deux inscriptions romaines ont permis de lui attribuer le nom d’île des Canabae, île des entrepôts. Elle se serait étendue de la place des Cordeliers jusqu’au sud d’Ainay. Dans la seule moitié sud de l’île, une cinquantaine de mosaïques atteste la activité d’un quartier très vivant pendant près de quatre siècles. Néanmoins certains historiens (C. Arlaud p. 265) estiment que ces découvertes ne suffisent pas à établir la certitude d’une urbanisation structurée à l’aide d’un réseau de voierie et d’un système d’égoûts. Ils formulent l’hypothèse d’un paysage semi-rural avec de vastes maisons et des entrepôts. On admet aujourd’hui l’idée d’un habitat continu, mais inégalement dense, entre la Croix-Rousse et Ainay, à partirdu IIème siècle et peut-être plus tôt.
Du Moyen-Age à la Renaissance
Malheureusement, la physionomie de la ville, et plus encore de la Presqu’île, reste mal connue pour la période qui s’étend du IVème au IXème siècles. Il semble qu’une reprise de l’activité hydrologique ait contraint les habitants à de constants travaux de consolidation, notamment lors de l’accroissement des précipitations qui caractérise le XIVème siècle. Une étude archéologique conclut : « Seules l’histoire et la volonté des hommes ont pu conquérir ces terres inondables faites d’îlots séparés de chenaux instables. Si les deux cours d’eau semblent aujourd’hui en symbiose dans la ville, c’est au prix d’incessants efforts des populations riveraines et de relations conflictuelles. La Saône sera la première intégrée, la première traversée par un pont au XIIème siècle et fixera le long de ses rives la ville médiévale. Cette dernière tournera le dos au Rhône, fleuve barrière, frontière, que le pont de la Guillotière franchira seulement à partir du XIIIème siècle. » (C. Arlaud, p. 264-265)
Il faut distinguer le développement du site du « Vieux Lyon » et celui de la Presqu’île. Alors que sur la rive droite de la Saône, dans le quartier Saint-Jean par exemple, les jardins disparaissent au profit d’immeubles avec cour qui ne tarderont pas à être surélevés, l’habitat sur la Presqu’île conserve encore de vastes espaces non construits en dépit d’un réseau de voies élaboré. Les sites de la Bourse et de la République par exemple offriront une image semi-rurale jusqu’au XVIème siècle. Le fameux « plan scénographique »
de la ville de Lyon établi vers 1560 figure bien ce contraste entre l’extrême densité des constructions au pied de Fourvière et une répartition de l’habitat qui garde les traces des métairies médiévales entre Saône et Rhône. L’expansion économique à la Renaissance modifie la physionomie de la ville : on compte au moins autant de travailleurs dans la soierie que dans l’imprimerie au milieu du XVIème siècle. C’est entre Saint-Nizier et Bellecour que se concentrent les deux tiers des bâtiments selon une trame d’ensemble qui n’est pas régulière. Il faudra attendre la fin du XVIIème siècle pour que des mesures d’alignement des maisons soient édictées par le Consulat. Par ailleurs, une bonne partie de la surface bâtie est consacrée aux communautés religieuses : en 1540, grâce aux dons des banquiers florentins établis à Lyon, a été édifiée l’église des Jacobins, derrière laquelle un vaste jardin, appelé « claustral », s’étend pratiquement jusqu’à l’actuelle place Bellecour. Le couvent des Célestins possède lui aussi ses propres jardins, et l’Hôtel-Dieu, fondé par les Frères Pontifes, a été agrandi au XVème siècle par le Consulat. Toute cette partie de la Presqu’île abrite plus d’installations religieuses que de commerces ou d’immeubles d’habitat. Plus au sud, à l’emplacement de la place Bellecour actuelle, un vaste espace de prairies et de jardins, encore assez marécageux, sert de pâture et reçoit à l’occasion des exercices militaires ou des parties de jeu de paume. Il appartient à l’abbaye d’Ainay auprès de laquelle s’établit la confluence, derrière le rempart qui se situait à l’emplacement des actuelles rues Bourgelat et des Remparts-d’Ainay. Construit par André d’Albon, sénéchal et gouverneur de Lyon, qui redoutait une attaque de Charles-Quint, le rempart a été en partie ruiné en 1610 puis reconstruit en 1626. Au-delà, les bras du fleuve dessinent plusieurs îles ou « brotteaux » dont le contour et la superficie varient en fonction des crues : l’île Mogniat, l’Asperge, la Marsauge,… Ces îles sont en partie cultivées, en parties consacrées aux pâtures ou laissées en « vorgines » : elles sont la propriété de l’abbaye d’Ainay dont la puissance est à son apogée du XIIème siècle à la première moitié du XVIème siècle.
Face à la pression démographique qui s’exerce sur la Presqu’île, le Consulat cherche à acquérir de nouvelles terres : les abbés d’Ainay, longtemps réticents, cèdent une première partie de leurs possessions en 1565. Ce sera le quartier d’habitation situé à l’est de la place Bellecour.
Les XVIIème et XVIIIème siècles et les premiers projets d’aménagement de la confluence
Le développement de la ville, tant démographique qu’économique, sur un territoire exigu, oblige la ville à croître en hauteur : les voyageurs de passage à Lyon sont frappés par la hauteur des immeubles, de 20 à 22 mètres en moyenne, ce qui reste important pour l’époque. La largeur des voies demeure souvent insuffisante et les descriptions de Lyon à cette époque laissent souvent apparaître l’effroi du visiteur devant la masse grouillante de la population qui se déverse dans les rues en sortant des demeures sombres où elle s’entasse. La traversée de la ville en est rendue périlleuse.
Au sud de la Presqu’île, les abbés d’Ainay, dont l’abbaye est sécularisée depuis 1565, se conduisent de plus en plus en marchands de biens et continuent à vendre des parcelles de territoire qui conduiront à l’aboutissement d’aménagements d’envergure : la création de la place Bellecour, puis l’urbanisation d’Ainay en bordure de la Saône et enfin l’implantation de nouvelles communautés religieuses à l’est de l’abbaye : dès 1615 saint François de Sales fonde le couvent de la Visitation ; au siècle suivant, les Jésuites implantent un établissement dédié au noviciat à l’emplacement des rues Victor-Hugo, Jarente et Sainte-Hélène.
Très tôt l’idée s’est imposée de modifier le site de la confluence qui avait du reste été réaménagé en un lieu de promenade prisé des citadins. Une description de 1741 (Clapasson, Description de la ville de Lyon ) évoque les agréables promenades que l’on peut effectuer en parcourant les allées de tilleuls qui surmontent le rempart : de là, l’un des « plus beaux points de vue du Royaume » s’offre au flâneur : « immédiatement au pied des murailles un vaste terrain s’étendait, le broteau ou grand pré d’Ainay […] ; au Sud, des bancs de sable couverts d’osiers et de saules, puis l’île Mogniat fertile et cultivée ; du côté du Rhône, plusieurs îlots, le pont de la Guillotière, la commune du même nom et la vaste plaine du Dauphiné jusqu’aux premières pentes des Alpes ; du côté de la Saône, la colline de Fourvière dominée par la petite chapelle de la Vierge, de splendides propriétés accrochées au coteau et séparées de la rivière par le chemin des Etroits ; sur la rive enfin, le pauvre village de la Mulatière et ses quelques maisons de pêcheurs » écrit F. Rivet (2), d’après Clapasson, dans Le quartier Perrache (1766-1946). Etude d’histoire et de géographie urbaine.
Selon ce même auteur, l’idée de reculer le confluent au-delà des deux fleuves était fort courante à l’époque : les délibérations municipales en témoignent. Le Consulat commença par acquérir la propriété des terrains situés entre les murailles et la Mulatière. Dès 1735, l’île Mogniat leur était cédée ; deux ans plus tard, l’abbé d’Ainay vendait à la Ville une place servant d’entrepôt pour les bois à bâtir, en dehors des portes, les jardins et les prés situés autour et en dehors des remparts ; en sus, les îles, îlots, graviers, ormes et tout le terrain qui appartenait encore à l’abbaye. Il faut dire que la « crise du logement » qui sévissait alors à Lyon était sévère : les communautés religieuses régulières et séculières occupaient les trois quarts de la superficie habitable vers 1740. Etablir des habitations sur la rive gauche du Rhône aurait nécessité la construction de quais et de ports trop coûteux et les pentes de la Croix-Rousse et de Fourvière semblaient trop abruptes pour y construire de grands immeubles. Seul l’aménagement de l’île Mogniat, que l’on relierait au préalable à la terre ferme, semblait une solution satisfaisante. Repousser le confluent permettait en outre de dégager un espace clair propice à la construction d’immeubles aux appartements vastes et lumineux, offrant de meilleurs conditions de travail aux ouvriers de la soie. Par ailleurs, ce quartier excentré pouvait accueillir nombre d’entrepôts et d’installations insalubres qui occupaient encore le cœur de la Presqu’île et incommodaient les habitants : tanneries, suiferies, triperies, etc . Pour autant, l’agrément n’était pas oublié, et les lointains prédécesseurs des architectes de la Confluence prévoyaient jardins et promenades pour le repos des lyonnais.
Mais il y a loin de la pensée aux actes. En 1741, Clapasson (cité par F. Rivet) le constate : « On prétendait, au moyen d’une forte digue, détourner le cours du Rhône et joindre cette Ile au rempart, on voulait se servir de cet espace pour y planter les chantiers de bois, les ouvriers en suif, ceux qui apprêtent les peaux, et tous les autres de cette espèce qui incommodent ou embarrassent le reste de la ville ; mais il paraît qu’on a perdu ce projet de vue. »
Cependant, plusieurs calamités naturelles, s’ajoutant au besoin de plus en plus criant de trouver des terrains où la ville puisse poursuivre son expansion, vont contraindre le Consulat à examiner quelques projets. En 1741, une crue particulièrement forte des deux fleuves a entraîné les moulins qui se trouvaient au large à cause des alluvions déposées sur les berges ; les bâtiments qui se trouvaient sur l’île Mogniat afin d’abriter les bestiaux et de loger les journaliers ont été emportés. Au cours de l’hiver 1765-1766, particulièrement rude, de la glace fait son apparition sur les fleuves : les moulins ne peuvent plus fonctionner et la ville doit faire face à de graves difficultés d’approvisionnement ; la débâcle détruira un grand nombre de ces installations. Il devient donc urgent de préserver l’île Mogniat des crues, de mettre les moulins à l’abri des inondations et par la même occasion d’étendre la superficie de la surface habitable. Un projet (resté anonyme) évoquait même la possibilité de regrouper les communautés religieuses d’un même ordre dans un seul bâtiment de manière à gagner de l’espace !
Un plan du célèbre Hardouin-Mansart à la fin du XVIIème siècle
Un plan d’aménagement très détaillé avait été déposé par Jules Hardouin-Mansart auprès du gouverneur de la ville bien avant ces événements, dès 1677. Il porte la marque des grands projets du célèbre architecte et étonne encore par ses intuitions de génie et l’équilibre global du projet. Sur le territoire d’un peu plus de 380 000 m2 obtenu après le comblement du bras qui séparait l’île Mogniat de la Presqu’île, seraient tracés des cours, des voies, des allées, des charmilles selon un plan rigoureusement symétrique, conformément aux réalisations de l’époque. Mais le trait de génie de l’architecte se reconnaît en ce qu’il prévoyait de faire du quartier une sorte de cité administrative où l’on trouverait le Palais de Justice, l’Hôtel des Monnaies, le Palais de l’Intendance, le Palais du Gouverneur ; à ces quatre édifices principaux s’ajouteraient le théâtre, la prison, l’Hôtel du Génie militaire, les bâtiment de la Milice, sans oublier un cirque, des bureaux militaires et de l’Intendance, les Archives, le Trésor, une caserne, la Bourse et un boulingrin, en somme tout ce que nous nommons aujourd’hui les « services publics », à côté des autorités. Bien entendu, des jardins ménageant de larges esplanades et de vastes perspectives agrémentaient les espaces de circulation entre les différents bâtiments et une puissante machine plongeant dans le Rhône devait alimenter parcs et immeubles en eau par le biais de cascades comparables à celles de Saint-Cloud, tout en assurant le fonctionnement de nombreux jets d’eau tant au milieu d’un vaste bassin central que dans les squares. Hélas ce projet grandiose ne recueillit pas l’assentiment des bourgeois prudents qui gouvernaient la ville. De toute manière, le budget municipal mis à mal par la reconstruction de l’Hôtel de Ville dévasté lors de l’incendie de 1674 ne permettait pas d’envisager une dépense aussi considérable.
Le projet de Guillaume Delorme
Soixante ans plus tard, en 1738, Guillaume Delorme présente au Consultat un projet bien différent, dont le principal objectif reste de « donner bien de l’aisance à cette ville » en créant des logements pour environ 10 700 personnes grâce à une centaine de maisons inspirées des « façades » de Bellecour. Le confluent devait être reporté au sud de l’île Mogniat à l’aide de deux larges chaussées. Un vaste bassin serait aménagé afin de recevoir les eaux du Rhône et de les restituer à la Saône : la différence de niveau était jugée suffisante pour entraîner les roues des moulins à blé désormais à l’abri des caprices des fleuves. Le plan n’oubliait pas la fonction industrieuse du quartier : des ateliers et des chantiers prendraient place autour du grand bassin. L’île Mogniat devait être réservée à l’agrément des promeneurs et Delorme ne cachait guère sa satisfaction : « … que de beautés à la fois ! L’Art et la Nature en auraient fait dans ce lieu le plus riche assemblage. On peut se les retracer, mais on ne saurait les écrire. » Toutefois, le projet parut encore trop coûteux à la Ville et aucune suite ne fut donnée. D’autres propositions connurent le même sort et le Consulat prorogea plusieurs fois la concession des terres au sud de la Presqu’île à un particulier, tant la réalisation d’un quartier semblait une perspective éloignée. On pouvait penser que certains aménagements récents auraient constitué une réponse provisoire aux besoins de logement de la population : c’était le cas des quartiers de la rue du Plat, de Bellecour, d’Ainay,… Mais ces espaces avaient été rapidement investis par des édifices publics et religieux, par des quais, des ports et des places, à tel point que sur une superficie totale de 499 000 m2, moins de 200 000 m2 pouvaient être affectés à l’habitat privé et à la petite industrie et dès cette époque, les trois quarts de cette aire étaient déjà pourvus. L’architecte Achard, chargé de la reconstruction de l’Ecole d’Equitation avec le célèbre Soufflot, proposa bien un projet envisageant la destruction de l’église d’Ainay et des remparts, la construction d’habitations et de quais bordés de plusieurs rangées d’arbres, mais cette solution s’avérait insuffisante pour résoudre les problèmes qui se posaient alors. Des nombreux projets qui précédèrent celui de Perrache, on peut néanmoins retenir que celui de Guillaume Delorme l’inspira directement, à tel point que certains aspects furent repris tels quels.
(1) Lyon, les dessous de la Presqu’île. Bourse, République, Célestins, Terreaux : sites Lyon Parc Auto. Sous la direction de Catherine Arlaud
(2) Le quartier Perrache : 1766-1946. Etude d’histoire et de géographie urbaines de Félix Rivet.
Voir aussi
Lyon : connaître son arrondissement. Le 2e : de Perrache à Bellecour, des Jacobins à Saint-Nizier , de Jean Pelletier.






















































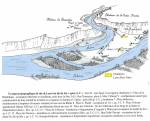









Partager cet article