Les Arts à l'œuvre à l'Université
Publié le 09/04/2007 à 23:00
-  10 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
10 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
L’Université a toujours été considérée comme un lieu de diffusion, de création, mais aussi de critique du savoir. Dès la fin des années soixante, le conformisme de cette dernière est dénoncé. En effet, l’université n’est pas génératrice de pratiques artistiques et ne parvient pas à combler la nécessité d’expression et de créativités des étudiants qui, pourtant, favorisent l’aisance culturelle. Depuis, les ministères de la Culture et de l’Education n’ont eut de cesse d’œuvrer pour la démocratisation culturelle par le biais de l’enseignement supérieur.
Les universités, en tant que lieux de productions et de transmissions des savoirs, ont cherché à s’emparer par des biais différents de cette mission de diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique. On remarque depuis plusieurs années l’affirmation de la présentation matérielle des savoirs, la volonté d’inscrire leur élaboration au sein de contextes et la création d’espace unique ouvert aux publics.
A Lyon, ce mois-ci, l’Université Lumière Lyon 2 et l’INSA-Lyon s’inscrivent toutes deux dans cette démarche et permettent à leurs étudiants, par le biais de la photographie et de la danse de développer leur imaginaire, de faire appel à leur culture, mais surtout de s’exprimer sur ce qui les entoure.
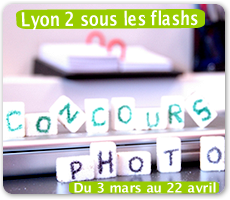
L’Université sous tous les angles
L’implication de l’Université Lumière Lyon 2 pour la valorisation de la création artistique est bien connue. Les étudiants sont sollicités régulièrement pour leur regard et leur talent de créateurs. Ce sont ces deux qualités que l’équipe du site web de l’université a souhaité exposer du 9 au 22 Avril par le biais d’un « concours photo ».
Le portail étudiant se caractérise habituellement par son contenu institutionnel et cette initiative est une première qui doit permettre de le dynamiser tout en offrant une nouvelle perspective aux projets culturels universitaires. Les étudiants, ainsi que le personnel, peuvent proposer à travers un ou plusieurs clichés des deux campus (Lyon et Bron), les différents aspects de « leur » université, un regard à la fois original et personnel sur les lieux qu’ils côtoient chaque jour et tenter de « capturer un moment de la vie du campus ». D’après Stéphane Massa-Bidal, l’un des instigateurs du projet, l’intérêt d’une telle démarche est d’encourager le personnel et les étudiants à envisager différemment cette architecture familière (marquée par des lignes et des courbes fortes) et à offrir au public une vision moins austère de l’Université. En effet, les photographies sont consultables en ligne au sein d’une galerie virtuelle et chacun peut voter pour l’interprétation des lieux qu’il préfère. Le nouveau visage de l’Université Lumière Lyon 2 le plus plébiscité sera exposé avec 29 autres clichés du 2 au 11 Mai 2007 au hall d’exposition de la Maison de l’Etudiant (Campus Porte des Alpes, Bron).
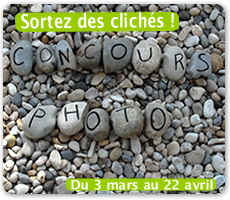
Voir… Vous trouverez sur ce site, le règlement du concours et un lien vers la galerie virtuelle. Cette dernière présente la totalité des clichés pris par les étudiants ainsi que le personnel de l’université : certains se présentent comme une réinterprétation de l’architecture, d’autres comme des instantanés de la vie universitaire. Elles ont pour point commun leur fraîcheur et leur spontanéité.
Voir… Il s’agit d’un reportage réalisé par l’équipe du concours présentant le travail d’une étudiante en Arts du Spectacle qui démontre combien ce projet tourne autour de l’architecture et des réflexions qu’elle engendre.
Danser l’Architecture
Le projet artistique élaboré par les élèves-ingénieurs de l’INSA-Lyon au travers de la danse s’inscrit aussi dans cette volonté de réappropriation de l’architecture par ceux qui l’habitent et la vivent au quotidien. Pour fêter le cinquantenaire de leur campus, les étudiants de la section Danse-Etudes ont donc crée « un environnement chorégraphique », nommé A Deux Pas, en collaboration avec la jeune chorégraphe Julie Desprairies qui s’est illustrée lors de la dernière Biennale de la Danse à Lyon.
Les étudiants ingénieurs ont appuyé leur travail sur les caractéristiques architecturales du campus dessiné par l’architecte Jacques Perrin-Fayolle, un ensemble uniforme du point de vue stylistique, dont les amphithéâtres constituent les volumes les plus originaux (dit « en selle à cheval »). Mais leurs talents ont aussi été sollicités dans d’autres domaines tels que les arts plastiques (photographies, fresques murales, installations vidéo) et la musique. En effet, les danseurs seront accompagnés par un orchestre symphonique, une fanfare et même des trios jouant des pièces musicales, contemporaines de la création du campus, de Györgi Ligeti. Les étudiants et le public pourront ainsi redécouvrir cette architecture par le biais des mouvements du corps à la fois artistiques et usuels révélant les usages divers des différents espaces ainsi que des points de vue ignorés, du 17 au 21 Avril 2007.
Voir… Cette page web présente la section Danse-Etude de l’INSA-Lyon et propose un lien vers le dossier de presse du spectacle A Deux Pas. Le projet et les moyens mis en œuvre pour le réaliser sont explicités. Des photographies des répétitions sont également disponibles.
Ces deux projets culturels nous donnent une idée des rapports qu’entretiennent aujourd’hui les arts, la culture et l’enseignement supérieur. La formation artistique à l’Université est considérée comme un vecteur essentiel de lien social et peut s’exprimer au travers de formes diverses. Cependant, la finalité reste toujours la même, celle de confronter l’homme à son environnement pour lui permettre de l’envisager sous des angles de perception différents.
Les arts et l’enseignement supérieur : une histoire
Pendant longtemps, l’Université a fonctionné selon une logique autarcique. Bien qu’elle soit le lieu privilégié de la connaissance, celle-ci se maintenait à l’écart du monde artistique. Pourtant certaines analogies sont possibles entre les artistes et les chercheurs universitaires dont l’intérêt est l’analyse et la remise en question du monde qui les entoure. Il est apparu qu’une certaine complémentarité pourrait naître d’une collaboration entre ces deux microcosmes.
Force est de constater que le rapport entre l’Université et la Culture est paradoxal. Il est nécessaire que la culture universitaire ne soit pas seulement la désignation des enseignements dispensés par les enseignants. En effet, la Culture joue un rôle social déterminant. Déjà en 1964, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans Les Héritiers, soulignaient la nécessité d’une formation culturelle encadrée dans les universités, car, “ en l’absence d’un enseignement organisé, les comportements culturels obéissent aux déterminismes sociaux plus qu’à la logique des goûts et des engouements individuels ”. L’éducation artistique doit ainsi former des citoyens curieux de leur environnement.

Les Héritiers, par Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON, Mouton Cette étude, connue et reconnue, a été réalisée en 1964. Elle démontre, notamment les inégalités que développe le système universitaire qui conditionnent l’aisance culturelle et la réussite scolaire des étudiants.
Suite au rapport Domenach de 1983, qui présentait l’Université comme un « désert culturel », la Loi Savary de 1984 a confié aux établissements d’enseignement supérieur une mission de « diffusion de la culture » et de soutien à la « création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques ». En 1988, la déclaration du Musée d’Orsay dirigée par Jack Lang et Lionel Jospin entraine dans les années qui suivent les premières conventions entre le Ministère de la Culture et les établissements. Ainsi, les institutions s’engagent à encourager les échanges ainsi que les coopérations entre les universités et les établissements culturels, les étudiants et les professionnels du monde l’art et d’ouvrir l’ensemble des formations universitaires à des pratiques culturelles et artistiques. De cette façon les projets des étudiants et leurs démarches associatives seront valorisés, de même que le patrimoine culturel des universités. La Culture doit permettre un rayonnement de ces dernières, ainsi qu’une ouverture sur leur environnement.
A l’INSA-Lyon, notamment, les formations Arts-Etudes ont été créées dans ce cadre à la fin des années 80. Les activités culturelles doivent désormais contribuer à la formation générale des étudiants en leur offrant une ouverture au-delà de leurs enseignements scientifiques. Ces derniers sont alors confrontés à des modes de réflexions différents grâce à l’intervention de professionnels de l’Art. Le rayonnement culturel de ce campus offrent aux futurs ingénieurs une formation complète, diversifiée et enrichissante.
Voir… Extraits de la Loi Savary de 1984
Pour aller plus loin :
Une association, A+U+C (Art+Université+Culture)
En 1990, à Villeneuve d’Ascq, l’association A+U+C a été créée sous l’impulsion de défenseurs de l’action culturelle à l’Université. La vocation de cette dernière est de croiser les idées et les expériences des différents acteurs afin de promouvoir idéalement l’action culturelle dans les établissements d’enseignement supérieur. Les membres de l’association mènent leurs réflexions ainsi que leurs actions par le biais de commissions ou de colloques avec la participation de nombreux adhérents, dont l’Université Lumière Lyon 2 et l’INSA-Lyon. Les objectifs sont de déterminer les enjeux d’une politique culturelle dans l’enseignement supérieur, de créer des partenariats, d’envisager la construction de lieux dévoués à la culture sur les campus ou de créer des outils pour la prise en considération des activités culturelles et artistiques au sein de la formation universitaire des étudiants.
Malgré, les lois établies dans les années 80, les rapports entre les arts et l’Université doivent être sans cesse repensés. En effet, le partenariat de plusieurs acteurs nécessite une organisation et un dialogue. Ainsi, l’A+U+C se conçoit comme un relais entre les universités, les partenaires culturels et les ministères. Elle permet surtout une mise en commun des idées, des exigences et des attentes de chacun afin de trouver des compromis satisfaisants.
Voir… Le site propose tout autant une présentation de l’association, que les éditos de la revue qui lui est attachée. Une partie est consacrée aussi aux textes officiels et aux projets qui ont été menés.
Art, Architecture, Université : une nouvelle approche de la vie étudiante
Les rapports entre les arts et l’Université passent nécessairement par l’architecture. En effet, il n’est pas envisageable de créer une ferveur créatrice chez les étudiants, si aucun lieu n’est dévolu à leurs pratiques culturelles. La mise en place des services culturels pour encadrer et stimuler ces activités est marquée par cette idée. L’action culturelle universitaire se définit principalement dans les liens qu’elle crée avec son environnement. L’histoire inscrite dans les murs engendre nécessairement une combinaison féconde avec la pratique artistique des étudiants.
De cette manière, il est possible de considérer que la culture permet aux universités de s’épanouir au sein de leur environnement ce qui justifie la nécessité de créer un projet culturel pour chacune d’entre elles. Cette implication passe par la mise en place d’enseignements artistiques qui aboutiront à une valorisation des œuvres présentées au sein du campus qui seront l’expression même de l’acte créateur des étudiants. Enfin, pour parfaire cette initiative, la stimulation du désir de culture passera aussi par un élargissement du public et une approche pédagogique.
Les établissements d’enseignement supérieur doivent donc apprendre à se connaître, à maîtriser leur espace et à offrir cette possibilité aux étudiants. Comme l’écrit Claude Patriat, « aller à l’université n’est pas seulement se rendre à un cours, c’est fréquenter aussi un lieu, y épouser des trajectoires d’un moment à l’autre. Vivre l’université c’est habiter un endroit même éphémèrement, même transitoirement. La qualité de la vie ne peut résulter exclusivement de l’ambiance d’un amphithéâtre ou d’un cours, elle naît de l’épaisseur des relations qui s’établissent quotidiennement à l’intérieur des groupes. »

Le 1% culturel à travers les constructions universitaires, Fabienne CHANCRIN, Les Presses du réel Ce livre se présente comme un bilan d’initiatives passées qui offre, ainsi, de nouvelles perspectives pour l’avenir. L’auteure s’interroge sur les moyens qui permettront aux universités, par le biais de l’architecture, de servir davantage les arts et la culture et d’offrir un confort pour les usagers des campus universitaires.

L’éloge de la perturbation, par Claude PATRIAT, Les Presses du réel Claude Patriat est l’un des fondateurs de l’association A+U+C. Il traite dans cet ouvrage de la « perturbation » positive dont les universités françaises ont besoin afin de rayonner culturellement sur leur environnement. La Culture doit permettre à l’Université de révéler son excellence et d’instaurer une nouvelle égalité des chances.
L’Université Lumière Lyon 2 ainsi que L’INSA-Lyon nous offre une double possibilité. Tout d’abord, l’exposition ainsi que la chorégraphie de Julie Desprairies retranscrivent l’épanouissement créatif d’étudiants, qui prouvent le bien fondé d’une union entre les arts et les établissements d’enseignement supérieur. Ensuite, le regard et les mouvements des usagers des campus au sein même de l’architecture, nous invitent à redécouvrir, appréhender, habiter l’Université. Paul Valéry lui-même a traité de cette idée selon laquelle l’architecture est élaborée comme un vecteur d’émotions provoquant chez son contemplateur des frissons de l’âme. Les usagers doivent se mouvoir dans l’espace afin de ressentir toutes les subtilités du lieu, les charges émotionnelles, l’histoire, la culture induite par l’œuvre. Pour ces raisons, Phèdre rapporte les propos d’Eupalinos selon lequel :« les bâtiments qui ne parlent ni ne chantent ne méritent que le dédain ».

Eupalinos ou l’architecte, Paul VALERY, Ed. de la N.R.F. Le dialogue qui oppose Phèdre et Socrate évoque l’architecte Eupalinos. Ce texte permet à Paul Valéry d’exposer son point de vue sur la technique architecturale, amis aussi sur l’esthétique du bâtiment. Au final, le prétexte de l’architecture sert ses réflexions philosophiques sur le pouvoir de la création artistique qui permet à l’être humain se se transcender.










Partager cet article