A Lyon, les sites de la Biennale d'Art Contemporain s'exposent
Publié le 26/09/2007 à 23:00
-  22 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
22 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux

- Biennale 2007
1 – BAC 2007 : les règles du jeu
2 – 1976-2005 : L’art contemporain s’ancre à Lyon
3 – Des lieux d’expo pas comme les autres
@ Et Lyon créa son Musée d’art contemporain
@ La Sucrière met son grain de sel dans l’art
@ L’IAC rejoint la bande de la Biennale
@ Fondation Bullukian, les mécènes s’installent place Bellecour
1 – BAC 2007 : les règles du jeu
La BAC 2007 est le troisième opus d’une réflexion sur la temporalité engagée en 2003 avec « C’est arrivé demain » et poursuivie par « L’expérience de la durée » en 2005. Pour « OO’s L’histoire d’une décennie qui n’est pas encore nommée », les commissaires d’exposition Stéphanie Moisdon et Hans Ulrich Obrist remettent les compteurs à 0 et tentent de définir qui sont les artistes essentiels des années 2000.
Pour cela, la Biennale prend la forme d’un grand jeu, avec à la clef, la désignation d’équipes gagnantes, l’une par un jury international, l’autre par les Internautes. Deux cercles de joueurs sont en effet en concurrence artistique. Dans le premier, chaque « curator » (49 au total), éminent critique ou commissaire international, a nommé l’artiste qui, à ses yeux, représente la décennie. Dans le deuxième cercle, 20 artistes (écrivains, architectes, graphistes) réalisent directement une œuvre symptomatique du temps présent. Michel Houellebecq et le chorégraphe Jérôme Bel ont ainsi joué le jeu. Dans les deux cas, chaque œuvre est accompagnée d’un texte du joueur qui justifie son choix.
Au final, la grande majorité des artistes programmés sont de jeunes inconnus, exposés pour la première fois lors d’une manifestation culturelle d’envergure internationale. La Biennale de Lyon se situe en effet dans les dix premières biennales d’art contemporain mondiales. Elle atteint une fréquentation digne des grandes expositions internationales (173 000 visiteurs en 2005).

- Inauguration de la
Biennale d’art contemporain 2007
par la ministre de la Culture Christine Albanel - © G. Rouillon
La biennale d’art contemporain, comme celle de la danse, est fortement soutenue par le mécénat, qui apporte 15% du financement. De grandes entreprises sont présentes depuis le début, rejointes désormais par des PME et PMI. Tous ces mécènes culturels se retrouvent au sein du Club des partenaires de la biennale, créé en mai 2007, qui permet des moments privilégiés de visite.
Mettant l’art contemporain à l’honneur, les parties de jeu se déroulent dans quatre lieux répartis dans Lyon. Une navette fluviale fonctionne les week-ends entre le Musée d’Art Contemporain, la presqu’île et la Sucrière. A vos marques ! Jouez !
Tous les renseignements pratiques et artistiques sur le site de la BAC 2007
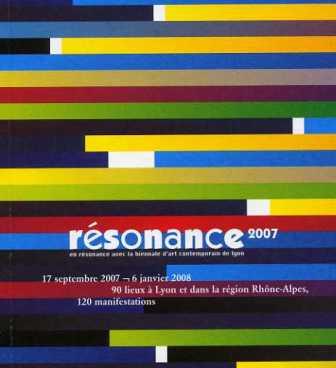
- Résonance 2007
La Biennale se décline également dans toute la région Lyonnaise avec les 80 manifestations de Résonance 2007 : danse, performance, théâtre, photographie, littérature, musique… Programme à consulter en ligne ou à la bibliothèque.
Et au niveau international, la BAC de Lyon s’associe avec deux autres consoeurs automnales pour donner Très Bienn. La collaboration entre les Biennales de Lyon, d’Athènes et Istanbul favorise les échanges culturels et la visibilité commune.
1ère Biennale d’Athènes : 10 sept. – 18 nov. 2007
10ème Biennale internationale d’Istanbul : 8 sept.-4 nov. 2007
Références bibliographiques
:: La BAC montre ses muscles. Lyon Capitale, 18 septembre 2007
:: Comprendre la Biennale. Le Progrès, 19 septembre 2007.
:: Un club pour les Biennales de Lyon. Le Tout Lyon en Rhône-Alpes, 28 juillet 2007.
2 – 1976-2005 : L’art contemporain s’ancre à Lyon
Temps fort de la vie culturelle lyonnaise, la Biennale d’Art contemporain est le symbole de la progressive implantation de l’art contemporain dans la ville. Au début des années 70, les institutions locales ne s’intéressent guère à la production artistique contemporaine. La naissance de l’Espace lyonnais d’art contemporain (ELAC) en 1976, situé au sommet du centre d’échanges de Perrache, permet d’initier son introduction.
En 1983, Thierry Raspail est nommé conseiller pour l’art contemporain dans la ville, avec la mission d’enrichir les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon par l’acquisition d’œuvres récentes. Un an plus tard, s’ouvre la section « Saint Pierre Art contemporain » et débute le 1er « Octobre des Arts ». Cette préfiguration de la Biennale fait découvrir des artistes au musée mais aussi dans les galeries et espaces culturels publics.
Progressivement, la collection du Musée des Beaux-Arts s’étoffe et permet la création d’œuvres qui n’auraient pu voir le jour sans son soutien financier et logistique. Le manque de place et le désir d’identifier nettement cette collection se font sentir et trouvent un écho auprès des institutions. En 1988, la section d’art contemporain devient un musée indépendant, par accord de la Ville et de la direction des Musées de France. 1988 est également une année de transformation de l’édition d’octobre des arts. L’évènement propose un contenu thématique homogène, « La couleur seule », et rencontre le succès auprès des Lyonnais.
Manifestation organisée désormais tous les deux ans, dotée d’un projet clair et profitant de l’élan donné par la décentralisation, la 1ère Biennale d’Art Contemporain de Lyon naît grâce au co-financement de l’Etat et de la Ville. Du 3 septembre au 13 octobre 1991, L’Amour de l’Art transforme les anciens abattoirs de la Halle Tony Garnier en gigantesque étal d’exposition de la production artistique. Et c’est l’affluence : en 40 jours, 73000 personnes viennent voir le regard des artistes qui témoignent de la vitalité de l’art contemporain.
La Halle Tony Garnier est à nouveau l’immense écrin, fréquenté par 89000 visiteurs, de l’édition « Et tous ils changent le monde » : 3 septembre au 13 octobre 1993.
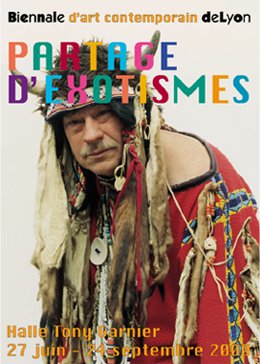
- 5ème BAC (2000)
En 1995, Interactivité (20 décembre 1995 – 18 février 1996) bénéficie de l’inauguration les locaux du Musée d’Art Contemporain (MAC) pour se délocaliser à la Cité Internationale. Puis c’est le retour à la Halle Tony Garnier, fraîchement rénovée, pour les deux éditions suivantes de la biennale d’Art contemporain : L’Autre (9 juillet 1997 – 24 septembre 1997) et Partage d’exotismes (27 juin 2000 – 24 septembre 2000). La 5ème Biennale avait été exceptionnellement repoussée de 1999 à 2000 pour enrichir les évènements du passage au nouveau millénaire.
La 6ème édition reprend sa tradition d’organisation les années impaires, ce qui lui laisse moins de temps de préparation et la transforme en biennale de transition. Les quatre mois de Connivence (23 juin au 23 septembre 2001) connaissent donc un succès mitigé alors que la biennale a définitivement quitté la halle Tony Garnier et s’est ouverte (dispersée selon certains ?) dans 3 lieux d’exposition : le Musée d’art contemporain, l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or et les Subsistances. L’évènement est critiqué et le risque de transfert vers une autre commune menace les organisateurs.
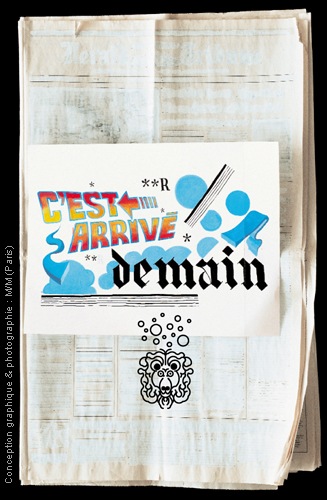
- 7ème BAC (2003)
La survie de la Biennale d’Art contemporain est donc liée au succès de la 7ème édition et C’est arrivé demain remporte le pari de la qualité.
Venu la visiter, le ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon confirme la réussite et la pérennité de l’évènement, à la hauteur de son nouveau label de « Biennale française ». Du 18 septembre 2003 au 4 janvier 2004, 130000 visiteurs environ fréquentent ses 5 lieux d’exposition. La Biennale s’épanouit ainsi sur l’ensemble de l’espace urbain de Lyon (Musée des Beaux-Arts, MAC, Rectangle -au cœur de la place Bellecour- et Sucrière du Quai Rambaud) et de Villeurbanne (Institut d’Art Contemporain). Le cheminement au sein de la cité est d’autant plus agréable qu’une navette fluviale permet de joindre le Confluent, le quai Gailleton et le quai Charles de Gaulle, pour desservir les trois sites à proximité.
Le partenariat avec des lieux symboliques lyonnais se poursuit lors de L’Expérience de la durée (14 septembre – 31 décembre 2005), quand le Musée des Beaux-Arts cède sa place au Fort Saint-Jean, sur les pentes croix-roussiennes surplombant la Saône. Et cette tradition se poursuit avec l’édition actuelle puisque, parmi les 4 places retenues, la Fondation Bullukian est la nouvelle (bien)venue.
Références bibliographiques :
:: L’art contemporain, oui, par Bernadette BOST. Le Monde, 16 décembre 1995, p. 14
:: Une connivence en demi-teinte. Le Progrès, 16 septembre 2003.
:: Jean-Jacques Aillagon : « Le pari de la biennale est gagné ». Le Progrès, 17 septembre 2003.
:: C’est arrivé demain : une biennale aujourd’hui, Le Progrès, 16 septembre 2003, p. 15 Entretien avec Thierry Raspail, directeur artistique de la biennale, sur le nouveau départ de la 7ème édition.
::Portail des deux biennales de Lyon, regroupant les sites de la BAC depuis 1995.
3 – Des lieux d’expo pas comme les autres
La 9ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon s’offre aux regards de tous du 19 septembre 2007 au 6 janvier 2008, dans 4 lieux disséminés dans la ville. Au-delà des œuvres artistiques qu’elle permet de voir, elle suggère un parcours urbain et rend possible la (re)découverte de 4 sites emblématiques locaux : le Musée d’Art Contemporain, la Sucrière, l’Institut d’Art Contemporain et la Fondation Bullukian.
@ Et Lyon créa son Musée d’Art contemporain
Le Musée d’art contemporain de Lyon (MAC) est la pierre angulaire de l’organisation de la biennale d’art contemporain. Son responsable, également directeur artistique de la biennale, est à l’initiative de la manifestation. Thierry Raspail, conservateur de la première section d’art contemporain de Lyon devient le directeur du MAC à sa création en 1988. Il est tout d’abord un conservateur « sans murs » : les collections sont hébergées dans une partie vacante du Palais Saint-Pierre. Le musée d’art contemporain existe cependant par la vitalité de ses expositions. La municipalité ne prévoit pas de présentation permanente des collections dans un lieu unique mais des rotations permanentes de collection, comme autant de parcours dans la ville.
Dans les années 90, l’absence de structure dédiée pour accueillir l’art contemporain est le cœur d’une véritable polémique culturelle, d’autant plus que sa création est évoquée depuis une décennie. De nombreux lieux, cités de manière plus ou moins réaliste, complètent la liste des sites amenés à soutenir ses fondations : galeries des Terreaux, Subsistances, halle Tony Garnier, Nouveau Musée agrandi. Les décideurs politiques semblent freinés par le risque de désintérêt du public et la concurrence des autres musées. Outre le Nouveau Musée, la région Rhône-Alpes possède en effet deux fleurons de l’art moderne, doté de collections contemporaines, à Grenoble et Saint-Etienne.
:: La question du Musée d’art contemporain, Lettre-Association des critiques d’art d’art lyonnais, n°3, mars 1991.
En plein débat, l’ACAL aborde les enjeux des musées d’art contemporain, avec, en toile de fond, le cas de la création envisagée du MAC de Lyon. Interventions et avis contrastés des directeurs et critiques régionaux : B. Ceysson, Jean-Louis Maubant, Régis Neyret . Thierry Raspail est interviewé sur la situation lyonnaise, inchangée en 1991.
Thierry Raspail est finalement récompensé de sa patience : la pose de la première pierre de l’édifice a lieu début novembre 1994, au sein de la Cité internationale naissante. Conçue par le génois Renzo Piano comme le prolongement du parc de la Tête d’or vers le Rhône, elle reconquiert un espace jadis occupé par les Palais de la Foire, qui accueillaient notamment la Foire internationale. L’ensemble, palais et pavillons, sont élevés entre 1918 et 1928 sur les plans de Charles Meysson. La Cité revitalise cette zone et symbolise l’ouverture internationale de l’agglomération.
A proximité des bureaux, d’Interpol, de logements et d’hôtels luxueux, le musée appartient au pôle culturel, avec le multiplexe de cinéma qui lui fait face.
Renzo Piano explique sa logique de création : « Mélange de modernité » et de « tradition architecturale », le Musée ressuscite l’atrium, seul édifice conservé de l’ancien Palais de la Foire et est « doublé d’un bâtiment neuf ». « La partie ancienne [s’ouvre] sur le parc de la Tête d’Or, la construction neuve sur l’allée couverte, sorte de colonne vertébrale de la Cité internationale ». L’architecte reprend la tradition des traboules lyonnaises, en permettant la traversée de l’édifice par un passage qui permet d’entrer et sortir d’un coté comme de l’autre.
De plus, l’agencement intérieur des 3 niveaux de salles d’expositions (2620 m3) est réalisé pour une mobilité permanente des collections. Le système retenu permet de construire des murs autour des œuvres, avec une infinie de mises en scène possibles.
L’inauguration du Musée correspond avec l’ouverture de la 3ème biennale d’Art contemporain, le 19 décembre 1995, ce qui donne vie au quartier, encore peu animé à l’époque. Fidèle hébergeur de la biennale sans discontinuité depuis la 6ème biennale, sortant des ses murs en de nombreuses occasions, le MAC s’offre à la visite pour cette nouvelle édition, avant de poursuivre sa programmation d’expositions tout au long de l’année.
:: Musée d’art contemporain de Lyon : le musée côté Rhône, le musée côté parc
Fiche technique du Musée, vision de son architecte Renzo Piano, maquettes, plans et présentation des collections et des expositions depuis 1984.
:: Le Musée d’Art Contemporain de Lyon à la Cité internationale, Revue du Louvre, Février 1996.
Le musée, son histoire et ses collections, synthèse vue par son directeur Thierry Raspail.
@ La Sucrière met son grain de sel dans l’art
Quand la Sucrière héberge la Biennale à partir du 2003, c’est le point d’orgue de la reconversion du port Rambaud, en nouveau pôle de la vie culturelle lyonnaise. La réhabilitation des docks des quais de Saône, ayant cessé toute activité depuis 1994, est l’objet de la première phase du grand projet d’aménagement urbain du Confluent. Valorisation du patrimoine industriel, le chantier a comme particularité l’implication de Voies Navigables de France (VNF), gestionnaire des lieux.
La cible prioritaire de la rénovation est l’entrepôt vétuste de la Générale Sucrière, contruit dans les années 1930 et agrandi en 1960. 900000 euros sont consacré à l’aménagement du site (7000 m²) demeuré désaffecté pendant 10 ans et revenu sous les feux des projecteurs lors de la Fête des Lumières en 2002. La Ville poursuit la mise en valeur nocturne du site en l’incluant dans le plan Lumière. Un éclairage particulier est élaboré, dans l’esprit de l’usine Lu de Nantes, et compatible avec la mise en lumière de la Biennale.
Grâce aux biennales et autre évènements, les Lyonnais retournent régulièrement se promener sur les docks. Les visiteurs pénètrent dans la Sucrière par les anciens silos, suivant le chemin emprunté autrefois par les arrivages de sucre. Désormais, la matière première qui circule est l’art, et les amateurs n’en sont pas moins gourmands.
@ L’IAC rejoint la bande de la Biennale
C’est en 2003 que l’Institut d’Art Contemporain se joint aux lieux d’exposition qui accueillent la Biennale d’Art Contemporain. L’alliance ne s’est pas défaite depuis, même après un changement de direction en 2006 quand Jean-Louis Maubant cède son poste à Nathalie Ergino. Une page se tournait alors pour l’IAC. Jean-Louis Maubant a en effet marqué le terroir artistique lyonnais en étant le premier directeur de l’Espace Lyonnais d’Art Contemporain en 1976. Remercié au bout de deux ans, il poursuit sa quête en fondant le Nouveau Musée de Villeurbanne en 1978. Les bâtiments confiés par la Ville permettent la valorisation d’un édifice dont les plans datent du temps de Jules Ferry (1879) : le « groupe scolaire de la Cité Lafayette ». Le personnel du Musée et les artistes de passage prennent donc leurs aises dans les différentes salles des écoliers (filles et garçons séparés) et leur préau, l’ensemble étant rénové en 1992.
L’Institut d’Art Contemporain naît en 1997 de la fusion du Nouveau Musée et du FRAC Rhône-Alpes (1982). Il a désormais la double mission d’organiser des expositions temporaires dans ses murs (1500 m²) et de constituer et conserver une collection d’art contemporain pour la diffuser dans la région Rhône-Alpes.
:: Le nouveau Musée, forage off shore dans la région lyonnaise, par Jean-Louis Maubant (1982).
La genèse du Nouveau musée, vue, avec du recul, par son fondateur et directeur.
:: L’Institut d’art contemporain change de tête, La Tribune de Lyon, 21 juillet 2006, p. 36-37 : passage de relai à la direction de l’IAC entre J.-L. Maubant et Nathalie Ergino.
@ Fondation Bullukian, les mécènes s’installent place Bellecour
Bien qu’encore peu connu des Gônes, Napoléon Bullukian est l’une des grandes figures du milieu économique lyonnais des années 1950-80.
La fondation Léa (sa femme) et Napoléon Bullukian est créée après la mort de ce dernier, le 12 avril 1984, des suites d’un cancer. L’ancien industriel avait fait de la Fondation de France son légataire universel, dans le but de créer une fondation répondant à une triple vocation : encourager la recherche médicale et en particulier la lutte contre le cancer, participer aux œuvres sociales et d’entraide de l’église arménienne, enfin, encourager les jeunes artistes.
En 1996, la fondation intègre la Maison des écritures, au 26 place Bellecour, en tant que lieu d’exposition, auquel s’ajoutent en 2006 les bureaux administratifs. Son premier président est le célèbre chirurgien le Pr Pierre Marion, ami de la famille. Ce lieu de création, devenu « Echanges Culturels Bullukian » accueille l’art dans toute sa diversité (expositions d’arts plastiques, rencontres scientifiques ou sociales…) et s’investit dans le mécénat culturel. En 2007, la Fondation Bullukian, reconnue d’utilité publique depuis 2003, mène une campagne de sensibilisation pour réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’une œuvre de Nicolas Poussin. L’opération permettra, à court terme, l’accrochage du tableau au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Le chemin de la Fondation croise donc celui de la 9ème Biennale, pour laquelle elle accueille des projections vidéos et dont le jardin héberge une installation.
:: Napoléon Bullukian : de l’Ararat à Napoléon, autobiographie.
:: L’exceptionnel destin de Napoléon Bullukian.
Ces deux ouvrages permettent de mieux connaître le parcours atypique de Napoléon Bullukian (1905-1984). Seul membre de sa famille rescapé du génocide arménien, il est vendu comme esclave chez les Kurdes. En 1923, il arrive en France et devient progressivement un puissant bâtisseur et entrepreneur lyonnais.
:: Mort et succession de Napoléon Bullukian. In : Lyon, le sang et l’encre par Pierre Mérindol (1987).
Sa succession est accompagnée d’un ensemble de tribulations : pressions, changement de testament, déshéritage. Quand la réalité ressemble à un polar…
:: LaMalmaison : …à la mémoire de Napoléon Bullukian réalisé par Philippe Roger (1924)
Mécène, Napoléon Bullukian appréciait l’art. Les vues de LaMalmaison et de ses collections restituent l’atmosphère de la demeure du collectionneur, située à Champagne au Mont d’Or.
4 – Quand l’art prend l’air
La Biennale d’art contemporain et ses déclinaisons sont l’occasion de faire entrer l’art contemporain dans le paysage urbain. L’art sur la place, la Biennale des Lions et le « flower-Tree » en sont des concrétisations.
@ Une expérience unique en France : l’Art sur la place
Depuis 1997, la Biennale accompagne l’Art sur la place tous les deux ans en permettant la création collective et la rencontre de personnes de générations, de cultures et d’origines sociales diversifiés. La manifestation, alternativement associées à la biennale et au Musée d’art contemporain, prend forme pour la première fois sur la place Bellecour où 15 couples habitants-artistes créent pendant une journée une réalisation collective éphèmère.
L’évènement se déroule en plusieurs temps : 8 mois d’atelier pour faire émerger une œuvre en lien avec le thème de la biennale, quelques jours d’exposition dans les rues de Lyon et un retour festif dans la ville ou le quartier qui a vu naître chaque création.
Partie intégrante de la politique de la ville, les œuvres nées de l’Art sur la place sont le résultat de la collaboration entre un artiste et un groupe de bénévoles amateurs, soutenus par un porteur de projet (équipement culturel ou social). L’organisation de la manifestation relève de la responsabilité d’un Comité de pilotage réunissant la Biennale d’Art Contemporain et les partenaires publics de la manifestation. Ce comité sélectionne et finance une dizaine de projets régionaux sur la base d’un appel à projets précédant d’un an la Biennale.
L’art contemporain : champs artistiques, critères, réception.
En octobre 1998, un colloque est organisé au Musée d’Art Contemporain de Lyon, en collaboration avec l’observatoire des pratiques culturelles. Les douze projets artistiques de l’Art sur la place 1998 sont présentés et ce processus de création qui transforme la ville en atelier fait l’objet de réflexion. Pour Thierry Raspail, c’est un moment fort associant créativité et partage et cette « mise à disposition partagée d’expériences, de techniques, de regards » (…) « rompt avec l’exercice solitaire de la création plastique en atelier ». L’artiste se fait alors « ensemblier ».
En 2003 et 2005, l’Art sur la place fait halte rue de République, sous la forme de bus transformés en expositions urbaines par autant de groupes d’artistes.
Le site Art sur la place 2005 permet de retrouver, via les reportages photographiques, les participants à l’œuvre tout au long du processus de création artistique et de voir les bus-oeuvres exposés et visités.
-En 2007, c’est un nouveau dispositif de recherche et d’expérimentation qui prend la place : Veduta. Nouvelle occasion de partage de la création contemporaine, elle aboutit à l’exposition des productions des artistes sur la place des Terreaux, les 13 et 14 octobre 2007.
@ Les lions sont lâchés
Deux autres manifestation ont fait prendre l’air à l’art contemporain et aux Lyonnais curieux : la Biennale des Lions de 2006 et son précurseur de 2004, l’événement « 60 lions, 60 lieux, 60 artistes ». Les deux « safaris » furent un succès public et les déambulations furent nombreuses pour repérer tous les animaux en liberté dans Lyon.
Plus d’infos sur les deux manifestations dans Biennale des lions 2006
@ La fleur de l’art
Voilà un arbre qui fait parler de lui ! Le « Flower-Tree » du coréen Jeong Hwa Choi est ré-installé sur la place Antonin Poncet. Le bouquet de fleurs, plébiscité par les Lyonnais lors de la Biennale 2003, est vite regretté lorsqu’il poursuit son parcours d’œuvre d’art au fil des expositions. La Ville de Lyon décide donc en de l’acquérir en juillet 2006, de lui « rafraichir » les pétales et de replanter à son emplacement d’origine lors de la biennale 2007. Toutefois, l’Architecte des Bâtiments de France n’en démord pas, l’arbre ne peut rester là car il gène la perspective du quai. Reste à savoir où l’œuvre multicolore ira s’enraciner ultérieurement.
Face aux berges, l’arbre à fleurs est revenu… en cage. Le Progrès, 12 septembre 2007 et autres articles consultables à la bibliothèque.
Pour poursuivre la lecture sur ce sujet :
:: Les articles de presse sur la biennale d’art contemporain, les artistes, les oeuvres exposées, les lieux d’accueil et sont consultables à la bibliothèque, sous la forme papier ou numérique : les dossiers de presse et Le Progrès en ligne via Europresse.
Qu’est donc devenu le bouquet de fleurs (Flower Tree) des quais du Rhône ? Voir
Qui est Napoléon Bullukian ? Voir
Quel est le prix d’une oeuvre de S. Tunick, qui a dénudé les Lyonnais en 2005 ? :
Voir



























Partager cet article