Souvenirs de l’École de tissage de Lyon
Témoignages d'anciens élèves et professeurs
Publié le 28/06/2025 à 15:21
-  12 min -
Modifié le 04/07/2025
par
bmichel
12 min -
Modifié le 04/07/2025
par
bmichel
L’exposition « Des motifs qui habillent : fragments d’architecture par Nicolas Fussler & échantillons de l’École de tissage de Lyon », a été l’occasion pour le Département de la Documentation régionale & du Dépôt légal de mettre un coup de projecteur sur l’École de tissage et sa bibliothèque, dont la BmL conserve une partie des collections. Visites, rencontres, recherche d’archives ont permis de reconstituer son histoire et d’en faire un portrait vivant que nous vous livrons ici.
Une saga au long cours
La fondation de l’École municipale de tissage à Lyon en 1884 pose un jalon important dans l’histoire de l’enseignement technique en France. Ce nouvel établissement vise à répondre à une nécessité alors pressante : fournir aux ouvriers tisseurs une instruction théorique qui leur fait cruellement défaut, et offrir aux employés de maisons de soieries la formation pratique indispensable. Avec la volonté de combler le fossé entre tradition et innovation, en associant enseignements théoriques et pratiques, l’école contribue à la pérennité du savoir-faire lyonnais.
![[Lycée La Martinière Diderot], René Lanaud, BmL, P0793 020 01308](https://www.linflux.com/wp-content/uploads/2025/06/P0793-020-01308-1-836x1200.jpg)
L’école, d’abord installée place de Belfort, emménage au 41 cours Giraud (Lyon 1er arr.) au début des années 1930, dans un bâtiment neuf réalisé par Tony Garnier. Entre 1968 et 1986, la structure de l’école évolue fortement. Elle se scinde en deux : d’une part une « école des métiers », qui devient lycée professionnel et technologique, et d’autre part une « école supérieure », destinée à former les ingénieurs en textile, future ITECH-Lyon.
La bibliothèque de l’École de tissage propose dès 1886 des ressources variées allant des ouvrages académiques aux revues spécialisées en passant par des archives historiques. Ce large éventail permet aux étudiants d’accéder à des informations essentielles sur les techniques traditionnelles et innovantes de tissage ainsi que sur l’histoire de ce savoir-faire.
En 1985, les collections les plus anciennes (du XVIIIe siècle à 1960) sont confiées à la Bibliothèque municipale de Lyon : environ 12 000 livres comportant précis de physique, de chimie des colorants, traités de sériciculture, ouvrages sur la technique du tissage, cahiers de cours, livres d’échantillons de tissu et revues spécialisées.
Portraits et témoignages de deux anciens élèves de l’école
L’École de tissage avait pour objectif de former des techniciens et des ingénieurs spécialisés de l’industrie du textile, tout en proposant par ailleurs une filière artistique destinée à préparer des dessinateurs de motifs. Les élèves qui suivaient ces différentes formations se rencontraient peu, voire s’ignoraient. Les futurs dessinateurs suivaient un cursus plus court et étaient souvent en apprentissage, alors que les futurs techniciens et ingénieurs s’embarquaient dans des études plus longues et, pour certains, étaient internes dans l’école.
Michel Constanty : parcours d’un ingénieur de la filière textile
Né en Auvergne, Michel Constanty suit tout d’abord des études en technique mécanique à l’École nationale professionnelle de Thiers avant d’intégrer en 1968 le BTS textile option tissage au lycée Diderot. Il poursuit ensuite ses études à l’École supérieure des industries textiles (ESITL, ex-École de tissage) encore municipale à l’époque, pour obtenir un diplôme d’ingénieur.
Interne au lycée, il se souvient de ces années d’études et de ses camarades de classe : « En BTS nous étions une vingtaine ainsi qu’en école d’ingénieur. Ces effectifs ont diminué par la suite. Le textile devenant moins porteur. Les étudiants que j’ai côtoyés en BTS étaient, pour la majorité, sans lien particulier avec le textile. Les étudiants de l’ESITL, autant que je m’en souvienne, avaient des parents ou connaissances dans le textile. Il y avait aussi des étrangers fortunés car pour eux les études étaient payantes. Ils venaient principalement d’Afrique et d’Asie, l’école avait une belle aura ».
À cette époque, les filles étaient rares dans cette filière : « Dans ma promotion d’ingénieur, il y en avait une, la pauvre. J’ai souvenir de cette fille, parce qu’elle était toute seule avec tous ces garçons, extrêmement brillante, majore de la classe. Et elle avait eu, autant que je me souviens, du mal à trouver du travail, à l’époque. »
Les enseignements sont principalement techniques : « Les matières enseignées étaient : les matières premières, la filature, le tissage, le tricotage, la teinture et le laboratoire de contrôle. Chacune de ces disciplines comportaient une partie théorique et des travaux pratiques d’application dans les ateliers équipés de machines.»

Une fois son diplôme en poche, il commence une carrière dans l’industrie : « J’ai ensuite débuté dans le tricotage à Troyes (Babygros) quelques mois. Puis j’ai été recruté comme ingénieur développement aux ARCT (ateliers roannais de construction textile) à Roanne en 1972. Cette entreprise fabriquait des machines de texturation, donc textile et mécanique associés. Elle était leader mondial dans son domaine. J’y suis resté cinq ans pour mettre en route les prototypes. Puis ce fut le déclin et les licenciements. »
Alors que dans la décennie 70, les entreprises de tissage implantées à Lyon intramuros se délocalisent pour s’installer à l’extérieur de la ville et font face à une concurrence mondiale sévère, Michel Constanty saisit une opportunité : « En 1977, un de mes anciens professeurs de L’ESITL qui partait à la retraite m’a contacté pour le remplacer. J’ai sauté sur l’occasion et il faut dire que l’enseignement me plaisait. Ensuite ce fut l’engrenage. La ville de Lyon, sur concours, m’a recruté comme professeur ESITL. J’ai alors enseigné dans toutes les sections textile de l’établissement, du CAP à ingénieur. Mon emploi de temps était à cheval sur l’État (lycée Diderot) et la ville de Lyon (ESITL) Puis la ville de Lyon a cédé ESITL à l’établissement ITECH. J’ai alors passé un CAPES textile et j’ai été titularisé au lycée Diderot. J’ai terminé ma carrière dans ce lycée mais j’ai continué d’assurer à ITECH des cours textile aux ingénieurs (Initiation et matières premières). »
L’industrie textile lyonnaise, tout comme celle du Nord, évolue fortement au début des années 80 pour se placer sur un créneau plus qualitatif, celui des textiles techniques qui nécessitent une très haute technologie. L’École de tissage de Lyon est toutefois déjà parfaitement équipée pour accompagner ce changement : « l’école, quand j’ai été élève et quand je suis devenu professeur, était extrêmement bien dotée en matériel. Un métier à tisser, qu’il utilise du carbone, du verre ou du coton, c’est le même. Il y a des adaptations, mais le principe de la machine et l’enseignement du tissage restent absolument identiques. L’école était une véritable usine textile, extrêmement performante. »

Michel Constanty revient sur l’histoire de l’École de tissage et des extensions du bâtiment d’origine conçu par Tony Garnier : « Monsieur Lamour a été le directeur de cet établissement lorsque la ville de Lyon a créé l’école supérieure. C’est lui qui, à l’époque, a décidé de toutes les infrastructures. Il pouvait se permettre de construire des bâtiments, de faire un petit peu tout ce qu’il voulait. Il avait une très grosse influence et ses entrées à la mairie. Par ailleurs, l’école était une vraie usine. C’est-à-dire qu’à l’époque où j’étais étudiant, élève, l’école était un atelier de production. On travaillait pour l’extérieur sans trop savoir où passaient les profits, ce qui a pu être un peu mal perçu. »
Interrogé sur la bibliothèque de l’établissement supprimée en 1985 et dont les collections ont été divisées entre la Bibliothèque municipale de Lyon et le Musée des Tissus, il se souvient : » Une grande bibliothèque, avec mezzanine, existait au second étage. Elle comportait de nombreux et riches ouvrages sur le textile. Ils ont été stockés à la bibliothèque municipale je crois. L’école était abonnée aux périodiques textiles. J’ai consulté des documents pour rédiger mon mémoire de fin d’études. Le jury pour décerner le diplôme d’ingénieur se tenait dans cette bibliothèque avec le directeur, un inspecteur de l’Éducation nationale et des profs. Je crois me souvenir que l’accès était libre et il y avait une ou un bibliothécaire. Une personne reliait les périodiques par année de parution. On pouvait emprunter ou consulter sur place « .
Gilbert Verner : le textile sous le signe de l’art
Né au Péage-de-Roussillon pendant la guerre, Gilbert Verner grandit à Lyon, à la Guillotière, dans une loge de concierge où sa famille s’installe après avoir tout perdu à cause des bombardements ; ses parents habitaient précédemment au Grand Trou. Très tôt, il montre un goût pour le dessin. Il est encouragé par un de ses professeurs qui suggère à ses parents de l’orienter dans la voie artistique.
Une annonce dans un journal l’amène à postuler pour un poste d’apprenti dessinateur textile dans un cabinet de soierie, chez Jean Toutant. C’est là qu’il fait ses premières armes : allumant le poêle, nettoyant les pots de peinture, mais surtout, développant un œil pour la couleur à travers des exercices de mise en coloris. Parallèlement, il suit des cours à l’École de tissage de Lyon où il apprend la technique du dessin, la mise en carte, etc.

« Nous allions à l’École de tissage deux fois par semaine. Les cours duraient la journée. Il y avait donc une journée qui était consacrée beaucoup plus au dessin, avec des profs qui venaient de l’extérieur ».
Il n’y a pas de formation artistique à l’École de Tissage mais des cours pour les apprentis qui sont considérés comme extérieurs. Ils ont d’ailleurs certains droits supplémentaires ! « On faisait les malins en tant qu’apprentis par rapport aux autres élèves. On avait la possibilité, quand on était à la cantine, de boire du vin. Et on buvait du vin. » Gilbert Verner se souvient d’anecdotes marquantes : les viennoiseries le matin, les baignades dans la Saône… « On rentrait et on sortait comme on voulait de l’école, comme on était extérieurs. Je reviens à ce mot. Comme on était extérieurs, on allait se baigner dans la Saône ».
Ces années d’apprentissage sont pour lui des « années bonheur ». « La première année, il y avait plus de 35 apprentis dessinateurs, garçons-filles. Ils ont fait deux classes. Et au bout de 6-8 mois, ces deux classes en sont devenues plus qu’une. C’est le proverbe, beaucoup d’appelés, pas beaucoup d’élus. Et à partir du moment où, dans les classes, il y avait moins de monde, il y avait une plus grande disponibilité, je pense, des profs vis-à-vis de nous. Et on nous faisait faire complètement autre chose que ce qu’on faisait dans les cabinets de dessin. Et ça, je trouve que ça a été merveilleux »

Les apprentis effectuaient de nombreuses sorties avec l’école. Gilbert Verner se souvient d’une de ces professeurs : « Mademoiselle Coppona nous avait invités à la campagne parce qu’on dessinait aussi beaucoup sur nature. On faisait des fleurs. Ils [les professeurs] nous emmenaient aussi au parc de la Tête d’Or. »
À l’École de tissage, il se distingue pour son talent : ses dessins remportent des prix, sont affichés à l’école, et il entre en compétition amicale avec un autre apprenti pour obtenir les meilleures notes.

Il y a une bonne entente entre les apprentis : « Alors au niveau de l’ambiance, beaucoup d’ambiance, au niveau des élèves. […] C’était tous des Lyonnais. Dans le cours de dessin où j’étais, à cette époque-là, on avait une jeune fille qui était dans le métier, qui était aussi apprentie, qui a quitté le métier, et qui est devenue chanteuse, elle s’appelle Nicoletta. »
Passionné par l’impression sur coton, plus libre et moderne que le dessin pour la soierie façonnée, il s’oriente rapidement vers le textile vestimentaire. « Pour moi, le coton, c’était beaucoup plus jeune. Les couleurs étaient beaucoup plus vives. Quand on faisait un dessin qui s’adressait à de la soierie, la conception coloristique du dessin n’était pas du tout celle du coton. Un dessin de coton n’est pas un dessin de soie. Et puis c’était l’époque des magasins comme Prisunic, comme Monoprix. »
Après plusieurs expériences, il fonde son propre atelier, à l’âge de 23 ans, avec son ancien formateur, M. Laurençon. Ensemble, ils bâtissent un cabinet reconnu, « Laurençon-Verner ».
Gilbert Verner se démarque alors des tendances imposées par les bureaux de style. Il diversifie ses productions (vêtements, papiers peints, parapluies, tabliers humoristiques) et s’ouvre aux marchés européens : Espagne, Allemagne, Italie. Il participe à de nombreux salons professionnels comme Indigo (Lille) ou Heimtextil (Francfort). Il devient une référence dans le dessin pour enfants, secteur longtemps négligé.
Avec la mondialisation et l’informatisation, les ateliers traditionnels de dessin textile déclinent. De nombreux clients (imprimeurs, fabricants, etc.) ferment ou délocalisent. Le dessin manuel est remplacé par les outils numériques. Gilbert Verner ferme son atelier dans les années 2000.
L’école aujourd’hui
Une partie de l’équipe de la Documentation régionale a pu rencontrer Monsieur Venturelli, enseignant en BTS Innovation Textile au lycée La Martinière-Diderot qui accueille une vingtaine d’étudiants par an.
L’école, équipée des machines les plus modernes, abrite la plateforme Text’in dont l’objectif est d’accompagner les entreprises dans leur désir d’innovation. À la fois outil pédagogique et plateforme de prototypage rapide, la plateforme permet aux entreprises de bénéficier de nombreux équipements et espaces et aux étudiants de s’essayer à la production.
Une vue des ateliers de l’école qui héberge la plateforme Text’in


Un portrait d’Edouard Herriot finement tissé, démonstration du degré de précision dans le rendu du motif qu’un métier à tisser peut atteindre en fonction de la complexité de l’armure qu’il exécute.
Une vue d’un des ateliers dans lesquels les élèves peuvent expérimenter différentes machines, de la plus rudimentaire à la plus sophistiquée.

Bibliographie
École municipale de tissage de Lyon dite École Supérieure du Textile puis lycée d’enseignement technique La Martinière-Diderot, site Diderot. L’inventaire général en Auvergne Rhône-Alpes
École de tissage. Bibliothèque municipale de Lyon
Métier à tisser, école supérieure des industries textiles. René Lanaud, 1980. Photographes en Rhône-Alpes
Catalogue des ouvrages de la bibliothèque de l’École supérieure des industries textiles de Lyon transférés à la Bibliothèque municipale. Bibliothèque municipale de Lyon, 1986
Une Fabrique de l’innovation : la saga des colorants à Lyon au 19e siècle, BmL, 2013.
Une Fabrique de l’innovation : Textiles techniques, le futur se tisse aussi en Rhône-Alpes, BmL, 2013.








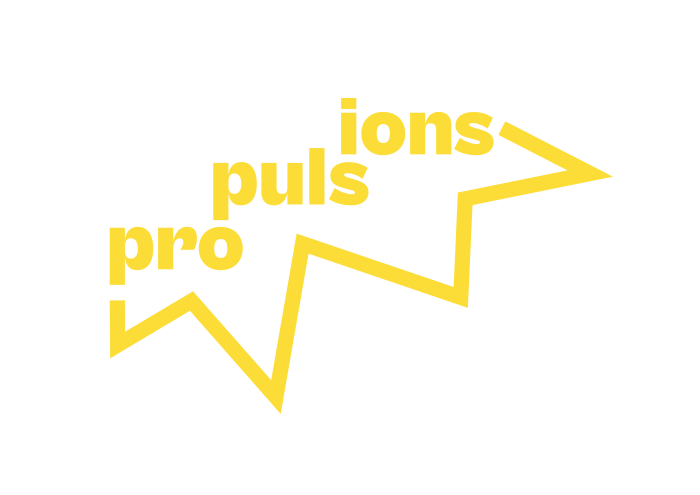

Partager cet article