Grenoble : encore un musée ?
Publié le 04/05/2011 à 23:00
-  15 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
15 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
Sommaire
Une église bimillénaire
Un trésor architectural
Les fouilles archéologiques
Son histoire
Ses trésors architecturaux
Une nécropole unique
Des collections variées
Les personnalités marquantes
[actu]Une église bimillénaire[actu]
La construction de cette église se fait en plusieurs étapes successives au cours de l’Antiquité, du Haut Moyen-Age et des différentes phases du christianisme. Une tradition veut que l’église Saint-Laurent soit la plus vieille de Grenoble.
Le premier bâtiment édifié à cet endroit serait la crypte de Saint-Oyand. Mais avec le soulèvement du terrain au cours des ans, une nouvelle église carolingienne est construite au IXème siècle.
L’église romane Saint-Laurent telle que nous pouvons la voir aujourd’hui est édifiée vers 1150 sur l’emplacement de la crypte Saint-Oyand. Les bénédictins de Chaffre y élèvent un prieuré sur les lieux au XIème siècle et restèrent à Grenoble jusqu’en 1790.
Après la Révolution française, l’église Saint-Laurent devient une paroisse, mais cette attribution est elle aussi abandonnée lors des nouveaux travaux de restauration de l’édifice dans les années 1970-80. Une autre raison invoquée et probable est également l’évolution des mentalités, l’aspect religieux étant oublié pour une vision plus culturelle du site.
[actu]Un trésor architectural[actu]
L’architecture du bâtiment est un amalgame de styles variés de différentes époques réalisés au cours des différentes constructions sur le même site.
L’église carolingienne a une nef rectangulaire assez étroite mais longue, terminée par trois absides. [1] Elle englobe avec soin la crypte Saint-Oyand. Un transept recouvre à l’est les branches nord et sud de l’édifice cruciforme préexistant. Le chœur occidental est flanqué de deux chapelles latérales.
L’église romane datant du XIIe siècle est celle que nous connaissons aujourd’hui. Entre autres caractéristiques, le chœur et le chevet sont agrémentés de trois larges baies flanquées de colonnettes à chapiteaux corinthiens sculptés, présentant des motifs végétaux, des têtes de personnages, des aigles aux ailes et serres anguleuses et une série de modillons (élément architectural servant à soutenir une corniche)
à la base du toit. Un modillon est un . Les sculptures présentes sur ce site sont des masques grimaçants, des oiseaux ou encore deux serpents entrelacés.
Les parties hautes de l’abside ont conservé leur décor d’origine, du XIIème siècle. Le clocher actuel date du XVIIème siècle.
Contre le clocher s’élève toujours un vestige des fortifications du XIVème siècle, l’un des rares témoignages des fortifications de cette époque à Grenoble.
[actu]Les fouilles archéologiques[actu]
L’église, la crypte et ses abords font l’objet de plusieurs campagnes de fouilles archéologiques.
Une première est menée par Prosper Mérimée dans les années 1840. Une autre est entreprise à partir de 1977. L’ampleur et la richesse des découvertes rendent nécessaire la désacralisation de l’église paroissiale en 1983 afin de permettre des travaux plus en profondeur.
Les travaux de rénovation entre 2009 et 2011 ont permis entre autre l’installation d’une toiture protégeant l’espace du cloître et la création d’un espace d’exposition pour la collection d’objets découverts lors des fouilles.
L’ensemble du site (église et abords) est classé Monument historique le 10 août 1977.
La crypte Saint-Oyand est le joyau de l’ensemble du site de Saint-Laurent.
Personne ne peut établir la raison première de l’édification de cette crypte. Pour les uns c’est un temple d’Isis, pour les autres un temple d’Esculape et pour d’autres encore un prétoire romain. Une autre hypothèse affirme que cette crypte est le premier lieu de réunion des chrétiens, et que l’église Saint-Laurent au dessus a été édifiée en souvenir de ce premier lieu.
Le nom de la crypte Saint-Oyand se rapporte à un moine du Jura, Eugendus (vers 450-515), qui fut vénéré dans la région à l’époque mérovingienne.
Si l’histoire de cette crypte est confuse, il est possible d’affirmer grâce aux vestiges actuels qu’au début du IVème siècle, la crypte Saint-Oyand était ce qui restait d’une église funéraire.
[actu]Ses trésors architecturaux[actu]
La chapelle a une forme de croix grecque, dont chaque extrémité est arrondie par trois absides, symbole de la Trinité. Deux niches latérales décrivent les bras de la croix. La voûte en berceau [2] présente une élévation de 5,70m.
Au VIIème siècle, une colonnade de 20 colonnes est rajoutée en marbres, en poudingues et en brèches du pays. Les colonnes sont surmontées de chapiteaux corinthiens assez symétriques en calcaire des Baux de Provence ou en marbre blanc.
On trouve les motifs de l’iconographie chrétienne du VIIème siècle : guirlandes, fleurs, feuillages (symbole de la Résurrection), croix, agneaux, palmiers, dattiers, colombe, griffons [3] et canthares [4]…
Le Musée d’archéologie de Grenoble n’a pas toujours eu sa place dans la crypte de l’église Saint-Laurent.
Au XIXème siècle, ce musée a plutôt la forme d’un étalage d’objets, de vestiges donnant sur la rue. Il est décrit par W. Froehner comme un musée en plein air où seraient exposés des vestiges gallo-romains trouvés lors de fouilles dans le département. Il serait composé de quatre autels, d’un sarcophage et d’un cadran solaire antique ne marquant plus les heures. A l’époque, la rénovation de ces quelques œuvres a posé problème auprès d’antiquaires puritains qui craignaient que l’application d’une peinture rouge sur les anciennes lettres puisse déformer le texte.
Ce sont les prémices d’un nouveau musée archéologique qui sera agrémenté et complété par la suite.
Le musée et l’ensemble des édifices sont fermés en 2003 pour des raisons de sécurité. Des travaux de rénovations commencent en 2009, ainsi que la restructuration du musée d’archéologie. Pour la réouverture du musée, la visite des bâtiments est totalement repensée. La mise en valeur des vestiges et la scénographie sont confiées à Jean-Noël Duru. Le musée bénéficie ainsi d’une scénographie didactique et respectueuse du site.
[actu]Une nécropole unique[actu]
Le musée possède une collection très riche de tombes découvertes dans l’église, la crypte ou le cimetière de l’église (plus de 1 500 sépultures). Parmi elles figurent huit mausolées du IVème et Vème siècle, dont l’un a conservé son décor intérieur de peintures murales.
Lors de fouilles dans la crypte en 1851, sont déterrés également de nombreux tombeaux du Moyen-âge construits à partir de tuiles romaines et de fragments de dalles provenant de tombeaux antérieurs.
Ces tombes témoignent d’un passé et d’une foi vivaces. Elles ont également permis aux archéologues d’étudier l’évolution des modes d’inhumation, des pratiques funéraires, ainsi que les dépôts d’objets dans les tombes. Cette étude est très riche d’enseignement sur l’évolution des mentalités, des relations avec les défunts, des croyances religieuses et des rites funéraires.
[actu]Des collections variées[actu]
Plus de 3 000 objets divers ont été retrouvés dans les gravas et remblais de l’église.
Le nouveau musée est très riche par la diversité des objets exposés. On y trouve entre autre des vestiges : d’architecture, d’urbanisme, d’art religieux (sculptures et peintures murales de l’antiquité tardive et du haut Moyen Âge, de sculptures du XIIème siècle, un autel du XVIIIème, vitraux du XIXème), d’arts décoratifs (poterie, céramique, orfèvrerie, verrerie), et de beaux-arts (peinture, sculpture).
Les croix de Saint Jacques retrouvées dans des tombeaux sont également exposées, ainsi que des peignes en os, des épitaphes, ou encore des pièces de monnaies.
Le trésor religieux de l’église Saint-Laurent est lui aussi présenté après avoir été traité au préalable pour préserver la patine du temps.
[actu]Les personnalités marquantes[actu]
Le Musée d’archéologie de Grenoble ainsi que l’église et la crypte doivent leur restauration et leur sauvegarde à l’intérêt que leur portèrent de nombreuses personnalités influentes.
La première est Jacques-Joseph Champollion Figeac, archéologue français né en 1778 à Figeac mort en 1867 est le frère de l’égyptologue. Par ses travaux, il permet la reconnaissance publique de l’édifice Saint-Laurent en révélant l’existence d’un monument souterrain datant de l’époque mérovingienne : la crypte Saint-Oyand.
A l’issu de ses recherches, il peut affirmer avec certitude que la crypte n’est pas un monument païen comme l’affirmait la croyance populaire, mais un édifice religieux.
Prosper Mérimée est un écrivain, historien et archéologue français, né en 1803 et mort en 1870. Inspecteur des Monuments historique, il intervient pour faire classer l’édifice le 26 février 1850. Le musée archéologique est créé en 1846.
Enfin, Pierre Manguin est un architecte et archéologue français, né en 1815 et mort en 1869. Il réalise les premiers travaux de rénovation de l’ensemble des édifices sous la direction de Prosper Mérimée. De nombreux dessins de l’église et de la crypte à cette époque nous sont parvenus grâce à lui.
Pour en savoir plus :
38- Grenoble Eglise Saint-Laurent ; 38-Vienne Eglise Saint-André-le-Bas
Ce document est une série de plans architecturaux sur les différentes phases de construction de l’église Saint Laurent et de la crypte Saint-Oyand. Une brève explication accompagne chaque plan.
Grenoble, Isère : Aux premiers temps chrétiens : Saint-Laurent et ses nécropoles de Renée COLARDELLE.
Ce petit livret illustré rapporte de manière concise les grandes phases évolutives de la construction de la crypte Saint-Oyand et de l’église Saint-Laurent. Nous avons également un bref aperçu des richesses architecturales et archéologiques découvertes.
La ville et la mort. Saint-Laurent de Grenoble, 2000 ans de tradition funéraire de Renée COLARDELLE.
Cette monographie est un descriptif de toutes les fouilles qui ont été exécutées dans l’église et la crypte Saint-Laurent et le résultat de leur découverte. Un DVD accompagne le document : il comprend plus de 900 photos sur les découvertes archéologique faites sur ces deux sites.
Notice sur le Musée d’archéologie de Grenoble du Chevalier Radulph de GOURNAY.
Impressions du Chevalier Radulph de Gournay sur le musée d’archéologie de Grenoble lors de sa création. Ce récit est sur le ton épistolaire et satirique.
Notice sur l’église de Saint-Laurent de Grenoble de Jean-Joseph-Antoine PILOT de THOREY
Cette monographie détaille toutes les connaissances que les archéologues possédaient dans les années 1850 sur la crypte Saint-Oyand et l’église Saint-Laurent.
L’église et la crypte de Saint-Laurent de Grenoble de Girard RAYMONT
Musée archéologique de Grenoble : ISERE, Conseil régional.
Patrimoine religieux : PLAY Grenoble.
[1] L’abside est l’extrémité du chœur d’une église, située derrière le chœur, formée soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat.
[2] La voûte en berceau est une voûte qui présente la face de son arc faite d’une courbure constante. Elle est la plus simple et la plus fréquente des voûtes.
[3] Le griffon est une créature légendaire. Il est imaginé et représenté avec le corps d’un aigle greffé sur l’arrière d’un lion, muni d’oreilles de cheval et une queue de serpent.
[4] Un canthare est un vase profond avec deux anses hautes et verticales, servant à boire le vin, et lié au culte de Dionysos (dieu du vin).




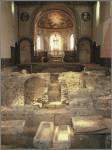



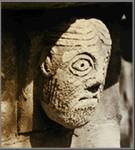


















Partager cet article