Eduquer ou punir ?
Publié le 09/12/2006 à 00:00
-  16 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
16 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
[actu]Rappel des faits[actu]
Le rapport de L’INSERM sur les troubles de conduite chez l’enfant et l’adolescent dont s’inspire la Loi sur la Prévention de la délinquance semble établir un lien direct entre les troubles de l’enfance et la disposition à devenir délinquant à l’adolescence.
Les professionnels de l’enfance auraient souhaité que soit mises en place des mesures de protection de l’enfant, avant même que ne soit envisagée une nouvelle loi contre les délinquants.
Car, en définitive, qui sont ceux dont la sécurité est le plus menacée ?
Projet de loi sur la Prévention de la délinquance
Jeunes et Justice (1945-2005) Dossier en ligne de la Documentation française sur les mineurs et la justice.
[actu]Réactions des associations[actu] :
![]()
Les travailleurs sociaux, parents, spécialistes de l’enfance se sont mobilisés, et une pétition contre le projet de loi de Nicolas Sarkozy a été mise en ligne par le collectif pasde0deconduite .
Il s’en est suivi la publication d’un livre :
Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans ! , Erès.
La nécessité de réformer ou non la Protection de l’enfance a été abordée lors d’une Journée d’études par le CREAI (Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée).
Sur le site de l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes privés Sanitaires et sociaux
, des dossiers ou actes de journées d’études abordent les questions soulevées par la mise en oeuvre d’une politique de prévention de la délinquance déconnectée de celle de la protection de l’enfance : Une jeunesse dans le collimateur ? et Prévention de la délinquance : la cohérence du cadre législatif reste à assurer.
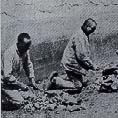
- Enfants bagnards
- Ministère de la justice
[actu] Un peu d’histoire :[actu]
« Si j’ai voulu aller à Rome, ce n’est pas pour obtenir des honoraires plus importants, ni des honneurs plus grands – promesses que me faisaient les amis qui m’y poussaient – et, même si ces considérations aussi influençaient mon esprit, la raison principale, et pour ainsi dire l’unique, fut que, d’après mes informations, les jeunes, là-bas, étudiaient plus calmement et étaient tenus par l’organisation plus contraignante de l’enseignement : elle les empêche de faire irruption en désordre et avec effronterie dans la salle de cours de celui qui n’est pas leur maître et ils n’y sont absolument pas admis à moins que ce dernier n’y consente.
A Carthage, au contraire, le laisser-aller des étudiants est affreux, incontrôlé : ils surgissent grossièrement et, tels des déments, pourrait-on dire, perturbent l’ordre que chaque maître a établi dans l’intérêt de ses élèves. Ils commettent beaucoup d’outrages, d’une bêtise étonnante, que les lois devraient punir si l’usage ne les protégeait pas […] Ils pensent agir impunément alors que l’aveuglement même de leur comportement les sanctionne et qu’ils subissent un préjudice incomparablement plus grave que celui qu’ils infligent. », Confessions , V, 8, par SAINT AUGUSTIN (354-430), Garnier-Flammarion.
Philippe Ariès nous rappelle « La rudesse de l’enfance écolière », à une époque où l’on ne parlait pas encore d’hyperactivité ou de troubles de conduite de l’enfant : « Les écoliers étaient armés. Le Ratio studiorum des Jésuites prévoyait leur désarmement à l’entrée du collège, où les armes étaient mises en dépôt contre un reçu, et rendues à la sortie. En 1680, le Règlement de discipline du collège de Bourgogne rappelle cette obligation : « On ne retiendra ni armes ni épées dans les chambres particulières et ceux qui en auront les mettront ès mains du principal qui les conservera dans un lieu destiné à cet effet. » On n’imagine guère une consigne de ce genre dans nos collèges ou lycées ! Les plus petits, dès cinq ans, pouvaient déjà porter l’épée. »
Révoltes à main armées, mutineries, grève avec occupation des écoles, bastonnade des professeurs sont monnaie courante jusqu’à la fin du XVIIe siècle par exemple.
« Au XVIIIe siècle l’écolier est à peu près maté, malgré des habitudes d’indépendance qui durèrent autant que l’externat ou l’hospitalité des bourgeois de la ville, et qui disparurent seulement au XIXe siècle avec la généralisation de l’internat ou le plus long séjour de l’enfant au foyer familial. »
L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime , par Philippe ARIES, Seuil.
[actu]Une société qui se protège de ses enfants ou une société qui protège ses enfants ?[actu]
La revue en ligne Clio présente un ouvrage de Pascale Quincy-Lefebvre sur l’enfant déviant, sa famille et les moyens mis en oeuvre à la fin du XIXe et au début du XXe siècle pour le socialiser. Familles, institutions et déviances : une histoire de l’enfance difficile, Economica.
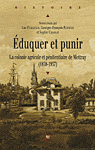
- Colonie de Mettray
- Presses Universitaires de Rennes
Eduquer et punir : la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray (1839-1937), Presses Universitaires de Rennes. Louée à ses débuts par les courants philanthropiques de la société française, la colonie de Mettray est décriée à sa fermeture en 1937 comme le pire des bagnes pour enfants. Ce bilan d’un siècle d’histoire carcérale et de maisons de correction s’insère dans les débats contemporains sur les milieux ouverts et fermés. A partir d’extraits d’archives privées et publiques.
Bagnes pour enfants Belle-Ile-en-Mer 1934 : la révolte des enfants de la colonie pénitentiaire sera « matée » par la population et les touristes réunis. Cet évènement inspirera à Jacques Prévert le poème « La chasse à l’enfant » et, en collaboration avec Marcel Carné, « La fleur de l’âge », film jamais terminé.
[actu] Le point de vue des philosophes :[actu]
La méfiance de l’Etat à l’égard de l’éducation dispensée par les parents des classes populaires n’est pas un phénomène récent. La domestication des corps, et par là-même, des familles populaires fut l’objet de l’hygiénisme et de la philanthropie au XIXe siècle. Faire du malade un déviant pour l’enfermer (Foucault) ou faire du déviant un malade pour l’enfermer encore, la société peine à trouver un mode de reconnaissance de ceux qui se trouvent sur ses marges. Si le siècle de la psychanalyse a permis quelque temps un certain infléchissement du pouvoir médical, le récent rapport de l’INSERM sur les troubles de conduite de l’enfant nous rappelle, entre autres, l’existence d’un biopouvoir.

- Michel Foucault
- PUF
« Notre société ne veut pas se reconnaître dans ce malade qu’elle chasse ou qu’elle enferme ; au moment même où elle diagnostique la maladie, elle exclut le malade. Les analyses de nos psychologues et de nos sociologues, qui font du malade un déviant, et qui cherchent l’origine du morbide dans l’anormal, sont donc avant tout, une projection de thèmes culturels. En réalité, une société s’exprime positivement dans les maladies mentales que manifestent ses membres ; et ceci, quel que soit le statut qu’elle donne à ces formes morbides : qu’elle les place au centre de sa vie religieuse comme c’est souvent le cas chez les primitifs, ou qu’elle cherche à les expatrier en les situant à l’extérieur de la vie sociale, comme le fait notre culture ».
Maladie mentale et psychologie, par Michel FOUCAULT, PUF. Voir aussi Surveiller et punir, Gallimard.
« La société souffre aujourd’hui de la consommation. Le capitalisme est devenu planétaire et il semble bien que le processus de désenchantement et de rationalisation (Max Weber) est arrivé à son terme. Il engendre une misère spirituelle d’où a disparu la raison comme motif d’espérer. Comme disparition de tout horizon d’attente – de toute croyance, religieuse, politique, ou libidinale, qu’elle soit amoureuse, filiale ou sociale, constituant le tissu des solidarités sans lesquelles aucune société n’est possible, le désenchantement absolu frappe en particulier ceux qui pensent ne plus rien avoir à attendre du développement des sociétés hyperindustrielles. Ces désespérés sont des « desperados ». Ils n’ont tout aussi bien plus rien à craindre.
Mécréance et discrédit , par Bernard STIEGLER, Galilée et les deux tomes suivants Les sociétés incontrôlables d’individus désaffectés et L’esprit perdu du capitalisme.
L’idée d’une détection dès le berceau de la délinquance future a trouvé écho dans les multiples procédures de surveillance et de contrôle qui jalonnent désormais les parcours des enfants. Le soupçon pèse aujourd’hui sur les supposés coupables – parents démissionnaires, populations migrantes ou précaires… – et parcourt la chaîne des institutions : école, justice, médecine, action sociale… Cet ouvrage revient sur les remous que ces visées sécuritaires ont provoqués et propose, de manière offensive, une analyse critique d’une telle politique.
Faut-il avoir peur de nos enfants ? , sous la dir. de Gérard NEYRAND, La Découverte. (Actuellement en commande à la bibliothèque).
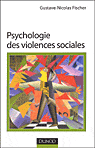
- Psychologie des violences sociales
- Dunod
Psychologie des violences sociales, par Gustav-Nicolas FISCHER, Dunod. Sont décrites dans ce livre les notions fondamentales et les orientations théoriques majeures pour expliquer les grandes formes des violences sociales : violences scolaires, violences familiales, violences au travail, violences urbaines. On peut y lire, par exemple, « La violence télévisée est une construction et une mise en scène d’images violentes qui façonnent notre perception de la vie sociale comme réalité violente. (…) La violence à la télévision ou au cinéma est tout d’abord l’expression d’une production médiatique qui crée l’image d’un monde violent”.
Une bibliographie intéressante sur l’adolescence peut être consultée sur le site de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire.
[actu] Quand les places ne sont plus aussi claires… Quand l’ordre des générations est bousculé[actu]
« Stage de responsabilité parentale », « accompagnement parental », contrat de responsabilité parentale », « assistance éducative », « aide à la gestion du budget familial » (cf le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, chapitre Ier « Conseil pour les droits et devoirs des familles) mais punir les mineurs comme des adultes, les places sont brouillées. Infantilisation du parent, ou de l’adulte en général (que l’on pense au rôle de prescripteur accordé à l’enfant dans la pub), panne dans la transmission intergénérationnelle : à qui l’adolescent adressera-t-il sa demande de reconnaissance, et qui doit-il affronter dans sa quête d’identité ?
« A quoi ressemble l’enfant normal ? Ne fait-il que manger, grandir et sourire gentiment ? Non. Il n’est pas du tout ainsi. Un enfant normal, s’il a confiance dans son père et dans sa mère, essaie tout. En grandissant, il essaie à fond son pouvoir de briser, de détruire, de faire peur, d’user, de gaspiller, de soutirer et d’usurper. Tout ce qui mène les gens en justice (aussi bien qu’à l’asile) a son équivalent normal dans la relation de l’enfant à sa famille pendant l’enfance et la première enfance. Si la famille peut résister à tous les efforts de l’enfant pour la briser, l’enfant se met alors à jouer. » in
Déprivation et délinquance, recueil d’articles et de conférences données par D. W. Winnicott sur la « tendance antisociale » de l’enfant. Ce concept permettant d’expliquer certains comportements délinquants dont il attribue l’origine à une déprivation, c’est-à-dire à une perturbation survenue très tôt dans l’environnement de l’enfant.
« Il faut toutefois relever les paradoxes des positions de notre société à l’égard de l’enfant devenu précieux, sujet à protéger, doté de droits nouveaux mais, en même temps, mis en devoir de combler, par sa réussite, le narcissisme de ses parents, et, de ce fait, soumis très précocement à des exigences sociales assez contraignantes.
« Ainsi, la question de l’hyperactivité met-elle nécessairement en jeu la tolérance variable de la société à l’égard de la mobilité de ses enfants, ainsi que les critères éducatifs de l’entourage familial et scolaire. » (Bernard Golse).
L’hyperactivité en débat, Erès
“Face à la violence des mineurs, des questions se posent : ces jeunes qui brûlent des voitures, sont violents à l’école et agressent des personnes dans la rue, etc., sont-ils tous des délinquants ? Leur comportement va-t-il persister ? Comment considérer ces actes ? Quelles institutions doivent intervenir ? Quelles réponses la justice peut-elle ou doit-elle apporter ?
La délinquance des mineurs : l’enfant, le psychologue, le droit, par Catherine BLATIER, Presses Universitaires de Grenoble.
[actu]Adolescents « porteurs » de la violence de la société comme le « bouc émissaire » au sens religieux ? [actu]

- Moi, Violent
- Lattès
Suicide, addictions, faits divers, (auto)mutilations, anorexies… La violence semble faire partie de l’univers des adolescents. Leurs crises secouent ceux qui les côtoient, aussi bien les familles que les « professionnels de la jeunesse ». Les parents veulent les protéger de leurs « conduites à risques ». Les institutions, de l’école à la justice, les accusent de se comporter en anarchistes, qui ne respectent ni loi, ni dieu, ni maître. La société, qui envie leur jeunesse et leur beauté, les trouve volontiers incultes et dangereux. Pour nous tous, les adultes, ils sont menaçants, surtout lorsqu’ils vont en « bande » Mais n’est ce pas notre propre violence que nous projetons sur eux ? Nous les mettons en cause, comme responsables de nos guerres, de nos crises… A montrer ainsi les jeunes du doigt, nous risquons d’en faire des boucs émissaires et des monstres. Quand ils n’aspirent qu’à la paix…
« Moi violent ? »par Philippe Gutton, Lattès.

- Adolescence à risque
- Autrement
Et si la violence des ados aujourd’hui n’était autre qu’un avatar des conduites « à risque » typiques de cet âge, « un chemin de contrebande pour se construire une identité » ? La recherche passionnée de sensations, de contact physique intense avec le monde, le poids du groupe, le flirt avec la mort sont bien là dans ces actes délictueux où le jeune s’expose à des représailles, à tomber sur plus fort que lui, à rendre des comptes à la justice. « Mais il est clair que la seule prévention radicale des conduites à risque tient d’abord dans l’établissement d’un monde social propice. »
L’adolescence à risque, par David Le Breton, Autrement.
Voir aussi : Les conduites à risque à l’adolescence, par Pierre COSLIN, Armand Colin.
Sens et non-sens de la violence
Qu’elle soit subie ou agie, la violence est devenue un problème majeur pour ceux que leur pratique amène à rencontrer des enfants et des adolescents. Retrouver le sens de la violence est une démarche certes essentielle, mais non suffisante. Il s’agit aussi d’aller au-delà du sens et de revoir sans cesse les réponses aux expressions nouvelles et inattendues des phénomènes violents, individuels ou collectifs. Cherchant à dépasser une dramatisation de la problématique de la violence des jeunes, ce livre offre des perspectives de réflexion et d’action utiles aux professionnels de la santé mentale des enfants et des adolescents, et plus largement à tous les partenaires du réseau social, éducatif et scolaire.
Et pour terminer ce survol de la question, un DVD comprenant deux films documentaires et une interview du Professeur Philippe Jeammet Etat de violence, Comme une vague, La Cathode.
Témoignages de jeunes de 18 à 25 ans concernés par la violence comme victimes, témoins ou agresseurs. Les récits sont commentés par un psychosociologue et rassemblés en trois thèmes : l’expérience de la violence, comment on bascule et comment on peut s’en sortir. Un outil de débat et de formation pour entrer au coeur de la problématique violente.










Partager cet article