Hériter, donner, transmettre…
Publié le 29/06/2007 à 23:00
-  11 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
11 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
L’héritage, Anne GOTMAN, Presses universitaires de France
La sociologue Anne Gotman rappelle dans ce petit livre les éléments fondamentaux de l’héritage, en réunissant des points de vue très divers, aussi bien historique et sociologique que juridique.
Elle explique que l’héritage est un droit attaché à la naissance, et en ce sens profondément inégalitaire et contraire aux valeurs démocratiques de nos sociétés. Element fondateur de l’identité individuelle et collective, l’héritage prend aujourd’hui des formes très diverses et est devenu une question politique et économique à part entière.
Les héritages familiaux, dir. Bernard Prieur, ESF Editeur
L’héritage, une affaire de famille ? C’est bien de cette manière que l’héritage touche chacun d’entre nous. Mais il ne s’agit pas seulement de recevoir « sa part », que ce soit l’armoire de grand-mère ou la maison de famille. L’héritage, c’est avant tout ce que les parents donnent à leur enfant, la vie, au sein d’une chaîne de générations. Que reçoit-on de sa famille ?, interroge le psychanalyste Bernard Prieur, dans ce livre qui fait le point sur le contexte familial de l’héritage. Les différents articles permettent de mieux comprendre, à l’aide d’exemples et d’analyses, la fonction de l’héritage et/ou de la donation entre parents et enfants.
L’héritage n’est pas le seul mode de circulation de l’argent et des biensdans la famille.
L’argent en famille, n° 45, de la revue Terrain
« La famille est une structure légale, morale et affective gouvernée par la mise en commun des biens, le partage des ressources, le devoir d’assistance et l’héritage du patrimoine. L’argent est un moyen d’échange dont le pouvoir dissolvant des relations affectives et personnelles est souvent souligné. Comment ces deux réalités cohabitent-elles ? D’un côté, les faits montrent que le contenu des relations familiales n’est pas allergique à l’échange comptable et à la monétarisation des soins, des affects et des devoirs de solidarité. De l’autre, l’observation fine des raisons des acteurs fait apparaître que la définition même des liens familiaux exige la mise à distance de la logique des intérêts. Les exemples développés dans ce dossier laissent transparaître en tout cas que s’il existe bien une économie des liens familiaux, sa maxime n’est – même pour les moins confiants d’entre eux (couples séparés) – pas celle du marché et de l’équilibre des intérêts. Les rapports d’argent y sont gouvernés par des normes d’équité dont l’établissement fait appel à des valeurs morales et affectives. » Nicolas Journet.
Que signifie hériter aujourd’hui ? L’Institut national de la statistique et des études économiques procède régulièrement à des enquêtes sur le patrimoine des Français. La dernière étude date de 2004 : c’est l’enquête Patrimoine 2004. Quelques chiffres à retenir…
Toutes générations confondues, un Français sur 5 a reçu un héritage. L’héritage concerne la majorité de la population des pays riches.
La valeur des successions considérées comme moyennes a triplé en un siècle.
La moyenne d’âge des héritiers est de 53 ans, tous biens confondus.
Le nombre de décès donnant lieu à succession est passé de 50% à 65% entre 1984 et 2000.
- Un cadre juridique en évolution
Héritage, tout change, Express, 26/10/2006
Un dossier assez complet sur les dernières modifications en date du droit des successions, en attendant les réformes promises par le nouveau Président de la République. Y sont présentées les 7 innovations capitales : l’extension de la donation-partage aux petits-enfants et aux familles recomposées, la possible renonciation d’un héritage au profit des enfants ou au profit d’un autre héritier, les modifications dans le cadre du PACS, la création du mandat posthume permettant à une personne de désigner de son vivant un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession, la réduction du délai de 10 à 30 ans pour accepter ou refuser la succession pour changement de régime matrimonial sans l’intervention du juge, et enfin les modifications des règles de l’indivision.
De nombreux petits ouvrages pratiques permettent à chacun, selon sa situation, d’éclaircir les modalités de la succession, les règles fiscales qui en découlent et les formalités à accomplir. Les 2 ouvrages suivants, pratiques et actualisés, proposent en outre de nombreux modèles de lettres et formulaires.
Hériter d’un parent, Intérêts privés, Groupe Revue Fiduciaire.
Les successions : guide pratique, juridique et fiscal à l’usage des héritiers, Suzanne LANNEREE, Puit Fleury.
Les mesures à venir :
« Les projets du gouvernement en matière de fiscalité des successions et donations, que le Parlement va examiner début juillet 2007 et qui pourraient entrer en vigueur dès l’été 2007, sont particulièrement généreux. En cas de décès dans un couple marié, mais aussi dans un couple pacsé, le survivant n’aurait plus aucun droit de succession à payer sur ce qu’il reçoit. De plus, devrait s’ajouter la possibilité, si le donateur a moins de 65 ans, de remettre jusqu’à 20 000 €, à un ou plusieurs enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants majeurs (ou, à défaut, neveux et nièces) » (Le particulier, juin 2007)
Voir aussi : Les donations, un cadeau fiscal peu médiatisé, Tonino SERAFINI, Libération du 29/06/2007.
- Approches économiques de l’héritage contemporain
Le gouvernement de Nicolas Sarkozy se propose de baisser une nouvelle fois les droits de succession. En 2004, N. Sarkozy avait déjà réformé les droits de succession par l’instauration d’un nouvel abattement de 50 000 euros. Aujourd’hui, d’après de récents sondages, le projet de réforme semble satisfaire les attentes des Français, même si certains économistes restent perplexes.
Ainsi Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, évalue la pertinence de la réforme et ses conséquences budgétaires dans un article du magazine Alternatives économiques paru en mai 2007 : « Faut-il réduire encore les droits de succession ? »
- Quelle approches sociologiques ?
Aux côtés des économistes, qui ont les premiers amorcé l’étude de l’héritage par le biais de l’étude du patrimoine des ménages, les sociologues examinent le phénomène de transmission : « la grande nouveauté des années 1990 consiste d’abord à pouvoir les dire. Nos sociétés de salariat sont aussi des sociétés d’héritage […] L’idée de l’héritage était occultée tant dans la sociologie de la famille que la sociologie urbaine. L’héritage aurait été uniquement culturel et scolaire, mais non patrimonial » (Martine Ségalen). Or patrimoine et héritage contribuent fortement à la structuration du corps social, en expliquant la reproduction des groupes et de leurs hiérarchies, en jouant un rôle dans la pratique des relations familiales, dans le cadre professionnel et enfin en constituant un lien puissant entre les vivants et les morts.
Sociologie de la famille, Martine SEGALEN, Armand Colin.
Vous trouverez dans ce classique de la sociologie de la famille, un chapitre consacré aux continuités familiales, dans lequel Martine Segalen retrace l’approche faite par les sociologues de la notion d’héritage et de transmission de patrimoine.
Qu’est-ce que transmettre ?, hors-série n° 36 de Sciences Humaines Ce numéro apporte une incontournable dimension historique au sujet, montrant les profondes transformations qui ont eu lieu, notamment dans la transmission familiale (voir la partie Famille et individus).
L’article « Parenté, des biens et des liens » fait le compte-rendu d’une enquête sur « les objets qui circulent d’une génération à l’autre [et qui] ne sont pas des cadeaux comme les autres. Ils font partie de ces dons obligatoires qui, sans être officialisés, sont l’expression des devoirs liés à certains liens de parenté ». Ce don d’objet apparait comme l’expression d’obligations découlant du statut de parent et d’enfant et le partage équitable entre les enfants vient du droit moderne de l’héritage qui a aboli les privilèges liés au sexe et à l’aînesse. Dans l’article « Familles : de quoi héritons-nous ? », Martine Ségalen montre qu’on n’hérite plus forcément d’un statut, d’un savoir-faire ou d’un patrimoine, et que les liens familiaux s’en trouvent transformés.
Parenté : des biens et des liens, Blandine Mortain, in Familles, permanences et métamorphoses, Editions Sciences Humaines.
Les économistes ont étudié la transmission du patrimoine sous forme d’argent ou de biens immobiliers, par donation ou héritage. Blandine Mortain s’est interessée quant à elle à la transmission familiale des objets, insignifiants ou précieux, circulant d’une génération à l’autre, cadeaux pas comme les autres relevant d’une démarche différente, plus personnelle et mémorielle. La transmission des objets sous des dehors assez informels, apparait comme une expression de l’existence de certains liens de parenté privilégiés (notamment entre parents et enfants) et traduit la conception moderne de l’égalité des individus devant l’héritage.
Depuis Marcel Mauss, beaucoup de sociologues et d’ethnologues se sont interrogés sur le don, forme de circulation des biens observée dans les sociétés dites primitives. Avec une question récurrente, même si les réponses divergent : sous l’image idyllique du don gratuit, ne faut-il pas chercher à qui profite le don ?
Don, intérêt et désintéressement, Alain CAILLE, La Découverte, (voir le sommaire)
Alain Caillé commente les principaux penseurs du don : « En tant qu’hommes et femmes modernes nous nous trouvons écartelés entre deux séries de certitudes et d’exigences parfaitement inconciliables. D’une part, notre époque nous pousse impérieusement à croire que rien n’échappe à la loi toute puissante de l’intérêt et qu’il nous faut nous-mêmes nous y plier en devenant des « calculateurs » avisés. D’autre part, nous aspirons tous à nous y soustraire pour accéder enfin à cette pleine générosité, à ce don pur et entier, que la tradition religieuse dont nous sommes issus nous enjoint de rechercher. Mais c’est là une tâche impossible, rétorque la première croyance pour qui rien n’échappe au calcul, si bien qu’il ne saurait exister de générosité et de don que mensongers ».
Pour Alain Caillé, la question est mal posée. L’examen, à travers deux de ses plus grands représentants, Platon et Pierre Bourdieu, de ce qu’il appelle « l’axiomatique de l’intérêt » ; celui, à l’inverse, des caractérisations du don par une impossible et inaccessible pureté (J. Derrida), révèle la profonde solidarité qui unit les deux pôles de l’esprit moderne, et et incite à chercher, dans le sillage du Marcel Mauss de l’Essai sur le don, (in Sociologie et anthropologie, Marcel MAUSS, Ed. PUF, dans une conception du don plus harmonieuse et raisonnable. « Rien n’est sans doute en effet plus urgent si nous voulons penser notre temps, scientifiquement et moralement, à égale distance du cynisme et de l’idéalisme. »
Par-devant notaire, un film de Marc-Antoine Roudil, ADR Production, 1999
Scènes quotidiennes dans l’étude d’un notaire rural dans le Cantal, à Condat : à travers quelques cas concrets, « l’étude du notaire devient le règne des histoires de propriété et d’argent, des conversations intimes et des échanges secrets. »
Que se passe-t-il en cas d’absence d’héritier direct ? Voir…
Peut-on déshériter un enfant ? Voir…
Quels sont les origines historiques et économiques des droits de succession ? Voir…
Comment fonctionne une donation ? Voir…








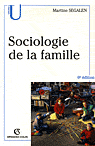
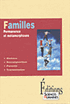






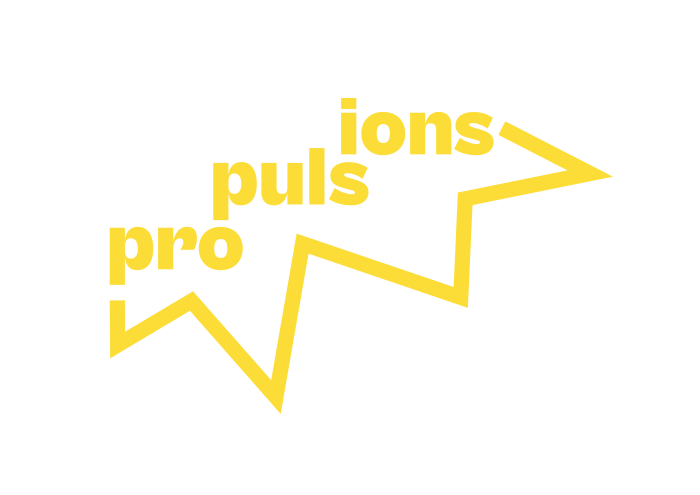
Partager cet article