L'insurrection hongroise
Publié le 04/11/2006 à 00:00
-  8 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
8 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux

- Parlement de Budapest
Insurrection ! Budapest 1956 par David IRVING, A. Michel L’auteur, historien, a mené une enquête auprès des survivants des événements (exilés et membres des troupes soviétiques) afin de reconstituer l’histoire du mouvement insurrectionnel contre la dictature d’une bureaucratie et un régime policier.
La tragédie hongroise : 1956 par François FEJTO, Horay Pour expliquer le soulèvement hongrois de 1956, il fallait analyser la situation de la Hongrie d’après-guerre, les conditions de la liquidation de la démocratie et de la prise du pouvoir monopoliste par le parti communiste en 1948-1949. Pourquoi le régime communiste imposé par Staline fut-il condamné à des crises perpétuelles ? Pourquoi le proçès Rajk, destiné à « purger » le parti de ses éléments non conformistes approfondit-il le malaise ? Comment le peuple de Hongrie subissait-il ce régime et pourquoi s’insurgeait-il contre lui en défiant une des grandes puissances militaires du monde ?
Budapest 56 : les 12 jours qui ébranlèrent l’empire soviétique par Victor SEBESTYEN, Calmann-Lévy Ce livre est l’histoire de ce rêve brisé, tel qu’il fut vécu dans les rues de Budapest, dans les états-majors, dans le huis clos des cabinets ministériels et des instances politiques en Hongrie mais aussi à Moscou, où se joua de fait le sort du peuple hongrois, et à Washington. Victor Sebestyen a reconstitué les moments forts de ces douze jours et les raconte avec une vivacité, une précision et un sens du détail dignes du journaliste qu’il est, sans jamais les isoler de la vue d’ensemble et de l’analyse politique propres à l’historien qu’il est devenu.
[actu]Budapest et la Hongrie[actu]
Mieux connaître la Hongrie, de la proclamation de la République en 1918 à la guerre froide, pour mieux appréhender les origines de ce mouvement.

- Histoire de la Hongrie
- Ed. Hatier
Histoire de la Hongrie par Miklós MOLNAR, Hatier La Hongrie fut pendant des siècles le rempart de la civilisation chrétienne romaine qu’elle avait résolument adoptée. Son histoire porte les cicatrices des combats acharnés qu’elle a menés pour préserver son indépendance et son identité nationale, en puisant dans la prodigieuse énergie dont elle est capable pour faire face à l’adversité.
Histoire de Budapest par Catherine HOREL, Fayard Retrace l’histoire de la ville des origines au XXe siècle. Le dernier chapitre intitulé « le Danube rouge » se focalise sur l’après guerre jusqu’à la chute du mur de Berlin
[actu]L’Europe de l’est[actu]
Après la mort de Staline, le 5 mars1953, L’URSS et ses satellites connaissent une période de dégel qui se manifestera plus ou moins tardivement dans les différents états du bloc soviétique (Pologne, Roumanie, Hongrie). En février 1956, devant le XXe congrès du PC d’Union soviétique, Khrouchtchev dénonce les « erreurs » et les « crimes » de Staline : la déstalinisation est engagée.
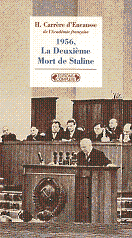
- 2eme mort de Staline
- Ed. Complexe
1956 : la deuxième mort de Staline, par Hélène CARRERE d’ENCAUSSE, Complexe Analyse de la révolution politique instaurée par Khrouchtchev lorsqu’il engagea la déstalinisation lors du XXe Congrès du PC d’URSS en février 1956, les modalités de ce processus, son ambiguïté et ses limites autant que son impact sur le peuple soviétique. Eclairage également sur le système soviétique et sa chute au début des années 1990.
Histoire et géopolitique de l’Europe centrale, par Ernest WIEBEL, Ellipses Nourrie pendant un demi-siècle de marxisme-léninisme sous l’égide soviétique, sevrée par trois lustres de post-communisme, l’Europe centrale appartient aujourd’hui à l’Union Européenne. Que de chemin parcouru depuis que les légions romaines ont établi à l’aube du premier millénaire leurs cantonnements le long de la rive droite du Danube. Cette étude retrace l’évolution historique et géopolitique du centre du vieux-continent de l’Antiquité à nos jours.
Les 100 portes de l’Europe centrale et orientale, par Jean-Yves POTEL, Ed de l’Atelier Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bosine, Macédoine, Albanie et Bulgarie. La période couverte par cet ouvrage (les dix dernières années) est mise en relation avec le passé récent (la période soviétique) et les traditions de nations parmi les plus vieilles d’Europe. Longtemps réduits à une seule caractéristique ( » communiste « ), ces pays empruntent des voies diverses, originales, parfois tragiques, mais affirment tous la singularité de leur histoire, de leurs ambitions.
La démocratie se lève à l’est : société civile et communisme en Europe de l’Est : Pologne et Hongrie par Miklós MOLNAR, PUF L’Europe communiste est décomposée et les démocraties ont vu le jour : Par le biais de la Pologne et de la Hongrie, l’auteur examine le long processus d’évolution, semé d’embûches et d’échecs, qui a conduit à la désintégration du système communiste, et la difficile mutation économique.
[actu]Témoins et acteurs[actu]
Acteurs directs, journalistes, photographes ou membres d’organismes humanitaires ont livré des témoignages qui complètent et illustrent les analyses des historiens ou des spécialistes des idées politiques mentionnés précédemment.
Budapest 1956 par André FARKAS, Tallandier « Une révolution naissait sous mes yeux. J’ai rejoint en courant mon bureau de rédacteur de politique étrangère à Budapest Soir, en plein centre-ville, croisant en chemin des groupes de jeunes gens, fusil en bandoulière. Pour qui avait été élevé au marxisme-léninisme, le constat s’imposait : c’était le peuple de Budapest, étudiants, ouvriers, employés, militaires, qui se soulevait contre la dictature hongroise sous tutelle soviétique. Et Budapest, à cet instant, devenait le centre du monde. Les chars russes qui, après douze jours d’espoir irréel, sont venus nous écraser, je les ai vus aussi. J’avais vingt-deux ans. C’était hier. Je me souviens de tout. «
L’Octobre hongrois : entre croix rouge et drapeau rouge par Isabelle VONECHE-CARDIA, Bruylant L’auteur analyse à partir des archives du CICR l’action de l’institution humanitaire en Hongrie lors des événements de 1956, action qui a connu des prolongements jusque dans les années 60. L’auteur met en lumière un double aspect, peu connu, des relations entre l’est et l’ouest pendant la guerre froide : comment, d’un côté, une politique sans faille utilise à son profit tout ce qu’un « humanitarisme bourgeois » peut lui apporter, tandis que de l’autre, conscient d’être utilisé, le CICR accepte de se fondre dans la réalité du monde communiste dans l’espoir d’accéder un jour aux détenus politiques au-delà du rideau de fer.
Budapest 1956. La Révolution , collectif, Biro Présente près de 200 clichés du photographe autrichien Erich Lessing (Magnum photo) montrant la Hongrie communiste, l’insurrection triomphante et les images terribles de son écrasement.
A Lyon, l’association « Amitiés France-Hongrie Rhone-Alpes« a pour objet de susciter et de promouvoir les échanges dans tous les domaines entre la France et la Hongrie. 50 ans après le soulèvement de Budapest, cette association propose une série de conférences pour célébrer cet anniversaire.
(programme complet et bilbiographie en pièce jointe)




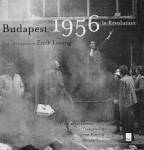





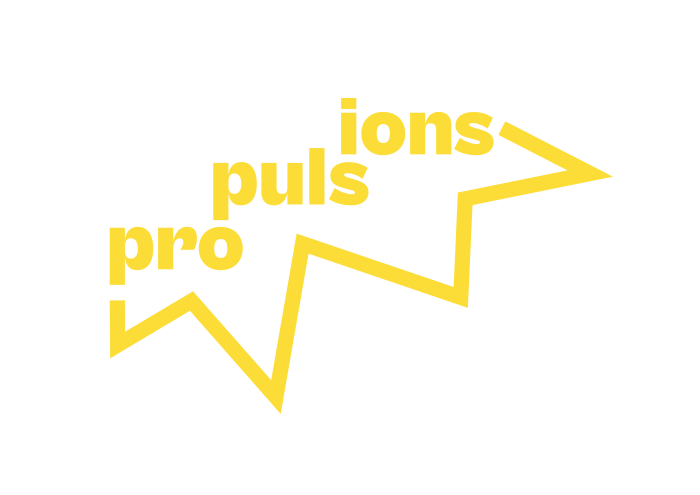
Partager cet article