A l'abordage !
Publié le 15/05/2007 à 23:00
-  11 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
11 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
« Je suis de ceux qui goûtent fort les bandits, non que j’aime à les rencontrer sur mon chemin ; mais, malgré moi, l’énergie de ces hommes en lutte contre la société tout entière m’arrache une admiration dont j’ai honte » Mérimée (cité dans « Les pirates » de G. Lapouge)
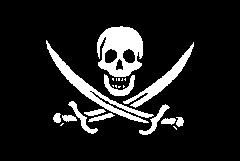
Pirates et corsaires sont, à première vue, bien distincts : les pirates sont des brigands, des voleurs des mers, les corsaires sont des « guerriers à la commission » dûment autorisés à courir sur les navires ennemis, en temps de guerre seulement, et soumis à un contrôle rigoureux.
Dans la pratique, course et piraterie furent souvent mêlés. Le mot ‘corsaire’, vient de course, lui-même tiré du corso méditerranéen, opération qualifiée de brigandage par les historiens.
Mais la course et la piraterie sont deux phénomènes bien différents : la piraterie est vielle comme le monde, et existe toujours, tandis que les corsaires ont sévit durant trois siècles (du XVIe au XIXe).
[actu]Pirates[actu]
Les pirates par Gilles LAPOUGE, Phébus Cet ouvrage ne se borne pas à raconter l’histoire de la Piraterie, il en traite comme d’une révolte, peut-être la plus extrême, en tout cas la plus longue qu’au comme l’humanité. Les figures ténébreuses et fascinantes qui sont évoquées ici – des Barbaresques aux Flibustiers, des Boucaniers aux écumeurs de la mer de Chine – accomplissent leur révolte à la fois dans l’Histoire et hors de celle-ci. Le pirate, ainsi que le fait revivre pour nous Gilles Lapouge, se dresse d’abord contre l’ordre qui régit la société, mais aussi contre l’image qu’il se fait de la condition humaine. Un texte déjà considéré comme un classique, par l’un des meilleurs écrivains de l’époque.
Sous le pavillon noir : pirates et flibustiers par Philippe JACQUIN, Gallimard Eternels révoltés, aventuriers sans scrupules, gueux assoiffés de richesse ou précurseurs audacieux de sociétés égalitaires, les pirates ont traversé les siècles sans cesser de fasciner.
Surgie en Méditerranée à l’époque hellénistique, la piraterie s’étend rapidement à toutes les mers du monde, connaissant son apogée dans les Caraïbes aux XVIIe et XVIIIe siècles – époque de la mythique île de la Tortue avant de s’essouffler au XIXe siècle.
Deux volumes, Les chemins de fortune et le grand rêve flubustier, constituent la célèbre « Histoire générale des plus fameux pyrates » de Daniel Defoe Publiée en 1726 par un mystérieux Captain Johnson, cette bible des historiens de la piraterie n’était qu’à moitié traduite en français. C’est Christopher Hill qui a acquis la certitude, après 20 ans d’enquête, que l’auteur n’est autre que celui de Robinson Crusoë.
Le premier tome présente 38 récits véridiques et le second nous raconte l’histoire de ces utopistes issus de la racaille des mers, qui réalisèrent dans les mers du sud, un siècle avant la Révolution, quelques modèles troublants de contre-société, preuve qu’une autre révolte anime la grande légende des vaisseaux noirs.
[actu]Corsaires[actu]
Histoire des corsaires par Auguste TOUSSAINT, Presses universitaires de France Ce « Que sais-je ? » fait le point sur le phénomène, à travers les époques et les mers du globe, mais aussi sur l’entreprise corsaire, ses armements, ses règlements et le partage du butin…
Robert Surcouf, le corsaire invincible par théophile BRIANT, F. Lanore Surcouf quitte l’école à 13 ans pour s’embarquer sur un navire de commerce. Son humeur aventureuse l’amène aux Indes, et en revient à 17 ans avec le grade de lieutenant. Successivement, il prend le commandement de l’Emilie, la Clarisse et de la Confiance, le Revenant, le Charles. Ces navires servirent ses plus audacieuses entreprises, dont la plus célèbre est la prise du vaisseau le Kent, en 1800 et achevèrent de faire sa fortune.
Filmographie pirate : …des Caraïbes, et d’ailleurs

[actu]Témoignages, récits de faits d’armes[actu]
Mémoires d’un corsaire par DUGAY-TROUIN, Paléo Avec Jean Bart et Forbin, René Dugay-Trouin fut le capitaine de vaisseau le plus admiré de son temps.
Paisible marin en temps de paix, il fut le plus redoutable corsaire français au service de Sa Majesté Louis le Quatorzième. Ses faits d’armes et ses prises de guerre sont proprement ahurissants. Et son audace si incroyable, qu’il entreprit, et réussit, la prise du riche comptoir portugais de Rio de Janeiro au Brésil.
Mémoires d’un gentilhomme corsaire : de Madagascar aux Philippines 1805-1815 par Edward John TRELAWNEY, Phébus Alexandre Dumas considérait ce » roman vrai » comme le plus fabuleux récit d’aventures qu’il eût jamais lu…
et alla jusqu’à l’inclure quelque temps dans ses propres Œuvres complètes ! Les Anglais quant à eux vouent depuis 150 ans un véritable culte à ce texte – à leurs yeux le plus grand livre qu’un Britannique ait écrit sur la mer avant L’Ile au Trésor. Byron et Shelley s’enthousiasmèrent en leur temps pour ce personnage hors du commun, qui avait fait de l’indiscipline sa religion.
Un flibustier français dans la mers des Antilles présenté par Jean-Pierre MOREAU, Payot Récit anonyme d’un participant à une expédition dans les Antilles qui montre les errances des marins français ainsi que les contacts avec la civilisation indigène, les animaux et les plantes de ces îles. Informe avec précision et sans fioritures sur le langage marin comme sur le langage indien.
[actu]A travers les mers du globe[actu]
Les Caraïbes au temps de flibustiers par Paul BUTEL, Aubier Une vaste synthèse de l’histoire aventureuse des Caraïbes, des premières tentations flibustières à la mainmise des Etats européens sur les iles.
Pirates et aventuriers des mers du sud par Alan J. VILLIERS Retrace les aventures des marins, pirates, chasseurs de baleines qui croisaient au large des côtes australiennes au XIXe siècle.
Pirates et corsaires dans les mers de Provence XVE-XVIe siècles présenté par Philippe RIGAUD, Ed. du CTHS Dans cet ouvrage sont présentés cent textes écrits entre la fin du XVe et la fin du XVIe siècle, relatant et décrivant sous forme de témoignages directs, la situation d’un littoral provençal quotidiennement confronté aux attaques et pillages venus de la mer. Ces lettres, extraites d’un corpus de plus de 4000 documents originaux presque tous écrits en occitan, sont issues des archives de la ville d’Arles. Elles émanent des localités côtières, villes et villages placés en situation de témoins et de victimes face à la guerre de course et à la piraterie.

Le dernier corsaire 1914-1918 par Félix de LUCKNER, Ed La bibliothèque Dans cet ouvrage paru en 1927, Felix von Luckner (1881-1966) raconte comment au cours de l’année 1917 et en tant que capitaine d’un voilier corsaire, il coula quatorze cargos alliés, fut coulé à son tour, s’échoua sur un atoll du Pacifique et réussit à regagner les îles Cook. Il fut fait prisonnier sur la route des Fidji et vécut la fin de la guerre dans un camp de prisonniers néo-zélandais.
[actu]Utopies pirates : de la piraterie aux épopées libertaires[actu]
Au XVIIIe siècle, les pirates et les corsaires créèrent un « réseau d’information » à l’échelle du globe : bien que primitif et conçu essentiellement pour le commerce, ce réseau fonctionna toutefois admirablement. Il était constellé d’îles et de caches lointaines où les bateaux pouvaient s’approvisionner en eau et en nourriture et echanger leur butin contre des produits de luxe ou de première nécessité. Certaines de ces îles abritaient des « communautés intentionnelles », des micro-sociétés vivant délibérement hors-la-loi et bien déterminés à le rester, ne fût-ce que pour une vie brêve, mais joyeuse. Propos tenus par Hakim Bey, dans TAZ : zone d’autonomie temporaire, ed. de l’éclat

Bastions pirates, collectif, Aden Durant » l’Age d’Or » de la piraterie, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, des équipages composés des premiers rebelles prolétariens et des exclus de la civilisation, pillèrent les voies maritimes entre l’Europe et l’Amérique.
Ils opéraient depuis des enclaves terrestres, des ports libres, des » utopies pirates » situées sur des îles ou le long des côtes, hors de portée de toute civilisation. Depuis ces mini-anarchies – des » Zones d’Autonomie Temporaire » – ils lançaient des raids si fructueux qu’ils déclenchèrent une crise impériale, en s’attaquant aux échanges britanniques avec les colonies, et en écrasant le système d’exploitation globale, d’esclavage et de colonialisme qui se développait.
Utopies pirates, par Peter Lamborn WILSON, Dagorno Au 17e siècle, à l’emplacement de Rabat, s’élevait la ville de Salé, constituée en république pirate indépendante.
Dirigée par un conseil élu de corsaires, elle traitait d’égal à égal avec les puissances européennes tandis que ses navires écumaient les mers. Beaucoup d’entre eux étaient des chrétiens européens dits renégats parce que convertis à l’islam. Ils furent alors des milliers (hommes et femmes) à fuir l’Europe pour s’établir non seulement à Salé mais aussi à Alger ou à Tunis. Pourquoi un tel choix ?
L’absolutisme tombait comme une chape de plomb sur l’Europe, l’islam représentait alors une forme de liberté unique à l’époque. Une préfiguration d’une société libertaire ?
Voir aussi « Libertalia » dans « L’Histoire générale des plus fameux Pirates » de Daniel Defoe, cité plus haut.
Defoe relate, dans cet extrait, l’épopée du capitaine Misson et de son complice Caraccioli, curé défroqué et “rouge” avant l’heure. Ils réussissent à convaincre les hommes de l’équipage d’adhérer à leur projet révolutionnaire : fonder une “nouvelle république maritime”.
Misson et l’équipage s’engagent dans une série d’attaques de navires, toutes couronnées de succés, ne prenant pour butin que ce dont ils ont besoin et laissent leurs proies repartir librement. Ils se mettent à construire une société purement socialiste à Madagascar : Libertalia. La propriété privée est abolie et toutes les richesses mises en commun, un nouveau langage est inventé, mélange de français, d’anglais, de hollandais et de portugais.
Cette utopie pirate a été florissante pendant quelques années jusqu’à ce que les indigènes de l’île les chassent.
 Le drapeau noir, ou Jolly Roger, semble être une anglicisation de Joli Rouge, nom donné au drapeau rouge utilisé par les pirates signifiant ‘Pas de quartier’ : le drapeau rouge est internationalement reconnu comme le symbole de la révolution prolétarienne et de la révolte, le drapeau noir est historiquement celui du mouvement anarchiste. (Voir Bastions pirates cité plus haut, et sur Wikipédia Jolly Roger et drapeau noir)
Le drapeau noir, ou Jolly Roger, semble être une anglicisation de Joli Rouge, nom donné au drapeau rouge utilisé par les pirates signifiant ‘Pas de quartier’ : le drapeau rouge est internationalement reconnu comme le symbole de la révolution prolétarienne et de la révolte, le drapeau noir est historiquement celui du mouvement anarchiste. (Voir Bastions pirates cité plus haut, et sur Wikipédia Jolly Roger et drapeau noir)









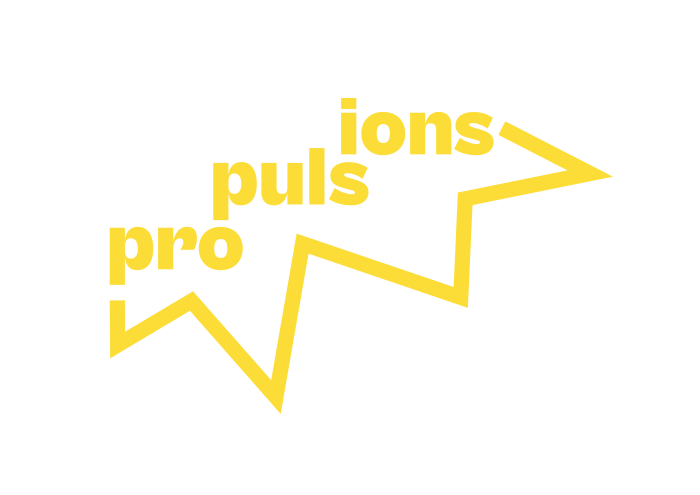
Partager cet article