De l’autre côté de la scène, le spectateur
Publié le 13/08/2016 à 12:40
-  12 min -
Modifié le 20/01/2021
par
le département Arts Vivants à la médiathèque de Vaise
12 min -
Modifié le 20/01/2021
par
le département Arts Vivants à la médiathèque de Vaise
"Qu'est-ce qu'un bon spectacle ?" s'interroge en une le dernier numéro de la revue Théâtre(s). Au centre de cette question, la notion de jugement critique invite à se pencher sur le moment de la réception. Que se passe-t-il du côté de celui qui regarde un spectacle ? Quel est le rôle et la place du spectateur dans ce rituel que l'on nomme "représentation" ?
Nous avons sélectionné ci-dessous des ressources qui vous permettront d’aborder cette question du spectateur, principalement au théâtre.
S’intéresser à la réception exige […] de zoomer sur cette expérience subjective, caractéristique du spectateur qui est la condition même de l’art. Destinataire du message, il en est la condition sine qua non.
Anne Gonon, In vivo : les figures du spectateur des arts de la rue, p. 112
Quelques définitions
Que l’on parle de « public(s) », de « spectateur » ou de « quatrième mur », l’emploi des termes n’est pas indifférent. En guise d’introduction, une petite mise au clair s’impose…
- L’expression “le quatrième mur” désigne le « mur imaginaire faisant face au mur du fond de scène » et qui tend à gommer la présence du spectateur pour permettre aux comédiens de ne pas être distraits dans leur jeu :
Si le comédien doit toujours suivre les impressions de la salle du bout de l’oreille, il doit n’en rien laisser paraître, jouer comme s’il était chez lui, sans se préoccuper de l’émotion qu’il soulève, des bravos ou des chuts ; il faut que l’emplacement du rideau soit un quatrième mur transparent pour le public, opaque pour le comédien.
Jean Jullien, Le Théâtre vivant, 1892 (cité dans le Dictionnaire de la langue du théâtre)
- La notion de public(s) est omniprésente dans les discours. On cherche à attirer du public, on se réjouit d’un public nombreux ou on regrette son absence, on analyse des catégories de publics… Dans son ouvrage sur les figures du spectateur des arts de la rue, Anne Gonon s’attache à préciser le terme :
Il s’agit de l’assemblée, dans un temps limité, d’un groupe d’individus – les spectateurs. Cette assemblée n’est pas le collage de ces individualités mais une tierce entité, qui développe des logiques de comportements et de réactions.
Anne Gonon, op. cit. p. 112
- Le terme de spectateur, lui, individualise celui qui regarde, ressent, comprend et juge ce qui se passe sur scène. Il nous rappelle que l’exercice de la réception reste une expérience fondamentalement personnelle.
La préoccupation première, dans le secteur culturel, est souvent celle du public – qui est d’ailleurs parfois perçu comme un problème. Adopter le prisme du spectateur, c’est opter pour une posture qualitative et sensible, focaliser sur la nature de la relation qui s’instaure entre l’œuvre, quelle qu’elle soit, et celui qui la regarde.
A. Gonon, op. cit. p. 112
Coups de cœur
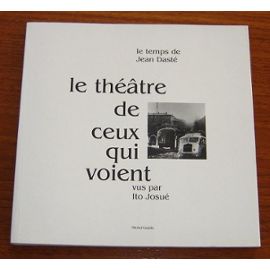
- Le théâtre de ceux qui voient / vus par Ito Josué / 1994 [Livre]
Photographies d’Ito Josué accompagnées de textes et témoignages signés Ito Josué, Jean Dasté, Jean-Jacques Lerrant, Jean-Louis Hourdin, Robert Abirached, Catherine Bernard….
C’est en 1947, à Saint-Étienne, que Jean Dasté (1904-1994) fonde et dirige le Centre dramatique de la Cité des mineurs (actuellement Comédie de Saint-Étienne) dont la troupe sillonnera les routes de la région stéphanoise pendant près de dix ans. Elle parvient à attirer un public populaire qu’elle initie au répertoire des grands classiques français et étrangers : Molière, Shakespeare, Tchekhov. L’œil attentif, « présent et ami », du photographe Ito Josué (1924-2010) capte les moments forts de ce théâtre proche de son public. Une photographie simple, directe, à l’image de l’homme qui fut au cœur de cette entreprise, nous dévoile le jeu des acteurs, les coulisses du théâtre, l’émotion des spectateurs.
- Le Dico du spectateur [Site internet]

Depuis 2009, le Dico du spectateur collecte sur Internet les dits et écrits de spectateurs, mis en écriture par Joël Kérouanton, écrivain. “Arthrosé”, ‘Blasé (mais accro)”, “Maso” ou encore “Qui-se-demande-ce-qu’il-fait-là”… Voici le spectateur dans tous ces états, à travers des définitions qui fleurent bon le vécu !
Être spectateur : plaisir… ou ennui !
Une véritable circulation entre la scène et la salle – qui est plus qu’une affaire d’espace – s’invente à chaque fois et elle ne saurait être ni définitive ni à sens unique. Notre plaisir vient aussi de là. Non d’être converti en un consommateur immobile, calibré, respectueux, mais de jouir du sentiment d’être à la fois soi-même et un autre et de pourvoir vivre une incessante transformation.
Bernard Dort, Le spectateur en dialogue, p. 78.
- Le plaisir du spectateur de théâtre / Florence Naugrette / 2002 [Livre]
Le théâtre est avant tout un divertissement. Qui émeut, qui enseigne, qui interroge, qui conforte ou qui dérange, mais qui, dans tous les cas, vise à produire sur le spectateur le plaisir qu’il est venu chercher. C’est de ce plaisir qu’il est ici question. Histoire du théâtre, poétique et dramaturgie, analyse des textes et de la représentation, les diverses disciplines de la théâtrologie sont ici présentées sous l’angle du plaisir du spectateur, envisagé comme la cause finale du théâtre.
- Le théâtre m’ennuie / Revue JEU n°141/ 2011 [Revue]
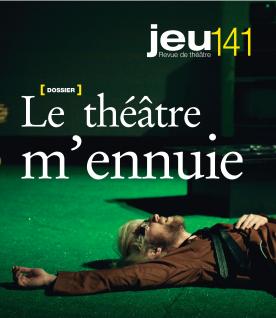
Ce numéro consacre un dossier complet à l’ennui au théâtre, avec la contribution d’artistes, de spectateurs avertis et parfois blasés, et d’éminents spécialistes de l’ennui. Un article propose 10 stratégies imparables, dont certaines très radicales, pour survivre à un mauvais spectacle de théâtre. Des conseils dont, nous l’espérons, vous n’aurez pas à vous inspirer pour la saison théâtrale à venir ! Lien vers notre catalogue
Apprendre à être spectateur
On ne naît pas spectateur, on le devient. De la primaire au lycée, les arts du spectacle constituent une “école de l’écoute et du regard”. La sortie au spectacle est un moment de plaisir, de liberté et de fête, qui mérite toutefois un apprentissage et que les enseignants doivent savoir accompagner. En effet, aller au spectacle est une démarche qui peut intimider, et pour certains élèves, ce sera parfois une première. Apprendre aux élèves à affiner et à affirmer leurs goûts et leur jugement, éveiller leur sensibilité, leur transmettre les codes du spectacle… autant de pistes que ces ressources vous aideront à développer si vous vous intéressez à ces questions.
- Devenir spectateur, Centre régional de documentation pédagogique du Limousin / 2000 [Livre]
Un ouvrage pratique, utile pour les pédagogues au niveau collège et lycée, qui invite à mettre en place une série d’activités autour des spectacles, sous forme de “parcours” : visite d’un théâtre, utilisation des écrits professionnels, travail sur des textes, rencontre avec des artistes, découverte des métiers du spectacle…
- Le petit specta(c)teur / Théâtre jeune public de Strasbourg / 2003 [Livre]
 “Manuel illustré à l’usage des enfants qui aimeraient bien aller au théâtre un dimanche après-midi d’hiver ou même un mercredi après-midi de printemps […] ce serait le bonheur…” Très beau petit livre au graphisme très énergique, proposant une histoire puis présentant les aspects plus techniques d’un spectacle. L’enfant y découvrira les coulisses de la fabrication d’un spectacle ainsi que les choses à faire et à ne pas faire quand on va au théâtre : “A la fin du spectacle, inutile de jeter des pièces ou des tomates aux acteurs, en principe ils sont nourris avant ou après le spectacle” !
“Manuel illustré à l’usage des enfants qui aimeraient bien aller au théâtre un dimanche après-midi d’hiver ou même un mercredi après-midi de printemps […] ce serait le bonheur…” Très beau petit livre au graphisme très énergique, proposant une histoire puis présentant les aspects plus techniques d’un spectacle. L’enfant y découvrira les coulisses de la fabrication d’un spectacle ainsi que les choses à faire et à ne pas faire quand on va au théâtre : “A la fin du spectacle, inutile de jeter des pièces ou des tomates aux acteurs, en principe ils sont nourris avant ou après le spectacle” !
- Théâtre et jeunes spectateurs : itinéraires, enjeux et questions artistiques / Association du théâtre pour l’enfance et la jeunesse / 2013 [Livre]
Cet ouvrage collectif reprend l’histoire du théâtre jeune public en France, jusqu’en 2012 et aborde les enjeux de relations possibles entre création théâtrale contemporaine et jeunes spectateurs. Il invite à considérer les enfants comme des spectateurs à part entière et aborde entre autres la question de l’accompagnement du jeune spectateur de théâtre et celle de l’accès aux œuvres.
- Sortir au théâtre à l’école primaire / Martine Legrand / 2004 [Livre]
C’est en prenant ses distances avec l’idée même d’un utilitarisme scolaire que le théâtre jeune public a trouvé sa place dans le champ de l’école. L’auteur propose de nombreuses pistes de travail qui donnent sens à la démarche du jeune spectateur , organisent la constitution d’une mémoire sensible, et encadrent les pratiques artistiques dont la sortie au théâtre suscitent l’envie.
- Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle vivant : acteurs culturels, enseignants, parents, petite enfance / Cyrille Planson / 2008 [Livre]
A quel âge un enfant peut-il découvrir son premier spectacle ? Au théâtre, quels sont ses centres d’intérêt ? Peut-on parler de tout dans les spectacles ? Un enfant spectateur deviendra-t-il un adulte spectateur ? Aller au spectacle à six mois, c’est possible ? Quelle exploitation pédagogique du spectacle envisager en classe ? Autour de questionnements simples, cet ouvrage apporte des réponses aux parents, enseignants, professionnels de la petite enfance et acteurs de la vie culturelle qui accompagnent les premiers pas des enfants dans les salles de spectacles. Il propose des conseils pratiques, étayés de nombreux témoignages inédits d’artistes et de médiateurs.
L’Ecole du spectateur
Apparue au xxe siècle, la notion d'”école du spectateur” désigne « une démarche éducative par laquelle les élèves apprennent à devenir des spectateurs actifs et désirants et à appréhender le théâtre comme une pratique artistique vivante, au-delà de la seule expérience de l’analyse littéraire des textes. » (Charte nationale de l’Ecole du spectateur)
Impulsée en France par l’ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale), elle repose sur trois principes : la fréquentation de l’œuvre, la contextualisation de l’œuvre et la pratique artistique. Le travail de sensibilisation à l’Art et à la Culture constitue désormais une dimension reconnue, nécessaire et incontournable de la formation des jeunes dans le cadre scolaire, de l’école primaire au lycée.
- Présentation de l’Ecole du spectateur sur le site de l’ANRAT [Site internet]
- Charte nationale de l’Ecole du spectateur [en ligne]
- Vademecum : Accompagner les élèves au spectacle [en ligne]
Autres ressources sur la question du spectateur
- Qu’est-ce qu’être spectateur ? / Olivier Neveux et Christian Ruby / revue Théâtre(s) n°5 / printemps 2016 [Article]
Cet article fait partie d’un dossier complet intitulé “Spectateurs de théâtre : qui êtes-vous ?”.
- Figurations du spectateur : une réflexion par l’image sur le théâtre et sur sa théorie / Marie-Madeleine Mervant-Roux, L’Harmattan, 2006. [Livre]
La “question du public”, selon la formule usuelle, constitue pour tous les observateurs du théâtre contemporain une question majeure. L’hypothèse développée dans cet ouvrage est qu’elle est en effet cruciale, mais ne se situe pas là où on le croit, l’élément décisif n’étant ni le taux de remplissage ou de satisfaction des salles, ni le degré d’activité visible de leurs occupants, mais la nature de la fonction octroyée au spectateur.
- Introduction à l’anthropologie du spectacle / Jean-Marc Leveratto / 2006 [Livre]
La démarche anthropologique consiste, ici, à étudier la manière dont le spectateur prend plaisir au spectacle, comment il apporte sa compétence artistique et sa sensibilité personnelle, son attention aux choses et aux personnes pour contrôler ce qui se joue dans la magie du spectacle. Il s’agit aussi de comprendre comment ce savoir ordinaire peut servir au développement d’une commune humanité.
- Le spectateur en dialogue / Bernard Dort / 1995 [Livre]
Mélange de chroniques et d’essais, ce recueil permet de saisir ce qu’il y avait de plus personnel dans l’expérience du spectateur que fut Bernard Dort, universitaire, théoricien et praticien de théâtre.
- In vivo : les figures du spectateur des arts de la rue / Anne Gonon / 2011 [Livre]
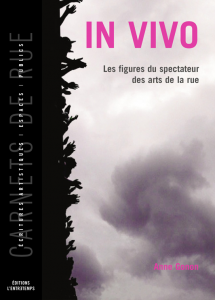
Dans cet essai, Anne Gonon propose au lecteur un voyage au cœur de la relation qui s’instaure entre artistes et spectateurs. Après une traversée de l’histoire dense de ce mouvement artistique né dans les années 70, au sein duquel la question du public est centrale, elle explore l’expérience de la réception, pour mieux cerner les enjeux et les paradoxes du spectateur des arts de la rue. La complexité du rapport au spectateur, marquée par une esthétique de la réception, se trouve mise en lumière. Des récits de spectacles complètent l’analyse, offrant au lecteur un contrepoint subjectif et une évasion sensible.
- Théâtre et réception : le spectateur postdramatique / Catherine Bouko / 2010 [Livre]
- Cultures & non-public / Francis Jeanson / 2009 [Livre]
Recueil de textes écrits dans les années 1960, envisageant une culture en acte, en train de se faire, et non pas la culture comme un ensemble de produits culturels. Ils interrogent l’action politique en matière d’action culturelle et forgent le concept de non-public, composé des oubliés des dispositifs culturels.
Le spectateur comme personnage
Une sélection non exhaustive de pièces de théâtre qui font la part belle au spectateur en tant que personnage à part entière.
- Sortie de théâtre, un soir de pluie / Jean-Claude Grumberg / 2000 [Livre]
“Sortie de théâtre est une tentative de récupération de répliques glanées, pour la plupart, dans la bouche même des spectateurs sortant du Vieux-Colombier après avoir assisté – à leur corps défendant, semble-t-il – à une représentation de Maman revient pauvre orphelin.” Note introductive de l’auteur
- La sortie au théâtre / Karl Valentin / 1984, 1993 [Livre]
Comédie, pièce courte – 1 homme 1 femme
Ce sketch, écrit au début du XXe siècle, met en scène une femme et son mari qui se posent beaucoup de questions après que leur voisine leur a offert deux places pour aller au théâtre. On est à la frontière du rire et de l’absurde…
- Tragédie / Jean-Michel Ribes / 2004 1993 [Livre]
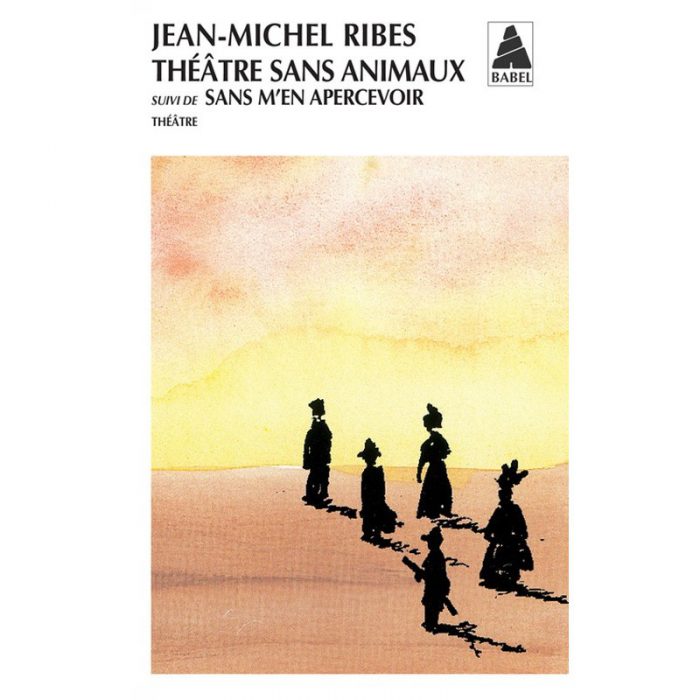 Comédie, pièce courte – 2 femmes 1 homme
Comédie, pièce courte – 2 femmes 1 homme
C’est l’une des 8 pièces facétieuses du célèbre recueil Théâtre sans animaux. Un homme refuse de dire « bravo » à sa belle-sœur qui vient de jouer Phèdre malgré les suppliques de sa femme. Ou quand le spectateur ose se libérer du carcan des jugements convenus… Une pièce irrésistiblement drôle !
« Quand je pense que j’ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement deux cent vingt-trois minutes et dix-sept secondes ! »
- Le spectateur condamné à mort / Matéi Visniec / 2006
Drame parodique en 2 actes – 6 hommes 2 femmes
Écrite en Roumanie sous Ceaucescu, cette pièce exprime sur un mode férocement comique le sentiment d’oppression de l’auteur face au totalitarisme obtus et omniprésent. La salle a la forme d’un tribunal. Forcément, une partie des spectateurs occupe la loge du jury. Les autres deviennent témoins. Un spectateur est choisi au hasard et le Tribunal commence à le juger. Il est déclaré coupable. Les principaux témoins sont l’Homme qui déchire les billets, la Vestiaire, la Grosse Serveuse du buffet, le Photographe du théâtre, le Metteur en scène, l’Homme qui attend devant le théâtre, le Clochard aveugle qui joue de l’harmonica au coin de la rue…
- By Heart (Apprendre par cœur) / Tiago Rodrigues / 2015 [Livre]
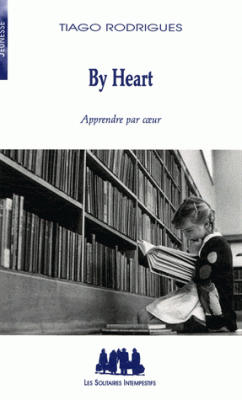
Monologue, 1 homme
Dans By Heart, Tiago Rodrigues nous conte une histoire : celle de sa grand-mère qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu’elle pourrait apprendre par cœur. Mais que signifie au juste « apprendre un texte par cœur » ? Et comment se tenir, avec le public, au plus près de cette question, de son urgence, de sa charge ? se demande le jeune metteur en scène portugais. En conviant chaque soir dix spectateurs à accomplir ce geste, Tiago Rodrigues ne se contente pas de brouiller les frontières entre le théâtre, la fiction et la réalité. Il invite des hommes et des femmes, le « peloton sonnet 30 de Shakespeare », à éprouver, partager, le temps de la représentation, une expérience singulière : celle de retenir un texte et de le dire. Un acte de résistance artistique et politique, tout autant qu’une lutte contre le temps, l’oubli, le vieillissement, contre l’absence et la disparition. Un geste aussi intime que politique. (source : theatre-contemporain.net)






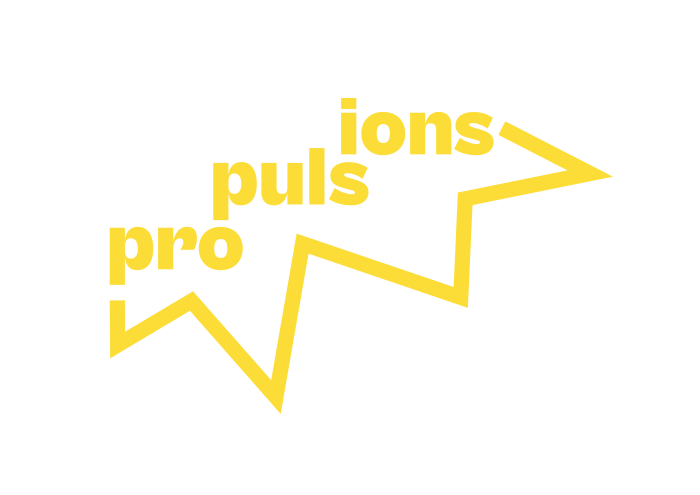



Partager cet article