Turquie : de la démocratie autoritaire à la dictature
Publié le 16/04/2018 à 17:26
-  6 min -
Modifié le 17/04/2020
par
L'anagnoste
6 min -
Modifié le 17/04/2020
par
L'anagnoste
Près d’un siècle après l’installation d’une République laïque sous la férule de Mustafa Kemal Atatürk, la Turquie semble être à la fin de son parcours démocratique. Cette république, bien que menacée à plusieurs reprises dans la deuxième moitié du XXe siècle par des turbulences politiques de divers ordres, avait jusqu’à présent été préservée dans ses principes, et avec elle le jeu démocratique. Le président actuel, pourtant élu avec « seulement » 51,8 % des voix, a en tout cas fait le choix de l’autocratie.
Aux portes de l’Orient, et orientale pour le touriste venu de l’Occident, la Turquie a longtemps paru européenne, en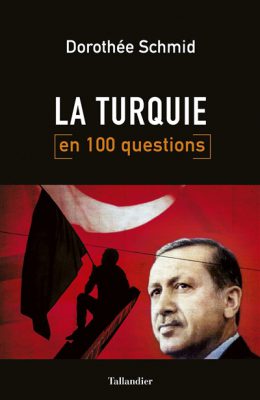 dépit d’un territoire très majoritairement situé en Asie – c’est la petite portion située en Europe qui lui permettra de prétendre à une adhésion à l’Union européenne. L’échec, pour l’heure sans appel, des négociations en vue de cette adhésion ont conduit le pays à se tourner vers le Moyen-Orient dont il partage encore la religion, l’islam. Encore, car le turc s’écrivait depuis 950 en alphabet arabe, la langue de l’islam, date à laquelle les ancêtres des Ottomans alors au pouvoir en Turquie avaient adopté cette religion. Toutefois, la langue turque s’accommodait mal de cet alphabet arabe qui, notamment, ne savait pas écrire ses voyelles puisqu’il n’en possède pas. La « révolution des signes » mise en œuvre en 1928 par Mustafa Kemal Atatürk, et qui imposa un alphabet dérivé de l’alphabet latin, fut d’ailleurs un succès – elle facilita entre autres l’alphabétisation des classes pauvres en leur offrant une écriture correspondant aux sons de leur langue.
dépit d’un territoire très majoritairement situé en Asie – c’est la petite portion située en Europe qui lui permettra de prétendre à une adhésion à l’Union européenne. L’échec, pour l’heure sans appel, des négociations en vue de cette adhésion ont conduit le pays à se tourner vers le Moyen-Orient dont il partage encore la religion, l’islam. Encore, car le turc s’écrivait depuis 950 en alphabet arabe, la langue de l’islam, date à laquelle les ancêtres des Ottomans alors au pouvoir en Turquie avaient adopté cette religion. Toutefois, la langue turque s’accommodait mal de cet alphabet arabe qui, notamment, ne savait pas écrire ses voyelles puisqu’il n’en possède pas. La « révolution des signes » mise en œuvre en 1928 par Mustafa Kemal Atatürk, et qui imposa un alphabet dérivé de l’alphabet latin, fut d’ailleurs un succès – elle facilita entre autres l’alphabétisation des classes pauvres en leur offrant une écriture correspondant aux sons de leur langue.
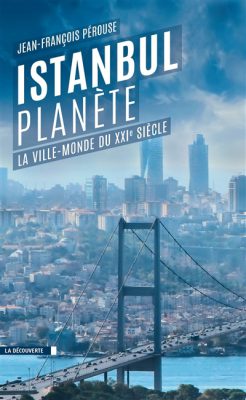 Meurtrie par son incapacité à satisfaire aux 35 chapitres de l’acquis communautaire – 14 avaient été ouverts et un seul refermé, c’est-à-dire validé, celui intitulé « science et recherche » – la Turquie, qui avait justement entrepris de restaurer son image auprès des Européens et des Américains au début des années 2000 dans la perspective de sa demande d’adhésion, se tourna vers la scène moyen-orientale, Recep Tayyip Erdoğan imaginant qu’elle pourrait être un modèle pour cette région en proie à une déstabilisation engendrée par ses « printemps ». Puisque décidément l’Union européenne ne voulait pas de la Turquie, et que son économie en assez bonne santé ne représentait qu’un atout mineur aux yeux des Européens au vu, notamment, de son respect insuffisant des droits de l’homme, Recep Tayyip Erdoğan chercha à mettre à profit le pouvoir d’influence que lui offrait sa position géostratégique au carrefour de l’Orient et de l’Occident. D’autant plus
Meurtrie par son incapacité à satisfaire aux 35 chapitres de l’acquis communautaire – 14 avaient été ouverts et un seul refermé, c’est-à-dire validé, celui intitulé « science et recherche » – la Turquie, qui avait justement entrepris de restaurer son image auprès des Européens et des Américains au début des années 2000 dans la perspective de sa demande d’adhésion, se tourna vers la scène moyen-orientale, Recep Tayyip Erdoğan imaginant qu’elle pourrait être un modèle pour cette région en proie à une déstabilisation engendrée par ses « printemps ». Puisque décidément l’Union européenne ne voulait pas de la Turquie, et que son économie en assez bonne santé ne représentait qu’un atout mineur aux yeux des Européens au vu, notamment, de son respect insuffisant des droits de l’homme, Recep Tayyip Erdoğan chercha à mettre à profit le pouvoir d’influence que lui offrait sa position géostratégique au carrefour de l’Orient et de l’Occident. D’autant plus  après les accords avec l’Europe sur le contrôle et l’accueil des réfugiés en provenance de l’Irak et de la Syrie. Néanmoins, membre de l’OTAN, la Turquie, comme elle l’a montré tout récemment en manifestant son approbation vis-à-vis des frappes occidentales sur l’arsenal chimique syrien, reste un allié militaire de l’Occident. Quant au modèle qu’Erdoğan voulait être pour le Machrek, il ne séduisit aucun des pays qu’il tenta de convaincre.
après les accords avec l’Europe sur le contrôle et l’accueil des réfugiés en provenance de l’Irak et de la Syrie. Néanmoins, membre de l’OTAN, la Turquie, comme elle l’a montré tout récemment en manifestant son approbation vis-à-vis des frappes occidentales sur l’arsenal chimique syrien, reste un allié militaire de l’Occident. Quant au modèle qu’Erdoğan voulait être pour le Machrek, il ne séduisit aucun des pays qu’il tenta de convaincre.
La Turquie nous paraissait également européenne par son régime politique. La république fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, république de surcroît laïque à partir de 1937, plaçait le pays dans une forte proximité avec ce que l’on appelle l’Occident. Cependant, les « révolutions » turques ne furent jamais initiées par le peuple. Elles étaient orchestrées par les élites sociales, politiques et militaires, et pour tout dire sous la férule de régimes autoritaires. Le peuple, en particulier celui des campagnes, largement analphabète et très attaché à la religion, était tenu à l’écart de ces processus politiques car considéré comme trop fruste pour y participer et même comme un danger pour la modernité du nouveau régime. Pourtant, ce peuple fut invité à voter et aujourd’hui les élections turques attestent des taux de participation élevés (autour de 80 %) et ne sont pas soupçonnables d’être viciées par la fraude.
L’État-nation turc fondé sur un modèle centralisateur à la française ne sut pas en retour traiter la diversité de ses populations, sociale (villes riches, campagnes pauvres), ethnique (Turcs, Arméniens, Kurdes, Grecs, etc.) et religieuse (sunnites, alévis chiites, orthodoxes grecs, etc.), autrement qu’en l’ignorant et en s’imposant sur tout par la force. Une solide administration et une armée puissante furent les deux instruments de l’autoritarisme turc républicain. Cette histoire singulière, dans l’absolu et dans cette partie du monde, a conduit à cette originalité que la laïcité est défendue en Turquie par l’armée, celle-ci se considérant comme la garante des principes de la république fondée par Atatürk, là où les pouvoirs militaires soutiennent et sont en général soutenus partout dans le monde par les autorités religieuses traditionnelles.
 L’autoritarisme politique servi par l’armée s’est par ailleurs traduit en Turquie par une forme de tradition du coup d’État militaire. Mais là encore, originalité de la Turquie, les militaires interviennent pour « sauver » le pays, le sortir de ses impasses politiques et en général économiques, et restaurer la république. Les coups d’État perpétrés par l’armée furent le plus souvent soutenus par le peuple comme par la bourgeoisie, le but n’étant jamais pour les militaires de conserver le pouvoir – ils le rendent lorsque la démocratie fonctionne à nouveau et que la sécurité règne. En 1961, le coup d’État fut soutenu par la presse, les intellectuels et les universités. En 1971, il visait à révoquer un régime autoritaire qui opprimait la classe ouvrière sans résoudre les contradictions d’un système économique qui oppose bourgeoisie industrielle et bourgeoisie commerciale et terrienne – l’armée regagna ses casernes en 1973, après avoir perdu les élections, réalisant qu’elle avait finalement négligé les revendications populaires et apporté son soutien à la bourgeoisie dans la conduite de la répression. Enfin, en 1980, il s’agissait avant tout d’éradiquer le terrorisme d’extrême-droite et fasciste qui bénéficiait de soutiens au sein de l’appareil d’État et générait une forte insécurité pour la société civile ; il s’agissait aussi de mettre fin aux trafics de drogue et d’armes entre la Turquie et l’Europe, via la Bulgarie, notamment. Sans entrer dans le détail du rétablissement de l’ordre par l’organisation d’un référendum suspect sur une nouvelle constitution – pas de débat démocratique et enveloppes de votre transparentes (!) – , du moins le terrorisme disparut-il du pays au prix de trente mille procès, vingt-cinq mille personnes emprisonnées et de nombreuses condamnations à mort.
L’autoritarisme politique servi par l’armée s’est par ailleurs traduit en Turquie par une forme de tradition du coup d’État militaire. Mais là encore, originalité de la Turquie, les militaires interviennent pour « sauver » le pays, le sortir de ses impasses politiques et en général économiques, et restaurer la république. Les coups d’État perpétrés par l’armée furent le plus souvent soutenus par le peuple comme par la bourgeoisie, le but n’étant jamais pour les militaires de conserver le pouvoir – ils le rendent lorsque la démocratie fonctionne à nouveau et que la sécurité règne. En 1961, le coup d’État fut soutenu par la presse, les intellectuels et les universités. En 1971, il visait à révoquer un régime autoritaire qui opprimait la classe ouvrière sans résoudre les contradictions d’un système économique qui oppose bourgeoisie industrielle et bourgeoisie commerciale et terrienne – l’armée regagna ses casernes en 1973, après avoir perdu les élections, réalisant qu’elle avait finalement négligé les revendications populaires et apporté son soutien à la bourgeoisie dans la conduite de la répression. Enfin, en 1980, il s’agissait avant tout d’éradiquer le terrorisme d’extrême-droite et fasciste qui bénéficiait de soutiens au sein de l’appareil d’État et générait une forte insécurité pour la société civile ; il s’agissait aussi de mettre fin aux trafics de drogue et d’armes entre la Turquie et l’Europe, via la Bulgarie, notamment. Sans entrer dans le détail du rétablissement de l’ordre par l’organisation d’un référendum suspect sur une nouvelle constitution – pas de débat démocratique et enveloppes de votre transparentes (!) – , du moins le terrorisme disparut-il du pays au prix de trente mille procès, vingt-cinq mille personnes emprisonnées et de nombreuses condamnations à mort.
La nouvelle constitution organisa la limitation des droits et libertés et soumit les pouvoir législatifs et judiciaire au pouvoir exécutif. L’armée commença alors à ne plus être exactement « au-dessus de la mêlée », comme elle l’avait longtemps prétendu, et d’ailleurs, le peuple lui signifia lors des législatives de 1983 qu’il lui préférait un parti qui lui était clairement opposé, tandis qu’elle était désormais engagée auprès des forces capitalistes dans les réformes économiques qu’elle avait introduites.
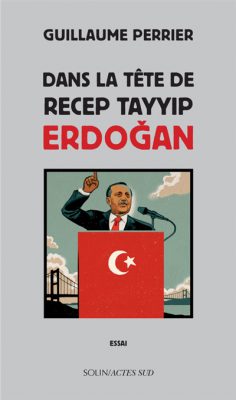 Recep Tayyip Erdoğan, le chef de l’AKP (Parti de la justice et du développement), nommé premier ministre en 2003, a progressivement amené son pays vers la dictature, après avoir pourtant manifesté autour de 2005 des volontés d’ouverture et de démocratisation et entrepris de profondes réformes, y compris
Recep Tayyip Erdoğan, le chef de l’AKP (Parti de la justice et du développement), nommé premier ministre en 2003, a progressivement amené son pays vers la dictature, après avoir pourtant manifesté autour de 2005 des volontés d’ouverture et de démocratisation et entrepris de profondes réformes, y compris 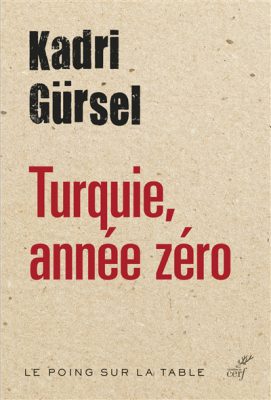 sur la question kurde, quasiment en passe d’être alors réglée pacifiquement : abolition de la peine de mort, droits des minorités et des religions autres que l’islam élargis, renforcement de la liberté d’expression, affaiblissement du rôle de l’armée dans l’administration du pays et libéralisation économique. Erdoğan, désormais président de la République de Turquie, quasiment investi des pleins pouvoirs, s’est depuis lors transformé en autocrate tout puissant et intransigeant.
sur la question kurde, quasiment en passe d’être alors réglée pacifiquement : abolition de la peine de mort, droits des minorités et des religions autres que l’islam élargis, renforcement de la liberté d’expression, affaiblissement du rôle de l’armée dans l’administration du pays et libéralisation économique. Erdoğan, désormais président de la République de Turquie, quasiment investi des pleins pouvoirs, s’est depuis lors transformé en autocrate tout puissant et intransigeant.
Craignant de perdre ses électeurs nationalistes et religieux – ses scores électoraux ne lui laissent que peu de marge de manœuvre : 51,8 % des voix à l’élection présidentielle de 2014 –, il a fait machine arrière à peu près sur tous les points de réforme démocratique engagés : il souhaite aujourd’hui organiser un référendum sur le rétablissement de la peine de la mort, il a renforcé le pouvoir de l’islam dans la société et fait de cette religion la religion dominante, il a repris son combat acharné contre les Kurdes et opéré des purges drastiques d’opposants dans l’armée, la justice, la police, la fonction publique et les médias après le coup d’État manqué de 2016 dont il dit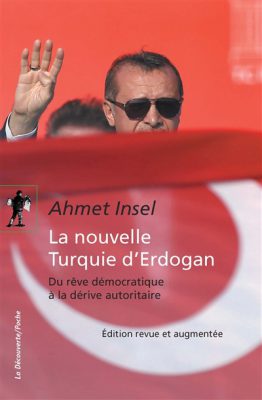 lui-même qu’il fut un « don de Dieu » – pour l’épuration politique qu’il lui permit.
lui-même qu’il fut un « don de Dieu » – pour l’épuration politique qu’il lui permit.
Au vu de l’histoire du pays, on comprend mieux pourquoi Ahmet Insel, interrogé sur l’avenir politique de la Turquie lors de la conférence qu’il prononça à la Bibliothèque municipale de Lyon, donnait pour pronostic, si les droits démocratiques étaient finalement réduits à néant : la guerre civile ou le coup d’État. Malgré l’assaut d’Erdoğan contre toutes les libertés d’expression, la société turque est éduquée à la démocratie et il se pourrait, si l’on considère les succès « passables » du président dans les urnes, qu’elle finisse par reprendre la main d’une manière ou d’une autre.










Partager cet article