L’Étranger
Publié le 09/11/2011 à 00:00
-  19 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
19 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
La définition de l'« Étranger » est large car relative. Tentative de tour d'horizon des définitions basé sur quelques romans et récits exemplaires.
L’étranger est celui qu’on ne voit pas
Sept Fleuves et treize rivières, par Monica Ali, Belfond
Les contacts de Nazneen – une immigrée pakistanaise, l’une de ces silhouettes familières des grandes villes dont les sociétés d’accueil ignorent tout, origine, langue, culture – avec le monde extérieur se réduisent aux histoires de son mari affable, aux visites de voisines qui deviennent vite envahissantes et à celles du Dr Azad, avec qui son mari prétend entretenir une amitié. Ses premiers pas dans Londres, lorsqu’elle s’aventure hors de son appartement – un deux-pièces du quartier de Tower Hamlets, à majorité pakistanaise, à l’Est de Brick Lane – sont le plus beau passage de ce livre. Monica Ali s’amuse aux dépends des Britanniques, sans mépris mais sans clémence. Le mutisme absolu de son personnage, son regard lucide et son courage donnent au récit une pureté rafraîchissante, Nazneen est comme une somnambule, dans une ville qui ne la voit pas. Lorsqu’elle débouche finalement dans le quartier de la City, tout la distingue de la foule alentour : le rythme de ses pas, son ignorance des règles de la circulation, ses vêtements. Monica Ali montre, dans son égoïsme et sa cruauté extrême, l’écrasant anonymat qui entoure Nazneen, dont le regard, étrangement, ne perd jamais de sa douceur.
Le discours sous-jacent sur la condition féminine, l’exil, la refonte d’une identité est renforcé par les lettres d’Hasina, la sœur restée au pays, cependant Monica Ali se défend d’être porteuse d’un quelconque message, qu’il soit politique ou social : elle assure ne croire qu’au « pouvoir du récit », car les histoires « peuvent vous transformer, mais quant à savoir si c’est toujours en bien, rien n’est moins sûr. Les contes religieux ont souvent un rôle dans le maintien des classes défavorisées au plus bas de la hiérarchie sociale ».
Ou bien l’étranger fascine
La Belle Ténébreuse de Biélorussie, par Jérôme Charyn, Gallimard
Originaire de Moguilev, en Russie blanche, réfugiée aux États-Unis, Faigele (en yiddish : oiseau), mariée et mère de famille, doit survivre. Mais qu’elle soit croupière pour le compte d’un gros bonnet du Bronx, « chameau » pour son ami Chick, véritable Robin des bois du marché noir, ou, de retour à l’usine, trempeuse de cerises dans du chocolat, Faigele choisit ses amis et leur reste fidèle. Pour la première fois, Jérôme Charyn relate cette épopée d’enfance, cette traversée magique du Bronx des années quarante en compagnie de sa mère.
« Nous dansions sur notre ligne brisée […]. Et tout le monde s’écartait de notre chemin. »
Extraits :
« Nous allions par les rues, l’enfant prodige en culottes courtes et sa mère, d’une beauté si insolente que cessait tout commerce : nous pénétrions alors dans un univers au ralenti où femmes, hommes, enfants, chiens, chats et pompiers dans leur camion la regardaient passer, les yeux emplis d’un tel désir que je me faisais l’effet d’un usurpateur en train de l’enlever vers quelque distante colline. […] »
« Les temps étaient sombres et romantiques. Le Bronx était vulnérable, dépourvu d’une digue qui offrît une protection sérieuse contre l’océan Atlantique et, selon la rumeur, des commandos ennemis allaient débarquer d’un sous-marin insidieux dans de petites embarcations en caoutchouc, envahir les égouts, dévorer ma terre natale. Mais jamais je ne vis le moindre nazi au cours de nos promenades. D’ailleurs, quelle chance aurait bien pu laisser au moindre d’entre eux la scintillante silhouette de ma mère dans son manteau de renard argenté ? Elle était née en 1911, comme Ginger Rogers et Jean Harlow, mais elle n’avait rien de leur platine, elle, c’était la belle ténébreuse de Biélorussie. »
L’acception du mot “étranger” varie
Anthropologie, par Éric Chauvier, Allia
Propos de Maurice Jeanjean, sociologue :
« Comprend bien que l’habileté de cette fille consiste à nous renvoyer notre image en déformé, ce que nous serions ailleurs, ce que nous aurions pu être, mais surtout, c’est là le nœud de la réflexion, ce que nous ne serons jamais. Nous avons besoin de visualiser ces possibles, de voir les autres les incarner, parce que leur posture agit sur nous comme un avertissement, et cette déformation est en quelque sorte nécessaire au maintien de l’ordre social. Elle agit comme une instance régulatrice. Comme cette fille (du doigt, il montre X qui vient vers nous en effectuant sa mimique ; Maurice balaie son regard d’un revers de la main), plutôt jolie d’ailleurs, qu’elle le veuille ou non, elle participe au bon fonctionnement de la communauté, elle en est un rouage, un rouage essentiel même, parce qu’à sa vue, nous nous libérons d’une énergie. Ce qui n’est pas loin de la part maudite évoquée par Bataille, nos actes ne sont possibles que parce que nous trouvons les moyens de libérer une énergie, une imagination, qui rendra acceptable notre existence. »
Etre étranger force à tout relativiser
Les Mots étrangers, par Vassilis Alexakis, Stock.
Extrait :
« L’Africain qui aurait la curiosité de découvrir le grec ne serait pas moins embarrassé que je ne le suis. ‘Pourquoi dîtes-vous cela de cette façon ?’, s’étonnerait-il sans cesse. Le sango me renvoie les questions que je lui pose. Apprendre une langue étrangère oblige à s’interroger sur la sienne propre. Je songe aussi bien au grec qu’au français : je les vois différemment depuis que j’ai entrepris de m’éloigner d’eux, la distance les rapproche, par moments j’ai l’illusion qu’ils ne forment plus qu’une seule langue. Serais-je en train de me servir du sango pour faire la paix avec moi-même ? Malgré mes innombrables voyages entre ma langue maternelle et ma langue d’adoption, je ressens toujours une légère agitation quand je vais de l’une à l’autre. Ce sont certes des langues qui se connaissent, qui se sont fréquentées, qui ont des souvenirs communs. Je distingue mieux leur ressemblance à présent. Vu de Bangi, l’écart entre Athènes et Paris doit paraître totalement insignifiant. »
L’étranger est celui dont on ne comprend pas la langue
Le Jeu de patience, par Louis Guilloux, Gallimard
Publié en 1949, ce roman est la chronique d’une petite ville de Bretagne à travers le Front populaire et la guerre, sous forme d’un montage complexe mais dont le narrateur est toujours le même ; c’est un des personnages, qui écrit à la première personne, et participe aux événements qu’il rapporte, notamment l’accueil des exilés, antifascistes allemands puis réfugiés espagnols. Le narrateur de ce roman rassemble ses notes, accumulées depuis des années, pour construire sa chronique, qui se caractérise par la fréquence de la langue espagnole, faute pour les réfugiés, de connaître la langue française.
À propos de ce livre, Geneviève Mouillaud-Fraisse écrit : « Dans Le Jeu de patience, les citations s’intègrent à ce que j’appellerais une éthique internationaliste de la traduction. Sur fond de français, l’espagnol côtoie l’allemand, celui des antifascistes exilés, puis celui des occupants ; le chroniqueur est un vieil humaniste de gauche à la fois fortement enraciné, né dans sa ville, et ouvert à l’étranger ; souvent les moments les plus intenses du roman mettent en jeu la langue » ; « La valeur essentielle, dans ce roman, est la communication entre sujets, qui savent qu’ils appartiennent à la même espèce humaine et se respectent comme sujets. Entravée par l’Histoire, mais partiellement réalisée dans l’histoire, où la petite ville bretonne devient un croisement de langues et de cultures portées par des individus singuliers. On retrouve là encore, mais avec un autre sens, l’amicale opacité de la langue étrangère, l’étrangeté apprivoisée. » (Les Fous cartographes, Littérature et appartenance, L’Harmattan, 1995).
L’étranger, un perpétuel apprenti
Une langue venue d’ailleurs, par Akira Mizubayashi, Gallimard
Extrait :
« À ce point de mon récit, vous vous demandez peut-être si je dis vrai, si je suis vraiment sincère. Car j’ai l’air d’insinuer que j’avançais allègrement dans la voie de l’apprentissage du français et que je franchissais sans peine les obstacles qui se présentaient devant moi… Non, franchement, si je vous donne cette impression, c’est bien malgré moi ; ce n’est pas du tout ce que je veux dire. Car tout ne s’apprend pas, tout ne se maîtrise pas dans une langue, même dans notre langue maternelle. Une langue étrangère, à plus forte raison, vous restera extérieure dans une mesure certes variable, mais fatalement irréductible. Évidence irréfragable ; nous n’occupons que de petits recoins dans ces immenses demeures que sont nos langues. Ce que je dis ou j’écris n’est qu’une certaine façon, maladroite ou inappropriée quelquefois, d’activer la langue. Bref, il y a des choses qui résistent à l’apprentissage. »
L’étranger est quelqu’un qui reconstitue inlassablement un paradis perdu
Mon Père qui fonctionnait par périodes culinaires et autres, par Elisabeth Mazev, Les Solitaires intempestifs
Vingt-et-une vignettes composent la pièce. Où l’on voit défiler les différentes toquades alimentaires d’un immigré bulgare à son arrivée en France. La dernière trouvaille rencontre toujours l’assentiment de sa famille, avant de tomber en défaveur. Et comment retrouver le paradis perdu des habitudes alimentaires de l’enfance ?
Extrait :
« Il m’avait fait croire que ce trou de quatre mètres sur cinq serait une piscine. Mais à présent je suis convaincue que la chose avait été conçue dès le début pour être une cave, sous la tonnelle.
On y entrait par une trappe au sol, protégée par un petit minaret, qui faisait penser à nos voisins : ils doivent être turcs.
Une journée entière à transporter les quelque trois mille bouteilles de l’ancienne cave surchargée, à la nouvelle, vaste et fraîche en ce mois de mai. Puis une autre journée un mois plus tard à les ramener à leur place d’origine, quand le soleil de juin avait transformé le sous-sol en hammam putride.
Je me remis à croire en l’hypothétique piscine. Non, ce serait une champignonnière.
Le lendemain, il faisait livrer cent kilos de fumier de cheval, dont fut tapissé le fond du trou.
Et la moisissure.
Et pendant un mois nous avons mangé du champignon tous les jours. Sauté, en omelette, au gratin et farci de son pied.
J’étais résignée, et j’aimais descendre par le minaret. Mais jamais seule.
Je ressortais, un saladier plein de boules blanches et molles à la main, et l’air frais me faisait discerner a posteriori l’odeur de moisi et l’humidité étouffante.
Un jour, plus aucun champignon n’a voulu pousser, une couche blanche et uniforme a envahi le tas de fumier et de longs filaments ont grimpé aux murs.
Le minaret est resté ouvert un mois entier pour assécher l’intérieur, le fumier sec est allé au jardin et nous avons entreposé de vieilles bicyclettes dans ma piscine. »
L’étranger déconcerte
Harare Nord, par Brian Chikwava, Zoé
Extrait :
« Les mains dans mes poches, je m’assieds sur un banc. Ce vieil homme de la cité de Tulse Hill, celui qui n’aime pas être reconnu par les gars du pays, il est là avec une casquette et une salopette trop grande, chemise bleue à manches longues et vieilles bottes. Il s’est entièrement réinventé lui-même ; tu penserais jamais qu’il est zimbabwéen si tu ne les connais pas. Là il est occupé à tirer sur une cigarette, à cracher de grands nuages de fumée alors que tout le monde est assis autour de lui, suspendu à chaque mot qu’il dit.
Dans des lieux étrangers, tu vois parfois chaque chaque avec des yeux différents pour la première fois, et qui tu es, et ta place dans le monde deviennent soudain aussi faciles à voir que n’importe quelle queue de chèvre. Parfois les gens aiment pas ça s’ils pensent que tu peux voir jusqu’où ils sont tombés. S’il veut pas qu’on le reconnaisse, ça me va. La semaine passée je l’ai croisé au marché de Brixton et il a pris cet air, tu sais, ce genre d’odeur que les gens dégagent quand ils veulent pas trop te parler. »
Un étranger doit toujours être sur ses gardes
Le Candidat, par Frédéric Valabrègue, POL
Le Candidat relate le voyage d’un jeune Burkinabé, Abdou. Il désire traverser le désert et se rendre dans cette Europe qui ne veut pas des migrants. Rien du reportage, de la chronique, ou d’une dénonciation, mais le récit des ruses que met en œuvre le jeune homme pour parvenir à son but. La plus grande des aventures, ici, est celle du langage. Frédéric Valabrègue a vécu son adolescence au Niger. Ses souvenirs, la finesse de son oreille, ses capacités d’empathie lui permettent de créer une langue juste et inventive. Comme si cela ne suffisait pas, il fait de son personnage et narrateur, Abdou, qui est fils de griot, un musicien (violon et guitare), et un poète (même si lui-même l’ignore). Abdou marche au rythme de sa parole, parle au rythme de sa marche. Sa voix ne représente pas le monde, mais en constitue un. Illégal, clandestin, sans papiers, Abdou s’affranchit par le langage : « je mets du djerma, gourmantché, poular, tamachèque dans mon français. Je prends un peu de chaque. Je griotte en bambara ».
Extrait :
« Ils ralentissent. Je descends avec eux. Comme ça ils savent je fauche pas dans la voiture. Ils vont vers un tablier et regardent des tas de notre amande à nous. C’est une amande ronde un peu cabossée avec une peau brune. Je dis que non, je ne connais pas le nom. Je vais pas au-devant de la conversation. Ça me coûterait rien. C’est bien volontiers que je renseigne. Le mieux qu’on a à montrer de soi-même, c’est la réserve. Comme quand ils ont dit devant la grue couronnée que chez eux, ya pas de bêtes sauvages. J’ai pas relancé. J’ai émis une approbation. Un mugissement bref. Humeur sachem. Ça les fait rire qu’un jeune soit si grave. Moi, à l’arrière, accoudé à la glacière, je suis le roi du pétrole. »
L’étranger est sommé de s’intégrer
Sourires de loup, par Zadie Smith, Gallimard
Zadie Smith passe au crible, à travers les pérégrinations d’immigrants et de leur descendance (trois générations), la question complexe de l’intégration et de la désintégration. Ces sagas familiales se déroulent à Londres, qui fut, dès l’après-Seconde Guerre mondiale, la plus multiethnique des villes européennes, peuplée, entre autres, d’Irlandais, de Bangladais, de Jamaïcains. Zadie Smith est elle-même d’origine afro-caribéenne. Toutes les oppositions – sociales, idéologiques, humaines – s’affrontent. Le brassage culturel entraîne le brassage de grands thèmes (le colonialisme, le fondamentalisme, les manipulations génétiques, le racisme, la condition féminine). La phénoménale vitalité de cette épopée passe par des dialogues où s’entendent tous les accents de la terre, accents auxquels la traduction en langue française, une prouesse, n’a pas fait perdre leurs couleurs d’origine (Sourires de loup, dans l’une et l’autre langue, se lit à voix haute).
Extrait :
« Comme le dit Samad, immigré bangladais, l’immigration n’est rien d’autre qu’une cruelle expérience : ‘Oui, vraiment. Plus je vais et plus j’ai l’impression qu’on fait un pacte avec le diable quand on débarque dans ce pays. On tend son passeport au contrôle, on obtient un tampon ; on essaie de gagner un peu d’argent, de démarrer… mais on n’a qu’une idée en tête, retourner au pays. Qui voudrait rester ? Il fait froid et humide ; la nourriture est immonde, les journaux épouvantables – qui voudrait rester ; je te le demande ? Dans un pays où on passe son temps à vous faire sentir que vous êtes de trop, que votre présence n’est que tolérée. Simplement tolérée. Que vous n’êtes qu’un animal qu’on a fini par domestiquer. Il faudrait être fou pour rester ! Seulement voilà, il y a ce pacte avec le diable… qui vous entraîne toujours plus loin, toujours plus bas, et qui fait qu’un beau jour on n’est plus apte à rentrer ; que vos enfants sont méconnaissables, qu’on n’appartient plus à nulle part.’ »
L’étranger s’éprouve comme illégitime
Faute d’identité, par Michka Assayas, Grasset
Michka Assayas dit de lui-même qu’il est un « Français problématique aux deux parents nés à l’étranger ». Dans ce livre, il raconte comment, en novembre 2009, il a perdu son passeport. Il a déposé une demande pour en obtenir un nouveau. On le lui a refusé. Dans la France d’aujourd’hui, être un Français né en France de parents français n’est pas une preuve de nationalité. Ses parents ont été naturalisés bien avant sa naissance. Plus de soixante après, l’administration française prétend ne pas les connaître.
Extrait :
« Il est étrange que certains atavismes reviennent affleurer à la surface. Il y a de ça quelques années, ma mère a souhaité que je l’emmène assister au célèbre Prix de Diane, une course de chevaux à laquelle est associée la maison Hermès. Pour l’occasion, elle s’était fait prêter un très joli chapeau fleuri par la maison Motsch, dont le représentant était là. Armé d’un appareil-photo, il fixait les coiffures des dames présentes. Il salua ma mère, qui lui demanda à quoi il était occupé, car il avait l’air bien affairé. : « Je prends les chapeaux », répondit-il. Aussitôt, ma mère se saisit de son chapeau et le lui tendit : elle avait compris non pas que cet homme photographiait les chapeaux des dames, mais qu’il les « reprenait » au sens propre. Elle pensa qu’il fallait restituer sur-le-champ ce qu’on lui avait prêté et qu’elle n’aurait pas voulu garder une minute de plus. Je suis convaincu que pas une des grandes dames présentes ce jour-là n’aurait fait l’interprétation aussi fausse que désarmante de ma mère : sûres d’elle, de leur place, de leur rang, de leur statut social, ces dames, mêmes parées d’un chapeau ou d’une parure gracieusement prêtés par un sponsor, n’auraient jamais été effleurées par l’idée de se décoiffer en public pour rendre ce qu’elles savaient ne pas leur appartenir. Je reste bouleversé que ma mère ait eu ce réflexe d’illégitimité, ce geste d’émigré qui jamais ne discute ce qu’on lui demande. »
De retour au pays, il se sent à nouveau illégitime
Tels des astres éteints, par Léonora Miano, Plon
Léonora Miano part des errements intellectuels de ses trois personnages pour analyser différentes façons de vivre sa négritude. Amok s’est exilé en Europe pour fuir sa famille corrompue, Shrapnel, son ami d’enfance, pour comprendre ce qui a pu fonder la domination de l’Occident sur l’Afrique, Amandla, qui a grandi dans un territoire d’outre-mer, la plus radicale des trois, pour militer et prôner le retour au pays natal. « La couleur s’insinuait dans tout ce qu’on faisait. Elle codifiait tout. Régentait tout. » Ce roman interpelle la conscience noire, incapable de prendre conscience d’elle-même et de s’assumer. L’Afrique est centrale, « Le pays, c’était cet indestructible en soi », même si la réflexion sur la quête identitaire se fait depuis l’Europe. Sa structure est directement inspirée par des thèmes de jazz du répertoire américain dont les personnages livrent leur interprétation.
Extrait :
« Depuis son retour, Amok avait ses images à l’esprit. Le pays avait changé. Il avait suivi son chemin. Sans lui. Il s’était donné des raisons de ne pas y retourner. Il avait cru savoir pourquoi il ne pourrait y vivre. La vérité ne lui était apparue qu’en y allant. Cela n’avait pas été un véritable dépaysement. Même après tout ce temps. D’anciens automatismes lui étaient revenus. Ses gestes et sa parole s’étaient vite réadaptés. Au début, en dépit des circonstances, il avait été heureux de retrouver la terre. Les odeurs. Le mouvement. Les bruits. Une vie particulière. Bien des choses n’avaient pas bougé. Il avait revu des bâtiments connus jadis. Serré avec joie la main de vieux camarades croisés au hasard des rues. Pourtant, il n’était plus de là. Ce qui tenait encore debout avait pris des rides en son absence. Des coups aussi. Une histoire s’était déroulée à laquelle il n’avait pas pris part. Il l’avait lue de loin. Parfois. Il ne l’avait pas vécue. Elle ne s’était pas imprimée en lui. Ce n’était pas à elle qu’il devait les marques apparaissant sur son visage. Sa longue absence le rendait illégitime. »
L’étranger est celui qu’on dupe
Cent seize Chinois et quelques, par Thomas Heams-Ogus, Le Seuil
Entre 1941 et 1943, après avoir été un lieu de confinement centralisé pour des Juifs allemands, des militants politiques, des Tsiganes, le camp d’Isola, dans les Abruzzes, le devint pour des Chinois. La présence de leur communauté disciplinée et mutique bouleversa la vie des paysans du voisinage. L’Église délégua auprès d’elle le franciscain Antonio Tchang du collège missionnaire d’Assise, au prétexte qu’il était lui aussi chinois. Son prosélytisme incita certains à vouloir se faire baptiser collectivement, ce que le Vatican – qui à la fois veillait sur les camps italiens et entretenait un silence criminel – accepta. Le titre de ce récit sobre, mais symboliquement très puissant, dit assez que, s’agissant des bannis, leur nombre est toujours approximatif.
Extrait :
“[Tchang] n’était pas naïf au point d’ignorer que cela leur permettrait aussi d’espérer une forme dégradée et bâtarde de protection. Ce volet discret du pacte qu’ils voulaient nouer était d’ailleurs le signe des dangers qu’ils sentaient fondre sur eux. Mais plus discrètement encore, Tchang sentait flotter autour de cette envie des besoins plus forts, comme de déjouer l’exil, de résister à cet endroit qui voulait les dissoudre, et dont ils avaient manifestement compris certains codes et la manière de le subvertir. Il sentait bien d’ailleurs que ce n’était pas tant l’hypocrisie que la stratégie du désespoir, voire un réflexe de survie, mais il se disait qu’au moins, derrière la potentielle fiction, les demandeurs feraient au fonds d’eux-mêmes une rencontre. Au-delà, quels en étaient les tréfonds ? Tchang, en homme habitué des mystères, avait laissé cette question sur le bord du chemin. Il était celui qui marchait sur une route, laissant ses compatriotes à leur errance, étonnés eux-mêmes de leur demande soudaine.”
Mimer l’étranger est indécent
Esthétique du Pôle Nord, par Michel Onfray, Grasset
Il y a une quarantaine d’années, Michel Onfray, dix ans, demande à son père quelle destination il choisirait s’il pouvait s’offrir un long voyage. La réponse fuse : le pôle Nord. Son père est ouvrier agricole, sa mère, femme de ménage, il y a peu de chances qu’ils puissent s’offrir une telle destination. Plus ou moins en l’an 2000, pour les quatre-vingts ans de son père, Michel Onfray tient la promesse qu’il s’était faîte lorsqu’il avait 10 ans, et met le cap sur la Terre de Baffin, au-delà du cercle polaire, en sa compagnie. Le récit de ce voyage est poétique, lyrique, philosophique, puisqu’il est entendu qu’il existe non pas des objets spécifiquement philosophiques, mais une manière philosophique de parler des choses, y compris de l’étranger.
Extrait :
« La survie ne saurait se théâtraliser à la manière d’un spectacle. En aucune manière il paraît décent de se prendre pour ceux qu’on visite, d’autant plus quand on s’en fait une idée fausse. Les anciennes conditions esquimaudes d’existence ont ressemblé aux plus rudes jamais connues par les hommes. Les déserts chauds ou froids portent les hommes à des degrés existentiels impossibles à connaître si l’on se trouve dans une situation passagère. L’ethnologie contemporaine aura au moins appris aux plus lucides qu’on n’entre jamais sérieusement dans aucune civilisation si l’on n’est pas soi-même issu d’elle. Et encore…
On peut approcher, regarder, expérimenter sa sagacité, sa curiosité, son intelligence, sa culture, ses références, certes ; mais on gagnera à laisser parler l’intuition, l’improvisation, la collision, l’émotion, sans chercher à réaliser une immersion factice qui n’apprendra rien de réel – ni sur soi, ni sur les autres. La survie ne se mime pas : on ne saurait la mettre en scène à la manière d’une curiosité maîtrisée de bout en bout. Pire, il y a de l’indécence à se prendre pour ce que l’on n’est pas, n’a jamais été, ne sera jamais – à savoir un être en situation de perdre sa vie à cause de la rudesse d’un climat, de l’austérité d’une terre et de son absence de générosité agricole. Le mimétisme de l’étranger ressemble à s’y méprendre à la haine de l’étranger. »
Tous nous pouvons éprouver le sentiment d’être étranger
Le Château, par Franz Kafka, Gallimard
Le sentiment de l’exil (de l’étrangeté) est lié à la condition humaine. En dehors même de tout déplacement. Nous sommes hors la vie. Dans Le Château, le héros, désigné par la seule initiale « K », est appelé par son travail d’arpenteur à quitter sa famille. Mais cette patrie de référence reste floue : la terre toute entière, en fait, est le lieu de son exil symbolique.
Extrait :
« Si K voulait se faire ouvrier, libre à lui, mais ce serait avec le plus terrible sérieux, sans nul espoir d’autre perspective. K. savait bien qu’on ne le menaçait pas d’une contrainte effective et concrète, ce n’était pas ce qu’il craignait, surtout dans ce cas, mais la puissance d’un entourage décourageant, l’habitude des déceptions, la violence des influences impondérables qui s’exerçaient à tout instant, voilà ce qui lui faisait peur ; et c’était avec ce péril qu’il devait tenter le combat. La lettre ne dissimulait pas non plus que si la lutte s’engageait c’était K qui aurait eu l’audace de commencer ; c’était dit subtilement : une conscience inquiète – inquiète, je ne dis pas mauvaise – pouvait seule s’en apercevoir ; c’était dit dans les quatre mots « comme vous le savez » qu’on lui adressait à propos de son engagement. K. s’était présenté et, de ce moment-là, il savait, comme le disait la lettre, que son admission était prononcée. »
Cet article fait partie du dossier Etranges étrangers….






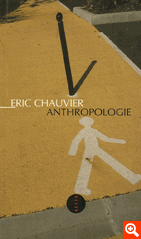
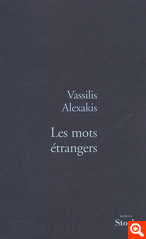

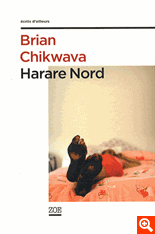
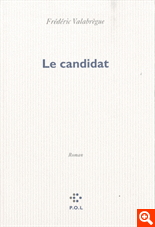
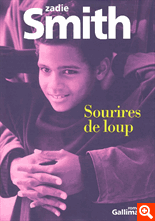

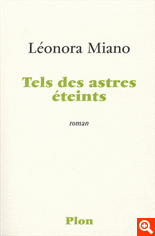
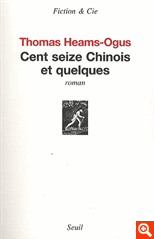
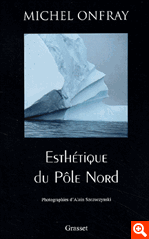







Partager cet article