Coup de projecteur sur les éditions du Sonneur
Publié le 08/11/2013 à 00:00
-  22 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
22 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
Tout d'abord un petit clin d'œil à propos du logo de ces éditions, à savoir une grenouille, lointaine cousine de notre batracien du Guichet du Savoir ? Hasard objectif ?
Le gouffre, de Franck NORRIS

- 220 220 Gouffre-Norris-1re220px 96 97[1]
![]() « Lorsqu’on souhaite comprendre les ressorts de la spéculation financière sans tomber dans la technique économique, L’argent, le célèbre roman d’Emile Zola, s’impose comme une référence incontournable. On y voit le rôle de la psychologie des acteurs, celui des fraudes, de la mauvaise gouvernance des banques, le rôle des cycles de crises financières, etc.
« Lorsqu’on souhaite comprendre les ressorts de la spéculation financière sans tomber dans la technique économique, L’argent, le célèbre roman d’Emile Zola, s’impose comme une référence incontournable. On y voit le rôle de la psychologie des acteurs, celui des fraudes, de la mauvaise gouvernance des banques, le rôle des cycles de crises financières, etc.
Il faudra désormais y ajouter le magnifique livre de l’écrivain américain Frank Norris, publié en 1903 et qui vient – enfin ! – d’être traduit en français. Il y raconte les amours de Laura Dearborn et Curtis Jadwin, un spéculateur enrichi mais assagi, qui a décidé de vivre le restant de sa vie de manière paisible. Malheureusement, l’attrait du jeu le pousse à spéculer une dernière fois.
Il tente un coup très en vogue à la fin du XIXe siècle, un corner. Le principe en est simple : anticipant une forte demande de blé, Jadwin en achète à l’avance le plus possible pour pouvoir maîtriser le marché et fixer son prix lorsque la demande se matérialisera effectivement. Problème : plus la spéculation avance, plus la demande importante du spéculateur tire les prix vers le haut, et plus le jeu devient coûteux. Il ne faut donc pas se tromper, car les risques sont énormes. Frank Norris décrit avec une grande justesse les mécanismes et l’excitation de la spéculation, comme lorsque Jadwin explique que ” c’est un jeu de riches. Il ne procure aucun plaisir si tu ne peux pas risquer plus que tu ne peux te permettre de perdre ” !
Aux qualités littéraires du roman de Frank Norris et à la finesse de sa description d’une spéculation sur le marché de Chicago, s’ajoute également une forme de prémonition. Car l’élément déclencheur de la panique financière qui va toucher les Etats-Unis quatre ans plus tard, lors de la célèbre crise de 1907, sera un autre corner, loupé cette fois, sur les actions d’une entreprise de production de cuivre !
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on peut prolonger le plaisir avec la republication d’un autre roman de Norris, Les rapaces, qui décrit minutieusement la façon dont plusieurs personnages voient leur vie broyée par leur quête éperdue d’argent. On est envoûté par ce livre, qui comporte plusieurs scènes fascinantes et un final magnifique. Bref, il faut absolument lire Frank Norris ! »
Christian Chavagneux, in :
Alternatives Economiques, n° 314 – juin 2012, Université Européenne de l’Engagement, Poitiers
Les éperons, de Tod ROBBINS
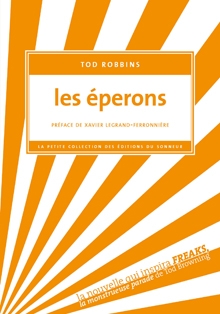
- 220 eperons 87-1[1]
![]() « Jacques Courbé aime Jeanne-Marie, qui est amoureuse de Simon Lafleur. Jacques Courbé hérite, et Jeanne-Marie accepte de l’épouser, pensant qu’il ne fera pas de vieux os et qu’elle sera bientôt riche, qu’elle pourra vivre avec l’homme qu’elle aime vraiment. Situation classique, mille fois lue ou vue. Mais…
« Jacques Courbé aime Jeanne-Marie, qui est amoureuse de Simon Lafleur. Jacques Courbé hérite, et Jeanne-Marie accepte de l’épouser, pensant qu’il ne fera pas de vieux os et qu’elle sera bientôt riche, qu’elle pourra vivre avec l’homme qu’elle aime vraiment. Situation classique, mille fois lue ou vue. Mais…
Mais ajoutons quelques précisions. Dès le premier paragraphe de ce court texte, on apprend à propos de Jacques Courbé que « soixante et onze centimètres seulement séparaient la plante de ses pieds minuscules du sommet de son crâne ». Jeanne-Marie est une « grande femme blonde à la stature d’amazone, elle avait des yeux ronds d’un bleu tendre ». Simon Lafleur, quant à lui, est un « jeune colosse basané au regard noir et insolent ». Ajoutons encore que l’histoire naît sous le chapiteau du cirque Copo, et l’on aura compris que nous sommes dans l’univers de Freaks. Le texte de Tod Robbins a d’ailleurs inspiré le film de Tod Browning.
Le nain est un chevalier à la petite figure, armé d’une petite épée, juché sur un chien hargneux. Jeanne-Marie et Simon Lafleur sont des écuyers, des acrobates en habit de lumière. L’écuyère épouse le nain, qu’elle appelle son « singe de poche » et qu’elle juche sur son épaule. Sur quarante-cinq pages, et en trois mouvements clairement différenciés – la demande en mariage, le repas de noces, les retrouvailles de Jeanne-Marie et Simon un an après la cérémonie – Tod Robbins cisèle un petit bijou de perversion et d’irrespect, brosse une galerie de portraits monstrueux, plonge au cœur d’un monde brutal, où les plus cruels ne sont pas ceux que l’on croit. Très malicieusement, Tod Robbins donne à ses personnages des noms français, et les patronymes masculins – Courbé et Lafleur – sont à mettre en parallèle avec la jument Sappho que chevauche l’écuyère Jeanne-Marie.
Les éditions du Sonneur proposent ici une publication soignée, dans un petit format élégant, avec une préface qui retrace le parcours de l’auteur. Cette « Petite Collection a été créée pour que puissent exister des textes trop courts pour être publiés dans un grand format, mais trop grands pour ne pas être édités », nous explique l’éditeur à la fin de l’ouvrage. Les textes courts ont peu les faveurs du public français, et c’est dommage. On se souvient peut-être de la très belle collection « Nouvelles » de Jean-Paul Bertrand aux éditions du Rocher. Les petits formats, que l’on glisse dans sa poche, dans son sac, dans son cartable, renferment des textes souvent savoureux, parfois à redécouvrir. La longue nouvelle Les Éperons de Tod Robbins, en tout cas, est de ceux-là. »
Christine Bini, in : La Cause Littéraire
Apaiser la poussière, de Tabish KHAIR
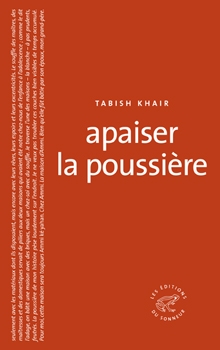
- 220 Apaiser 69[1]
![]() « Imaginant le flux des pensées des passagers d’un autocar, Tabish Khair construit un récit allégorique et émouvant sur l’Inde moderne. Un vieil autocar, comme il n’en existe probablement qu’en Inde, ses guirlandes au-dessus des portes, ses gravures de divinités hindoues, garé aux côtés de luxueux bus touristiques. Nous sommes dans le Bihar, état indien où est né en 1966 Tabish Khair, romancier et poète, vivant actuellement au Danemark. À travers les vitres de cet autocar, il nous fait découvrir l’Inde qui au premier regard semble n’être que pauvreté et poussière, « poussière soulevée par les voitures, les rickshaws, les thellas, les vélos et les piétons ». Mais derrière cette agitation, il nous révèle un monde fabuleux fait de diversités, d’un foisonnement de cultures où les traditions les plus anciennes coexistent avec les signes d’une modernité exacerbée. Au point qu’il est difficile de s’attacher à des repères. Difficile de connaître l’heure dans un pays qui vous offre en permanence des « centaines d’horloges différentes ».
« Imaginant le flux des pensées des passagers d’un autocar, Tabish Khair construit un récit allégorique et émouvant sur l’Inde moderne. Un vieil autocar, comme il n’en existe probablement qu’en Inde, ses guirlandes au-dessus des portes, ses gravures de divinités hindoues, garé aux côtés de luxueux bus touristiques. Nous sommes dans le Bihar, état indien où est né en 1966 Tabish Khair, romancier et poète, vivant actuellement au Danemark. À travers les vitres de cet autocar, il nous fait découvrir l’Inde qui au premier regard semble n’être que pauvreté et poussière, « poussière soulevée par les voitures, les rickshaws, les thellas, les vélos et les piétons ». Mais derrière cette agitation, il nous révèle un monde fabuleux fait de diversités, d’un foisonnement de cultures où les traditions les plus anciennes coexistent avec les signes d’une modernité exacerbée. Au point qu’il est difficile de s’attacher à des repères. Difficile de connaître l’heure dans un pays qui vous offre en permanence des « centaines d’horloges différentes ».
Les chapitres, tous très courts, se suivent en séquences rapides. Le paysage défile. Les pensées des passagers s’enchaînent en un flux ininterrompu de souvenirs, de perceptions. Le style est sobre, d’une grande sensualité. Aux images s’ajoutent les sons, les odeurs : clapotis du Gange couverts par des cacophonies de musiques, effluves de jasmin mêlés à des relents de pourriture. […]
L’autocar relie les deux villes de Gaya et Phansa. Mais la structure du roman donne une autre dimension au voyage, à tout voyage. Certes, les distances demeureront toujours entre les êtres mais il arrive qu’ils compatissent aux malheurs de ceux qui leur semblent les plus dissemblables. Que plus personne ne « pointe du doigt… les sans-abris, les marginaux, les paysans sans terre, les gitans… ». Il y a des voyages riches d’enseignements et « des distances que l’on passe une vie à mesurer ». Un simple trajet sur une route indienne poussiéreuse peut contribuer à les réduire. »
Yves le GALL, in : Matricule des Anges
Au plus loin du tropique, de Jean-Marie MALLET
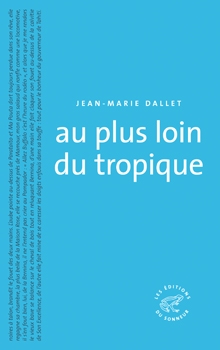
- 220 Tropique 1 5[1]
![]() Il est aussi boucané qu’un caoutchouc de bombard et vire de bord sur des mers au goût d’encre bleue. Cet homme est un marin aux antipodes du plumitif germanopratin. A lire Dallet, qui utilise souvent le mot « douillet », on respire à pleins cabestans. Tel Flynn sur son Sea Hawk, il siffle dans les drisses et file comme une goélette. Il aime les vents de travers. Ce flibustier des lagons a un côté Borgne-Fesse. Quand il met son grain de sel, c’est le grain assuré.
Il est aussi boucané qu’un caoutchouc de bombard et vire de bord sur des mers au goût d’encre bleue. Cet homme est un marin aux antipodes du plumitif germanopratin. A lire Dallet, qui utilise souvent le mot « douillet », on respire à pleins cabestans. Tel Flynn sur son Sea Hawk, il siffle dans les drisses et file comme une goélette. Il aime les vents de travers. Ce flibustier des lagons a un côté Borgne-Fesse. Quand il met son grain de sel, c’est le grain assuré.
Ce qu’il y a de bien avec les écrivains-navigateurs, c’est qu’ils ont toujours un pot-au-noir à portée de foc. Dallet, lui, a rallié récemment Tahiti à bord de son voilier Lady Day. On dit qu’il a toujours navigué entre la Méditerranée, le Pacifique Sud et Paris. Le marin est un dragueur. Il sait qu’il plaît aux gisquettes et que ses récits font l’effet du cap Horn sur des coeurs habitués à canoter au bois de Boulogne ou sur le lac d’Enghien-les-Bains. Même s’il a des vertiges de bateau-lavoir, il devient Akkab ou captain Blood en un tour de ris. Aussi déboule-t-il sous une simple misaine, rond comme un Queffélec, roublard comme un Orsenna, baratineur comme un Deniau, fier comme un hauban. Au plus loin du tropique est un tableau de Gauguin à l’ombre de Tahiti Jim et de Dieudonné Soleil. Entre Cancer et Capricorne, le « millerien » Dallet se prend pour le baron des Marquises. Il narre sa Pouta dans l’éclair de la Maison Rose, aux ordres de Papeete et des margouillats des charpentes. Trinité et Kerlan sont également de la partie, naufrageurs d’amitié et janissaires de requins-tigres. Quoi qu’on en dise, il y a parfois un côté Coconuts chez Dallet, genre marxiste version Harpo. Nous sommes à Parataito, paradis en maori, dans le domaine de Pouta, entre gardénias et hibiscus, dans un boxon nettement plus avenant que ceux de Panama et de Colombie. Le gouverneur Pompador, qui n’est pas marquis, et le Chinois A You, qui donne envie de chanter Only You, évoquent le bénitier des dames. On se signe et on songe aux Marquises de Brel. Tout s’immobilise ?… Eh bien, non, car c’est écrit par force dix avec des lubricités de matelot, des silences de la mer, des ivresses de vieux crabes et de jeunes morues. »
François CERESA, in : Le Figaro Littéraire
Anaïs ou les gravières, de Lionel-Edouard MARTIN
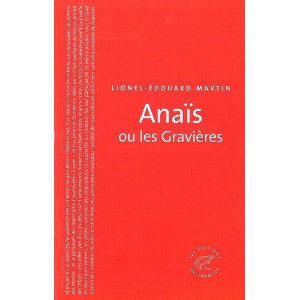
- Anais[1]
![]() « Habitué à remplir des pages dédiées aux faits-divers anodins et aux manifestations locales dans un quotidien du Poitou, un journaliste récemment frappé par un deuil brutal (« chacun – lui, elle – était enfoncé, bien calé dans son siège, après avoir du crâne percuté le pare-brise ») exhume, pour essayer de rompre la monotonie d’une vie de plus en plus désolante, le seul événement exceptionnel qui ait réussi à secouer la région ces dernières années. Il s’agit d’un assassinat presque oublié de tous : celui d’une lycéenne de 17 ans,
« Habitué à remplir des pages dédiées aux faits-divers anodins et aux manifestations locales dans un quotidien du Poitou, un journaliste récemment frappé par un deuil brutal (« chacun – lui, elle – était enfoncé, bien calé dans son siège, après avoir du crâne percuté le pare-brise ») exhume, pour essayer de rompre la monotonie d’une vie de plus en plus désolante, le seul événement exceptionnel qui ait réussi à secouer la région ces dernières années. Il s’agit d’un assassinat presque oublié de tous : celui d’une lycéenne de 17 ans,
« Anaïs par sa mère retrouvée dans l’entrée de leur appartement, tuée d’un coup d’arme blanche portée dans le cœur ».
C’est de ce meurtre, que la police n’est pas parvenue à élucider, ne dénichant pas plus l’assassin que l’arme du crime et son mobile, que s’empare le journaliste insomniaque et désenchanté. Cela suffira-t-il pour pimenter son existence et atténuer sa propre douleur ? L’optimisme n’étant pas son fort, il en doute mais tente néanmoins sa chance, notant, annotant, se glissant même, de temps à autre, dans la peau d’un écrivain capable de redonner vie à une histoire en se portant au plus près des morts. Il y a sa morte à lui. Et Anaïs, qui est la morte d’une autre. Qui, comme lui, ne s’en remet pas et qu’il va, peu à peu, approcher puis visiter de plus en plus souvent. Il écoute parler la mère de l’absente. Il ne joue pas au détective. Il souhaite simplement remettre l’histoire d’une vie brève (et, ce faisant, la sienne) en marche, allant, pour cela, à la rencontre de quelques personnages singuliers, ici un peintre bavard, là un conducteur de bull, ailleurs un ancien légionnaire, tous coincés dans un même territoire, entre ZUP, sablières et ruralité morose, tous aussi solitaires que lui, tous en froid avec un passé qui les entrave et dont il ne pourra glaner que quelques brindilles, donnant (bien obligé) en fin de compte carte blanche à son imagination pour résoudre ce qui restera sans doute à jamais, pour les autres, une énigme.
On arrive ici au point de jonction entre Lionel-Édouard Martin et son narrateur. L’écrivain tient bien les rênes. De temps à autre, il lâche la bride et prend des chemins de traverse. Il imbrique des séquences précises, que l’on pourrait croire, à tort, annexes, à l’intrigue initiale. Il apprécie les zigzags aux alentours de la ville et les retours au passé.
On retrouve avec une réelle délectation cette langue qui est celle d’un styliste ne cherchant pas (ce n’est pas si fréquent) à séduire. Sa langue est juste, imagée, incarnée parfois, rugueuse quand il le faut, sachant, successivement, se détendre ou se compacter en restant toujours énergique et efficace. »
Jacques JOSSE, in : remue.net
Le requiem de Terezin, de Josef BOR
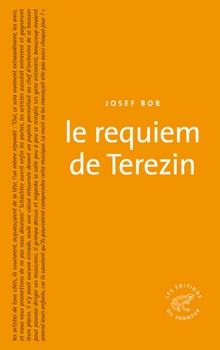
- 220 Terezin 1 3[1]
![]() Raphaël Schachter, pianiste et chef d’orchestre tchécoslovaque, arrive au camp de Terezin le 30 novembre 1941 et le quitte pour Auschwitz le 16 octobre 1944. Entre ces deux dates, il réussit en dix huit mois d’efforts désespérés, à répéter et à faire jouer le requiem de Verdi.
Raphaël Schachter, pianiste et chef d’orchestre tchécoslovaque, arrive au camp de Terezin le 30 novembre 1941 et le quitte pour Auschwitz le 16 octobre 1944. Entre ces deux dates, il réussit en dix huit mois d’efforts désespérés, à répéter et à faire jouer le requiem de Verdi.
L’auteur raconte cette histoire vraie en s’inspirant des versets du requiem et en associant sa réflexion sur l’histoire à une méditation sur la musique. Une œuvre unique, d’une remarquable vitalité.
« L’équilibre émotionnel que crée Josef Bor par son écriture est fragile, et l’on craint qu’un mot de trop de notre part ne vienne le briser. L’émotion va crescendo, et la cruauté que le texte distille est violemment douloureuse tant elle est raffinée : ce que le chef de camp avait promis, c’était de ne pas séparer les artistes. […] Cette tension d’angoisse et d’espérance, cette lutte pour la vie quand la mort est certaine, le livre des Éditions du Sonneur la restitue de manière physique. Les lettres imprimées sont d’une police petite et fine, et autour du texte, comme du satin autour d’un bijou dans un écrin, le blanc du papier renvoie au lecteur en plein visage le silence retombé. Le résumé, au dos du livre, est imprimé à la verticale. Il se poursuit sur la première de couverture toujours à la verticale. Nos repères sont abolis, comme l’idée même de sens, comme toute notion de Raison que les années du nazisme ne nous laissent pas découvrir en leur sein. »
Franck WASSERMAN, in : Trait d’union
La brebis galeuse, d’Ascanio CELESTINI

- ascanio-celestini-la-brebis-galeuse-livre-896902154 ML[1]
![]() Ascanio Celestini est un personnage très populaire en Italie. Propulsé par le petit écran, il fait toujours le plein dans les théâtres de la Péninsule. Sa spécialité : raconter des histoires. Il est maître dans la matière. Avec son léger accent romain et son look décalé, il conquit instantanément la sympathie du public. En revanche on ignore encore, et cela vaut pour les deux côtés des Alpes, que la lecture de ses textes est tout aussi gouteuse. Surtout lorsqu’on a déjà eu la chance de l’écouter. En lisant, on a l’impression de l’entendre « raconter ». La Brebis galeuse est exemplaire à cet égard. Dans cet ouvrage, Celestini raconte l’horreur de l’asile, par le biais d’un personnage, Nicola, qui y est resté enfermé pendant 35 ans.
Ascanio Celestini est un personnage très populaire en Italie. Propulsé par le petit écran, il fait toujours le plein dans les théâtres de la Péninsule. Sa spécialité : raconter des histoires. Il est maître dans la matière. Avec son léger accent romain et son look décalé, il conquit instantanément la sympathie du public. En revanche on ignore encore, et cela vaut pour les deux côtés des Alpes, que la lecture de ses textes est tout aussi gouteuse. Surtout lorsqu’on a déjà eu la chance de l’écouter. En lisant, on a l’impression de l’entendre « raconter ». La Brebis galeuse est exemplaire à cet égard. Dans cet ouvrage, Celestini raconte l’horreur de l’asile, par le biais d’un personnage, Nicola, qui y est resté enfermé pendant 35 ans.
Nicola raconte et se raconte de l’extérieur. D’ailleurs, son sort était en partie écrit à l’avance, sa mère ayant passé les dernières années de sa vie à l’asile. Né durant les fabuleuses années soixante, il passait les journées avec ses frères à garder les brebis. Puis, il y a eu un accident et il a été enfermé à l’asile.
Celestini réussit à décrire la vie monotone et aliénante des « enfermés » avec une légèreté stratégique qui n’ôte rien à l’horreur, bien au contraire. Son récit n’embellit guère la réalité. L’absence de pathos, remplacée par une ironie qui se nourrit des quiproquos de son personnage principal, désarme le lecteur, qui se laisse guider docilement dans l’abîme de l’« asile électrique ». Dans l’édition française le plaisir de la lecture reste intact grâce à l’excellente traduction d’Olivier Favier. Un livre à lire absolument.
Stefano Palombari, in : L’Italie à Paris
A propos d’un thug, de Tabish KHAIR
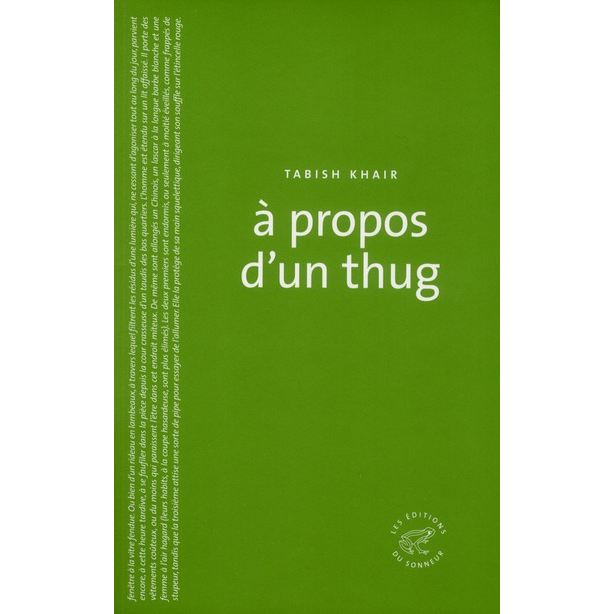
- a-propos-d-un-thug[4]
![]() « M. Ali, j’ai parfois l’impression que ce que nous sommes, ce que nous paraissons être, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes aux yeux des autres sont quatre choses bien distinctes. Telle est la nature de l’existence, l’une de ses nombreuses imperfections, pourriez-vous ajouter » : le capitaine William Meadows, revenu d’Inde en 1837 avec Amir Ali, semble avoir compris ce qui fait la diversité de l’existence et de ses énigmes, des récits que l’on en fait, aux autres et à soi ; ils sont au cœur du roman de Tabish Khair.
« M. Ali, j’ai parfois l’impression que ce que nous sommes, ce que nous paraissons être, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes aux yeux des autres sont quatre choses bien distinctes. Telle est la nature de l’existence, l’une de ses nombreuses imperfections, pourriez-vous ajouter » : le capitaine William Meadows, revenu d’Inde en 1837 avec Amir Ali, semble avoir compris ce qui fait la diversité de l’existence et de ses énigmes, des récits que l’on en fait, aux autres et à soi ; ils sont au cœur du roman de Tabish Khair.
Le protagoniste, donc, s’est installé dans le Londres victorien, sous la protection du capitaine Meadows, qui lui demande de raconter sa vie d’adepte du « thugisme », secte réunissant jadis des musulmans et des hindous pratiquant rituellement le vol et le meurtre. En parallèle, Amir confie à Jenny, la jeune servante qu’il aime, dans des lettres dont il sait qu’elle ne pourra les lire, les vraies vicissitudes de sa vie en Inde et ses doutes actuels, dans la grisaille anglaise.
Une autre intrigue met en scène le fameux phrénologue lord Batterstone, dont la volonté est de montrer à tout prix le bien-fondé de ses théories raciales, et son employé John May qui, à force de chercher pour son patron des crânes difformes dans les tombes, sombrera dans l’acharnement du meurtre, entraînant ses complices avec lui. Le récit tourne au roman noir, avec double enquête, officielle et journalistique d’une part, nourrissant le fantasme du « cannibale décapiteur », officieuse et populaire d’autre part, assurée par quelques représentants efficaces et solidaires de la populace des bas-quartiers.
Tabish Khair, dont l’art des récits alternés se manifestait déjà dans Apaiser la poussière, sait que la vie humaine n’est pas une, et que l’existence n’est pas vouée à la certitude ; surtout, il sait l’écrire, par le truchement d’histoires qui se situent aux confins du réel, aux limites de la possibilité, aux frontières du doute. Et il sait le confier à la plume fictive de ses personnages : « Qu’il est étrange de devenir ce qu’on n’est pas. Quelques histoires, quelques mots suffisent-ils ? Notre emprise sur la réalité est-elle si faible, si précaire ? Les histoires – racontées par nous ou par d’autres – peuvent-elles nous transformer ainsi ? Et pour quelle raison avons-nous besoin de nous en revêtir – quelle que soit notre manière d’avoir prise sur la réalité, et quelle que soit cette réalité ? Est-ce donc ce à quoi nous nous résumons ? Des histoires, des mots, un souffle ? ».
Jean-Pierre LONGRE, in : www.critiqueslibres.com
Moi, ma vie, son oeuvre, de François BLISTENE

- 220 Blistene-Moi-1re 95[1]
![]() Thomas aime le tennis et le sexe, cultive le cynisme et l’humour, et sa vie n’a rien de particulier. Jusqu’à sa rencontre avec un vieux peintre génial mais inconnu, à qui il « volera » l’œuvre pour devenir l’un des plus grands artistes du vingtième siècle !
Thomas aime le tennis et le sexe, cultive le cynisme et l’humour, et sa vie n’a rien de particulier. Jusqu’à sa rencontre avec un vieux peintre génial mais inconnu, à qui il « volera » l’œuvre pour devenir l’un des plus grands artistes du vingtième siècle !
Cette fausse autobiographie est tout simplement un régal ! Une plume superbe, un humour délicieux, un voyage dans le Paris artistique des années 40 qui nous rappellerait presque le film de Woody Allen (Minuit à Paris), tout cela pour nous offrir une sorte de mélange entre les univers de Jaenada et Philip Roth.
Bref, si vous aimez la peinture, les arts, le Paris des années 1940, le cul et l’humour intelligent, foncez sans hésiter ! Et cerise sur le gâteau, vous récompenserez un petit éditeur qui fait un boulot extraordinaire !
Joachim BOITRELLE, in : Librairie La Procure, Rheims
Le pont d’Alexander, de Willa CATHER

- 220 Cather-Alexander 98[1]
![]() Le Pont d’Alexander, écrit en 1911, est le premier roman de Willa Cather (l’Américaine est née en 1873 et morte en 1947). Alexander est dans ce titre le nom d’un homme et non celui d’un lieu. « Ce n’est pas l’histoire d’un pont et de comment il a été construit, mais celle d’un homme qui construit des ponts », dit Willa Cather dans un entretien au New York Sun à la sortie du livre, en 1912 (on trouve ce texte dans Willa Cather in Person, paru à University of Nebraska Press, le Nebraska étant l’État dans les prairies duquel les parents de l’écrivain s’installèrent quand elle avait dix ans et qui allaient nourrir son œuvre). Le héros, toujours selon les mots de l’auteur, commence sa vie avec une « force païenne », « avec peu de respect pour autre chose que la jeunesse, le travail et le pouvoir ». Mais sa femme est dans un monde social plus délicat et il l’admire. Tant que l’énergie d’Alexander se déploie dans son travail, « tout va bien », « mais il court le risque de rencontrer de nouvelles émotions aussi bien que de nouveaux stimulants intellectuels ». Le roman est l’histoire de ces rencontres, l’exploration de ces terres inconnues d’Alexander où il lui faut pourtant bien se débrouiller tel un aventurier d’un nouveau genre.
Le Pont d’Alexander, écrit en 1911, est le premier roman de Willa Cather (l’Américaine est née en 1873 et morte en 1947). Alexander est dans ce titre le nom d’un homme et non celui d’un lieu. « Ce n’est pas l’histoire d’un pont et de comment il a été construit, mais celle d’un homme qui construit des ponts », dit Willa Cather dans un entretien au New York Sun à la sortie du livre, en 1912 (on trouve ce texte dans Willa Cather in Person, paru à University of Nebraska Press, le Nebraska étant l’État dans les prairies duquel les parents de l’écrivain s’installèrent quand elle avait dix ans et qui allaient nourrir son œuvre). Le héros, toujours selon les mots de l’auteur, commence sa vie avec une « force païenne », « avec peu de respect pour autre chose que la jeunesse, le travail et le pouvoir ». Mais sa femme est dans un monde social plus délicat et il l’admire. Tant que l’énergie d’Alexander se déploie dans son travail, « tout va bien », « mais il court le risque de rencontrer de nouvelles émotions aussi bien que de nouveaux stimulants intellectuels ». Le roman est l’histoire de ces rencontres, l’exploration de ces terres inconnues d’Alexander où il lui faut pourtant bien se débrouiller tel un aventurier d’un nouveau genre.
[…] Le Pont d’Alexandre montre Willa Cather, romancière débutante, affronter un monde nouveau pour elle, devoir y faire face à des problèmes somme toute similaires à ceux que rencontre son héros – et y répondre, livre après livre, tout à fait différemment.
Mathieu LINDON, in : Libération
Ils marchent le regard fier, de Marc VILLEMAIN

- 220 Couv-Ils-marchent-le-regard-fier1re 103[1]
![]() Ces deux-là se sont donné du « Mon vieux » depuis la cour d’école de leur bourg de campagne. Entre eux s’est nouée, à la vie, à la mort, une de ces amitiés enfantines qui durent. « J’ai toujours connu Donatien », explique d’emblée le narrateur de Ils marchent le regard fier. Donatien n’était pas tout à fait un gamin comme les autres. Il avait la grâce étrange de ces meilleurs en tout. Habile aux exercices physiques et tout autant réfléchi et secret. Toujours le nez dans les livres, trimballant avec lui La Légende dorée, de Jacques de Voragine, où il relisait sans cesse l’histoire de saint Julien, qui tua père et mère et fut sauvé de l’enfer par un ange venu à lui sous la forme d’un lépreux.
Ces deux-là se sont donné du « Mon vieux » depuis la cour d’école de leur bourg de campagne. Entre eux s’est nouée, à la vie, à la mort, une de ces amitiés enfantines qui durent. « J’ai toujours connu Donatien », explique d’emblée le narrateur de Ils marchent le regard fier. Donatien n’était pas tout à fait un gamin comme les autres. Il avait la grâce étrange de ces meilleurs en tout. Habile aux exercices physiques et tout autant réfléchi et secret. Toujours le nez dans les livres, trimballant avec lui La Légende dorée, de Jacques de Voragine, où il relisait sans cesse l’histoire de saint Julien, qui tua père et mère et fut sauvé de l’enfer par un ange venu à lui sous la forme d’un lépreux.
« Il n’avait pas 10 ans, si avancé déjà, le front qui lui mangeait la moitié du visage, ce regard de clarté, les mains veineuses qu’on aurait dit celles d’un tailleur de pierre (…). Moi ça m’impressionnait. » L’un dans l’ombre de l’autre, les années ont passé. Donatien a épousé Marie, « la plus jolie, (…) un peu dans son genre à lui. » Et ils ont eu un fils que, sans crainte de la légende, ils ont tenu à appeler Julien.
« Mon vieux »… Avec le temps, l’affectueuse apostrophe a lentement pris son poids. Et sa réalité de souvenirs, de fatigues et de rides. Donatien et son fidèle ami vont s’apercevoir qu’on vieillit surtout dans le regard des autres. Le nouveau très court roman de Marc Villemain tisse une étrange et rude fable autour de ce constat. Il y tient la chronique d’une révolte qui fait descendre dans la rue des millions de gens âgés en colère, prêts à en découdre, question de survie, avec une jeunesse devenue l’ennemi absolu. Et dresse le tableau d’un véritable « gériacide ». Terrible époque. « On a peine à se l’imaginer. »
Demain, à qui le tour ? Passe encore de laisser les vieux debout dans les transports, de se faire servir avant eux chez les commerçants. Passe même de leur limiter l’accès aux lieux publics. Mais voici que, à la télévision, des programmes les incitent au suicide. Qu’on les jette hors des hôpitaux pour les laisser mourir sur le trottoir et qu’on leur fait la chasse, lâchant sur eux les chiens.
Dans cette société qui massacre ses aînés, le pouvoir est tenu par des trentenaires et des quadras qui semblent avoir oublié que pour eux aussi les années vont filer. Demain, à qui le tour ? Donatien est déjà bien avancé en âge. Si, dans sa campagne, les violences ne se déchaînent pas comme en ville, le poison de ce lourd conflit de générations commence aussi à se répandre. Il a même atteint sa propre famille. Après une dernière dispute, son fils Julien lui a tourné le dos. Il ne faut donc plus tarder à réagir. « Dans une tripotée de bourgades, et pas forcément les plus grandes, et pas forcément les plus fières, des vieux (…) se mettaient en boule et faisaient du barouf. » Donatien va se mettre à la tête de cette croisade d’ancêtres. Son nom de guerre : le Débris.
Nous voilà embarqués dans le récit d’une folle épopée, une geste héroïque, où Donatien a son Joinville. « Je voudrais pouvoir raconter les choses telles qu’elles se sont vraiment passées. Il ne faut pas inventer, je ne vais dire que ce qui est dans mes souvenirs… » L’ami d’enfance narrateur, obsédé par son rôle de témoin, s’exprime dans un parler paysan appliqué. Il ressasse, digresse, détaille, fait de longs retours en arrière, cherche les formules justes, les images parlantes. Ça piétine et ça cogne. Jouant de l’invraisemblance, du cliché assumé, du Grand-Guignol. Ici, on se chauffe la tête en buvant de l’eau-de-vie de prune et on part manifester avec des cannes-épées. Villemain n’est pas un auteur pour les « gueules délicates » que raille Paul Valet dans Solstices terrassés (Maihors saison, 1983). Mais son expressionnisme emporté recouvre une attention particulière à la fragilité des êtres. Chez lui, le grotesque masque le tragique. Le ricanement assourdit les soupirs douloureux. De l’homme politique déchu et amer de Et je dirai au monde toute la haine qu’il m’inspire (Maren Sell, 2006) aux onze cadavres en ribambelle de ses nouvelles cyniques, Et que morts s’ensuivent (Seuil, 2009), c’est tout une humanité abattue qu’on retrouve. Comme dans Le Pourceau, le Diable et la Putain (Quidam, 2011), son précédent texte, où il donnait voix à un abominable octogénaire misanthrope, crevant sur son lit d’hospice de mépris pour les autres et le monde.
Où va-t-on croiser le drame ? On l’attend sur le chemin de Donatien et de ses compagnons de lutte. Quand le monde « suinte la méchanceté », que valent encore les serments des enfants : à la vie, à la mort ?
Xavier HOUSSIN, in : Le Monde
Rimbaud à Java : le voyage perdu, de Jamie JAMES
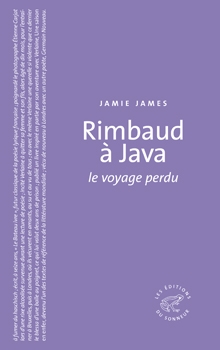
- 220 RimbaudaJava-1re 94[1]
![]() L’essai de Jamie James – Rimbaud à Java – que viennent de publier les éditions du Sonneur est de l’ordre de l’enchantement. Non seulement l’auteur s’attache à un épisode obscur de la vie du poète, qui après s’être engagé dans l’armée coloniale hollandaise embarqua pour Java puis déserta, mais il parvient, en l’absence de documents de première main rimbaldienne, à nous restituer ce hiatus biographique avec une exactitude cristalline. Se fondant sur des témoignages, des récits, des descriptions du Java du dernier quart du dix-neuvième siècle, James reconstitue, sans jamais délirer dans l’extrapolation, la matérialité synesthésique de cette île indonésienne où, attiré par le gain ou la simple soif d’ailleurs, l’auteur du Bateau ivre s’en alla échouer. Mais bien sûr, James ne fait pas que cela. Il nous retrace la vie du poète avant cette étrange escale, et ce avec une placidité et une subtilité qui au début déconcertent puis intriguent et enfin ravissent. Jamais il ne s’emballe au point de chausser, à pointure amoindrie, les semelles de vent du jeune fugitif. Plutôt, il l’accompagne à son rythme, le précède même afin de camper le décor, riche et documenté, qu’il lui faudra traverser.
L’essai de Jamie James – Rimbaud à Java – que viennent de publier les éditions du Sonneur est de l’ordre de l’enchantement. Non seulement l’auteur s’attache à un épisode obscur de la vie du poète, qui après s’être engagé dans l’armée coloniale hollandaise embarqua pour Java puis déserta, mais il parvient, en l’absence de documents de première main rimbaldienne, à nous restituer ce hiatus biographique avec une exactitude cristalline. Se fondant sur des témoignages, des récits, des descriptions du Java du dernier quart du dix-neuvième siècle, James reconstitue, sans jamais délirer dans l’extrapolation, la matérialité synesthésique de cette île indonésienne où, attiré par le gain ou la simple soif d’ailleurs, l’auteur du Bateau ivre s’en alla échouer. Mais bien sûr, James ne fait pas que cela. Il nous retrace la vie du poète avant cette étrange escale, et ce avec une placidité et une subtilité qui au début déconcertent puis intriguent et enfin ravissent. Jamais il ne s’emballe au point de chausser, à pointure amoindrie, les semelles de vent du jeune fugitif. Plutôt, il l’accompagne à son rythme, le précède même afin de camper le décor, riche et documenté, qu’il lui faudra traverser.
James aurait pu faire de cette parenthèse indonésienne un insupportable roman où le lacunaire se laisse honteusement occupé par l’imaginaire, où la reconstitution se vautre sur la paillasse de l’ignorance, et où la spéculation se met à danser la danse du ridicule. Il a d’ailleurs tenté l’aventure avant de se raviser, conscient que faire de Rimbaud un personnage de roman serait gâter le fruit unique dont il traquait l’intime maturation. Il a donc renoncé à son projet romanesque et préféré prendre la plume de l’ami enquêteur, en procédant par cercles et nappes de plus en plus vastes, jusqu’à ce que son essai s’ouvre aux leurres et aux lignes de fuite de l’échappée orientaliste.
On lira donc son Rimbaud à Java comme le récit d’un déserteur, mais d’un déserteur qui ne déserta pas que les rangs d’une armée brouillonne, composée d’éthyliques pioupious, puisque, si désertion il y eut pour Rimbaud, il faut l’étendre à plus d’un champ, et la laisser rayonner dans son mystère. James, d’ailleurs, s’aventure avec sérénité dans une hypothèse quant au silence rimbaldien, qui vaut ce qu’elle vaut :
Au lieu de méditer parmi les exquises subjectivités de la “vieillerie poétique”, il s’était engagé dans une quête plus grandiose encore : tout connaître ici-bas. Il maîtrisait les langues modernes comme il avait, enfant prodige, maîtrisé le latin et le grec ancien. Il apprendrait les sciences et les techniques de son époque, comme s’il se préparait à recréer un nouveau monde à partir de zéro. Il verrait le réel de ses propres yeux, sans aucun filtre.
On peut ainsi se demander s’il n’existerait pas, pour chaque écrivain, un point Rimbaud (un peu comme on dit un point Godwin), et qui serait ce moment où l’écrivain sait qu’écrire n’est plus de mise, plus comme ça, parce que les pages écrites ont d’elles-mêmes effacé toutes les traces et qu’il est temps de se décaler autrement dans le monde. Un point non de rupture mais d’effacement. Un “would prefer not to” qui prend son envol pour s’en aller fricoter avec d’autres acquiescements.
Il convient enfin de saluer la traduction d’Anne-Sylvie Homassel, par ailleurs écrivaine, traduction qui est un modèle de perfection, de grâce et d’empathie, à la fois transparente et charpentée. On le sait, l’essai-récit est un exercice hautement périlleux pour le traducteur ou la traductrice, et ce Rimbaud à Java est une merveille du genre à cet égard.
CLARO, in : Le clavier cannibale
Nous vous recommandons vivement de compléter ces découvertes en parcourant le site de l’éditeur www.editionsdusonneur.com qui propose, outre un résumé de chaque ouvrage, une courte biographie des écrivains, ainsi que l’annonce des livres à paraître.
Bonnes lectures !










Partager cet article