L’Inde à 24 images par seconde
Publié le 18/07/2011 à 23:00
-  20 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
20 min -
Modifié le 30/09/2022
par
Admin linflux
L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine. Soit. L'Inde est le foyer de civilisations parmi les plus anciennes, et un carrefour historique important des grandes routes commerciales.
Le fleuve de Jean Renoir
Le Fleuve, réal. & scénario de Jean Renoir, Opening
Après huit années de réalisation aux États-Unis, touché par les contraintes exercées par les studios et par le succès mitigé de ses derniers films, Jean Renoir accepte l’idée d’aller en Inde pour y tourner son prochain film, avec l’espoir de puiser dans l’aventure un regain d’inspiration, et de profiter des couleurs de l’Inde pour expérimenter le cinéma en couleurs.
En 1946, Jean Renoir découvre le roman de l’écrivain anglais Rumer Godden, The River, dont il achète les droits pour une éventuelle adaptation cinématographique. Trois ans plus tard, il peut s’envoler pour l’Inde. Un fleuriste, Kenneth McEldowney, qui souhaite entreprendre un film sur l’Inde, noue des relations avec des financeurs locaux qui lui procurent la somme nécessaire ; on lui recommande alors de se tourner vers l’adaptation du roman de Rumer Godden qui, bien qu’étant une étrangère, réussit néanmoins à délivrer une vision assez juste de l’Inde. Il rencontre Renoir et acquiesce à sa demande d’un repérage et d’un tournage sur place. Le film échappera donc au procédé de la reconstitution en studio, mais il passera cependant l’épreuve habituelle des previews qui aboutiront à l’augmentation, au montage définitif, de la part documentaire par rapport à la part fictionnelle.
Renoir quant à lui, s’assure de la collaboration de Rumer Godden pour écrire le scénario et de ses multiples transformations au fur et à mesure des scènes tournées. Fidèle à son principe de la « vérité extérieure », il recrute des acteurs amateurs pour tenir les rôles principaux – à part Arthur Shields (le père de Mélanie), acteur dans les films de John Ford, et Esmond Knight (le père d’Harriet). très présent dans les films de Michael Powell – , notamment Thomas E. Breen pour le rôle du capitaine John, ayant lui-même perdu, dans la vie réelle, une jambe à la guerre. Tombé sous le charme de la danseuse Radha Shri Ram, il invente le personnage de Mélanie, métisse pour l’occasion.
Renoir, en demandant à tourner en Inde, souhaitait approfondir sa compréhension de la civilisation indienne et dépasser l’exotisme. Il définit son projet dans l’un de ses textes daté de 1960 : “Les touristes, voire les pèlerins, ne pénètrent que rarement au-delà de la surface des êtres et des choses…La seule méthode pour saisir un peu de l’essence d’un paysage, du caractère d’un peuple ou de l’âme d’un individu est de travailler en sa compagnie…Lorsqu’il s’agit d’un film en extérieur permettant de travailler en commun avec les habitants du lieu, on a la sensation d’être devenu l’un d’eux, d’être un citoyen du village, de participer aux joies et aux soucis d’une communauté durable en contraste avec la communauté d’un film qui reste provisoire. C’est ce qui m’est arrivé avec l’Inde en tournant Le Fleuve…Maintenant, les manifestations artistiques, politiques, religieuses indiennes ne nous surprennent plus. Nous pouvons imaginer des visages familiers derrière les faits. Nous devinons quels pourraient être les motifs profonds d’amis laissés là-bas, de Radha ou de Krishna, de Ram ou de son épouse Minu pour telle ou telle décision. En ce qui me concerne, ces connaissances humaines ajoutées à ma connaissance obligatoire des paysages dans lesquels se déroulait l’action de mon film, me facilitent grandement la découverte de l’art et de la philosophie indiens. Les idées et les formes qui autrefois me paraissaient abstraites, commencent à se révéler comme des manifestations de vie presque quotidienne.“On perçoit dans cet écrit, que la connaissance du monde pour Renoir ne doit pas en rester à la sphère théorique, mais qu’elle repose sur son incarnation. Si le monde est obscur, c’est par la relation aux autres qu’on peut espérer y voir plus clair. Renoir est profondément amoureux des choses et des êtres, d’où les aspects réalistes et poétiques, charnels et panthéistes qui signent ses films.
L’action du film se déroule presque entièrement à l’intérieur d’une vaste demeure, habitée par des colons anglais. Cette maison est située en bordure du fleuve Hugli, et sa proximité permet à la caméra de saisir l’intense activité humaine qui retentit à l’extérieur.
Renoir ouvre son film sous le signe de l’art et de la civilisation indienne : au son d’une musique traditionnelle, des mains féminines, utilisant un mélange de farine de riz et d’eau, tracent sur le sol un motif de bienvenue, pratique répandue sur le continent sous le nom de rangoli. C’est cet aspect culturel et intemporel de l’Inde, qu’il choisira de montrer dans sa partie documentaire, délaissant les événements politiques récents aussi importants que l’indépendance du pays. On assistera donc, au fil des saisons, et tout au long du parcours des rives du fleuve, à des scènes de la vie quotidienne, qui sont vécues par le peuple indien, aussi bien physiquement que spirituellement. Comme le fera plus tard Rossellini dans son film India, Renoir s’attache à saisir l’âme indienne à partir des faits et gestes du quotidien qui souvent participent du sacré.
Pour la partie fictionnelle, Renoir limite volontairement les effets dramaturgiques. On assiste à une sorte de découpage brut d’un morceau de vie d’une famille anglaise, sans le soutien d’une intrigue haletante, avec une progression entre un début et une fin. Renoir donne à voir une succession de scènes, dont il faut goûter la substance au moment où elles se présentent. Le déroulement du film apparaît sans heurt, à l’image du cours du fleuve. D’où le sentiment de lenteur qui peut gagner l’esprit du spectateur pressé.
Le commentaire en voix off d’Hariett concourt à établir une distance émotionnelle par rapport aux élans passionnels et aux drames qui se jouent. Soulignons l’originalité de son emploi chez Renoir. Le commentaire ne sert jamais à expliquer une image, mais il est la réflexion même qu’entreprend le personnage d’Harriet à l’évocation de son passé. Renoir évite le flash-back, il filme ce qui ne relève pas du domaine des mots et il raconte ce qu’il ne veut pas filmer. Il introduit un degré de liberté dans la liaison son et image, qui lui permet d’associer les séquences documentaires aux séquences de fiction, et de les inscrire dans un seul ensemble poétique. Ainsi dans la maginifique séquence de la danse effectuée par Mélanie, son fiancé Anil peut emprunter sans choquer les apparences du dieu Krishna.
C’est tout le film d’ailleurs qui se présente comme un conte dont Harriet, adulte, est la narratrice. Une nature luxuriante et colorée aux allures de paradis perdu, baignée d’une lumière dorée, où les étrangers côtoient les autochtones avec bonhomie, où les rameurs qui descendent le fleuve semblent tout droit sortis d’une fresque égyptienne, où les femmes évoluent avec la grâce d’un tanagra, et où, enfin, le monde adulte apparaît inquiétant ou ennuyeux, vu du monde merveilleux de l’enfance.
Si l’histoire du film repose sur la situation universelle des premiers sentiments amoureux à l’âge de l’adolescence, il nous faut cependant apprécier ce film en tenant compte du lieu où il se déroule. Les échecs successifs des trois filles pour nouer une relation pérenne avec le capitaine John, la mort du jeune garçon Bogey, la naissance d’un sixième enfant dans la famille, trouvent à s’insérer dans une pensée hindoue où chaque être, constituant une partie consciente du monde, a une place à occuper. C’est en acceptant pleinement sa propre condition que l’on pourra se rendre utile au monde, dont les transformations et les exigences se renouvellent constamment.
Renoir arrive également dans le film à juxtaposer avec bonheur de nombreux éléments appartenant aux deux civilisations occidentale et orientale. De même que Bogey a pour meilleur ami Kanu, que les enfants de la famille sont élevés par une nourrice indienne, Renoir, qui confie la responsabilité de plusieurs taches primordiales de la réalisation – tels que le cadre, la musique, l’assistance de direction -, à des collaborateurs indiens (dont Satyajit Ray), parvient à la coexistence parfaite, pour la partie musicale du film, de la musique classique européenne (Schumann, Mozart, Weber) et de la musique traditionnelle de l’Inde. Là encore, la musique intervient pour elle-même, et ne sert pas à souligner ou à répéter le message délivré par les images. Mieux encore, c’est le film en entier qui repose sur une succession de scènes dont l’attrait ultime, la beauté envoutante, réside dans leur agencement poétique.
Pour aller plus loin
Cinéma, n° 10, automne 2005, p. 139-161.
Le texte constitue le chapitre 10 de My Works in Films, par Eugène Lourié. Texte très intéressant d’Eugène Lourié, chef décorateur, qui décrit avec minutie les circonstances dans lesquelles le film a été tourné.
Cahiers du cinéma, n° 35, mai 1954, p. 14-22.
Entretien avec Jean Renoir, par Jacques Rivette et François Truffaut, à propos du Fleuve.
Positif, n° 2, juin 1952, p. 13-17.
Article de Pierre-Yves Chanut qui salue avec ce film de facture très originale, le grand retour de Renoir au premier plan, depuis la Règle du Jeu.
Jean Renoir : une vie en oeuvres, par Claude-Jean Philippe, Grasset.
S’appuyant sur une multitude de documents émanant du réalisateur ou de ses exégètes, Claude Jean-Philippe suit l’itinéraire de Jean Renoir. Il consacre un chapitre entier au Fleuve, s’attachant à saisir les enjeux philosophiques et esthétiques du film, en essayant d’être au plus près de la création de jean Renoir, d’éviter les clichés ou les hypothèses hasardeuses qu’une lecture trop rapide engendrerait.
Ma vie et mes films, par Jean Renoir, Flammarion.
Renoir expose la genèse de ses films, son parcours de réalisateur, et ses rapports face aux gens de la profession et au public. Un chapitre entier évoque ses souvenirs à propos du film.
Autour du fleuve, réal. de Arnaud Mandagaran, CNC Images de la culture.
A partir d’images d’archives, d’entretiens avec les protagonistes, de témoignages, le film expose les circonstances dans lesquelles Le Fleuve a été produit et réalisé.
N’oubliez pas, si vous visionnez l’édition du Fleuve chez Opening (il existe une autre édition, Zone 1, chez Criterion, qui propose un étalonnage des couleurs plus pur mais moins fidèle aux versions projetées en salle à l’époque), l’analyse tout en finesse du remarquable critique de cinéma Jean Collet, grand connaisseur de l’œuvre de Renoir, qui décrit, avec beaucoup de sensibilité, les personnalités des personnages et leurs agissements.
Bollywood et le cinéma hindi : l’art des mélanges
C’est en Occident qu’a été créé le terme « Bollywood » pour exprimer l’éclat et le prestige de l’industrie cinématographique de Bombay, comparable à celle d’Hollywood.
L’industrie cinématographique indienne est dominée par le cinéma en langue hindi (la plus parlée de l’Inde), essentiellement produit à Bombay (appelée Mumbay depuis 1995), les autres centres étant Calcutta à l’Est et Madras dans le Sud. Ce cinéma a tout d’abord envahi toute l’Inde, avant de s’exporter dans le monde entier.
Le cinéma a toujours occupé une place prépondérante dans la vie des Indiens. Le cinéma de Bollywood est conçu pour plaire au plus grand nombre et offrir aux spectateurs une distraction complète : d’une durée de 2 h 30 à 3 h, un film intègre différents éléments répondant aux attentes du public, d’où son surnom de cinéma « masala » (= mélange en hindi). Un film doit donc respecter des conventions rigoureuses et rassembler : une distribution prestigieuse, une musique rythmée, mélodieuse et facile à retenir, des décors somptueux, des scènes d’action spectaculaires, l’assurance que l’ordre social ou moral ne sera pas remis en cause, et bien sûr un happy end. Les attributs moraux propres aux personnages sont strictement établis d’entrée de jeu. Le récit progresse suivant des variations radicales dans le ton et la tonalité du film est donc entièrement constituée par la juxtaposition d’un éventail complet d’ « ambiances » différentes (des scènes comiques, d’autres dramatiques, plus en général quatre ou six chants et deux ou trois passages dansés) à la connotation donnée et bien définie, et non par un développement linéaire.
Du fait de la censure, toute la sexualité est transposée du récit à la gestuelle (la danse), à la voix (les chansons), aux décors somptueux et aux couleurs chatoyantes. C’est ainsi que les séquences de danse jouent le rôle d’espaces privilégiés à l’intérieur desquels peut enfin se donner libre cours tout l’érotisme exclu du reste du film.
Le public vient donc davantage chercher une reconnaissance et l’inventaire de repères connus qu’une nouveauté absolue.
Cependant, tout en privilégiant le divertissement, le cinéma de Bollywood s’attaque néanmoins à de grands sujets tels que la famille, la religion et les traditions. Mais tout reste en général affaire d’individus et la société est rarement mise en cause. Les premiers films muets étaient inspirés de célèbres contes épiques indous tirés du Mahabharata et du Ramayana et la capacité à mettre en valeur la dimension mythologique du récit était un immense atout. Dans l’histoire du cinéma hindi, trois grands genres se détachent : les films mythologiques, les films historiques et religieux et le film social qui développent des thèmes récurrents : la pauvreté des campagnes, l’exploitation des paysans, les pratiques religieuses, l’amitié, la nostalgie des traditions, les dangers de la vie urbaine et les menaces de l’occidentalisation, l’évolution du rôle de la femme dans la société, la prédominance du destin dans la vie des personnages (thème récurrent par exemple chez Desai). L’amour, lui, est présent dans tous les scénarios.
Ces grandes lignes esquissées pour essayer de cerner les caractéristiques du cinéma bollywoodien ne doivent pas occulter le fait que celui-ci a considérablement évolué depuis son origine. Les années 30 et 40 ont été marquées par l’importance des grands studios (New Theatres, Bombay Takies…), le succès des films à caractère social et l’accroissement du pouvoir des vedettes. Le cinéma hindi connaît son apogée entre les années 50 et le milieu des années 60 : c’est l’âge d’or de la comédie musicale, l’arrivée de grands acteurs et l’apparition de films ambitieux, traitant notamment de problèmes sociaux : Awara, de Raj Kapoor ; Do Bigha Zameen de Bimal Roy ; Mother India, de Mehboob Khan, Deux hectares de terre, de Bimal Roy (1953)…, l’époque aussi où les drames en costumes et films mythologiques côtoient les productions associant divertissement et message social. Les années 50 voient aussi la naissance du film noir indien. La période de la fin des années 60 et des années 70 est une époque de contre-culture partout dans le monde. Les films hindis se font l’écho de ce mouvement en introduisant plus de violence et de sexe dans leurs scénarios. C’est aussi à ce moment qu’ils commencent à mélanger les genres. Se développe parallèlement toute une production de films d’auteur. Ankur, réalisé par Shyam Benegal, provoque en 1974 l’apparition d’un véritable mouvement de cinéma d’art et d’essai. Des réalisateurs cherchèrent à porter un regard plus réaliste sur la vie en Inde. Le Miroir de l’illusion, de Kumar Shahani, sorti en 1972, est une œuvre majeure du nouveau cinéma indien. Mani Kaul, lui, produit un cinéma d’avant-garde influencé par Robert Bresson et Ozu.
Avec cinq très grands succès à son actif, Subhash Ghai domine les années 80.
Le cinéma hindi des années 90 suit l’évolution de la société et est davantage préoccupé par des thèmes et des rêves de jeune cadre dynamique que par le point de vue des classes populaires, qu’il avait représenté jusque là. Cette décennie vit également le triomphe des comédies romantiques et des épopées familiales. C’est à partir de là aussi que l’industrie cinématographique commença à engranger des profits importants sur les marchés étrangers.
Depuis les années 2000, la mondialisation de Bollywood s’accélère, les multiplexes se développent. Toute une nouvelle génération d’acteurs et d’actrices s’est révélée et tous les genres se sont vus à l’écran. En 2002, Devdas est présenté en ouverture du Festival de Cannes. Mani Ratnam, tout en suivant les codes conventionnels de Bollywood, s’intéresse avec talent à des sujets d’actualité politiques et sociaux (Guru en 2007 ou encore Raavan en 2010).
Farah Khan, dans Om Shanti Om (2007), parodie et tourne en dérision le cinéma indien. Sanjay Leela Bhansali est reconnue internationalement depuis Devdas, en 2002. Avec Saawariya (2007) et Guzaarish (2010), son cinéma est dans doute, dans le genre Bollywood, le plus innovateur.
Actuellement, à Bombay, on produit près de 500 films par an, qui représentent 95% des œuvres diffusées en salles. Et si Bombay est la capitale du cinéma commercial, on voit également que tout au long de son histoire, des films d’auteurs y ont vu le jour.
Actuellement, avec la tendance à l’occidentalisation et l’exportation croissante des films indiens, on peut croire à une évolution certaine du cinéma bollywoodien par un « amenuisement » des codes historiques du genre.
Quelques ouvrages
Le cinéma indien : la saga de Bollywood, par Dinesh Raheja et Jitendra Kothari, C. Moreau
Un « beau livre » illustré retraçant l’histoire de Bollywood depuis 1913, date du premier long métrage indien, jusqu’au début des années 2000, où ambition artistique et commerciale se mêlent dans des réalisations à gros budgets.
Il était une fois Bollywood, photographies de Jonathan Torgovnik ; introduction de Nasreen Muni Kabir, Phaidon
Voyage photographique dans l’univers bollywoodien, présentant le cinéma itinérant, des images de tournage, des portraits de personnages et des photos du public. Une courte introduction résume de façon très efficace les caractéristiques formelles de ce cinéma, son histoire, son industrie et son importance pour les Indiens.
Le cinéma indien, L’Equerre, Centre Georges Pompidou
Ouvrage un peu ancien (1983) mais toujours de référence sur le cinéma indien. Deux chapitres concernent plus précisément notre sujet : « Le cinéma des régions » et « Made in Bombay : les films populaires en langue hindi ». Les articles sont suivis de la présentation de 114 films indiens, de 1926 à 1982.
Le cinéma indien, Asiexpo ed.
Présente l’histoire et la diversité du cinéma indien à travers les regards croisés d’historiens, écrivains, critiques de films, journalistes et professionnels du cinéma. Là encore, deux articles sont plus spécifiquement consacrés à Bollywood : Pourquoi suis-je critique de films Bollywood ? par Mayank Shekhar et Parcours d’un monteur de films à Bollywood, par Subhash Gupta.
Bollywood film studio ou Comment les films se font à Bombay, par Emmanuel Grimaud , CNRS ed.
« Enquête ethnographique reconstituant de manière minutieuse et vivante, le processus de création des films populaires hindi dans les studios de cinéma de Bombay », il s’agit ici de la version remaniée de la thèse de doctorat de l’auteur. Pour les passionnés.
Un certain cinéma en marge de Bollywood
Le dvd RE : FRAME propose 7 films d’artistes contemporains issus de la scène artistique alternative. Représentatifs d’un cinéma dans l’ombre de la production bollywodienne et en marge des circuits officiels, ces oeuvres selectionnées posent la question de l’identité indienne, du travail de mémoire et des rapports au passé récent de l’Inde contemporaine.
Dans notre objectif, deux films : Straight 8 et Space bar
Straight 8, a short experimental film d’ Ayishai Abraham
« Les films de famille ne sont qu’une horde d’images assommantes »
Ce presque aphorisme de presque Oscar Wilde [1] pourrait se loger aux confins des pensées que tout un chacun a rêvé de prononcer en pleine séance de visionnage du film de votre ami (?) Pierre-Paul-Jacques retracant son voyage en Inde (« Là…encore une vache sacrée… » commente ce dernier, inspiré).
Le film Straight 8 d’Ayisha Abraham vient en douceur contrecarrer l’image ennuyeuse et triviale du film de famille. Il tente même d’en souligner la dimension artistique, esthétique et sociologique.
Depuis 2000, cette artiste travaille à partir de films d’amateurs tournés dans les années 1950 à Bangladore (Inde), comme elle l’explique dans ce documentaire. Son œuvre est actuellement exposée au MAC de lyon et au Centre national d’art contemporain Pompidou.
Pour Straight 8, Ayisha Abraham a utilisé les films de son voisin, Tom d’Aguiar. Un chien qui court, les premiers pas d’un bébé…autant d’images tremblotantes, superposées, surexposées, jaunies, fantomatiques….Autant de stigmates immédiatement indentifiables des films d’amateur détériorés par le temps. D’où cette immanquable nostalgie qui nous saisit, un peu malgré nous.
Cette esthétique plastique, Ayisha Abraham l’exploite, la sample, la malaxe pour servir le propos du film, celui de nous mettre face à notre rapport au temps et à notre identité. Elle nous chuchote que même les petits moments, ceux de l’intimité, sont fondateurs de notre identité présente, et dans ce cas précis, celle d’une partie de la société indienne postcoloniale.
Le sous titre de Straight 8 « a short experimental film » n’est pas sans nous rappeler que d’autres artistes du cinéma expérimental se sont emparés du film de famille pour irriguer leurs créations : Mayan Deren, Joseph Morder mais surtout Jonas Mekas et l’œuvre de sa vie « Walden » extrait et Stan Brackhage, notamment « In Sirius Remembered », film en mémoire du chien de la famille décédé. Tous deux revendiquèrent la rhétorique du film d’amateur, pour se distinguer du cinéma commercial : « Nous ne voulons pas de films faux, bien faits, roublards – nous les préférons rudes, mal faits, mais vivants ; nous ne voulons pas de films roses – nous les voulons de la couleur du sang. » [2]]. Plus encore, pour Stan Brackhage, les films de famille ont une valeur ontologique. Ils dévoilent l’Etre du cinéma en général : « Tout l’art du cinéma émerge de l’amateur, du medium de famille ». [3].
Space Bar de Debkamal Ganguly (work in progress)
N’allez-pas le quérir dans les récits de voyage, ni dans les documentaires informatifs sur l’Inde qui en donneraient une toute autre densité, coloration, mesure sonore, …Ce road movie
n’est pas un opus de la série Un train pas comme les autres, même si celui-ci ne l’est vraiment pas : comme les autres. Et puis, personne ne dort chez personne. Cette découverte de l’Inde se fait donc réellement en mode inconnu, improbable, inédit, abstrait.
Space Bar a le goût d’un conte, les accents d’une déambulation imagée sur les mots de Bibhutibhushan Bandyopadhyay, auteur bengali de renom dont on connait “Pather Panchali” et “Aparajito” adaptés au cinéma par Satyajit Ray.
Mais ce pourrait être aussi la retranscription visuelle d’un rêve voire d’un cauchemar dont le sens échapperait au plus grand nombre, même à notre réalisateur endormi, certainement épris de Mac Laren et d’autres grands noms de l’Expérimental.
D’emblée, le discours verbal en hindi quasi hypnotique, répétitif et monocorde accentue l’opacité de la succession d’images de paysages bengalis et de territoires personnels.
La construction visuelle reste toute aussi énigmatique que la ballade verbale malgré quelques détails éloquents : un impact de balle sur la vitre du train, une main captive de l’écran qui ne saisit rien, désigne, dessine en ombre chinoise.
Les évocations métaphoriques nous égarent, évoquent parfois le mythe : celui de la caverne de Platon, d’autres, indiens…
Il y a quelques haltes : virtuelles avec Google Earth, réelles, dans des endroits désolés, le site archéologique de Bikramkhol, un village de lépreux désertique, des villes esquissées, des événements insignifiants, des traces d’événements, des traces de traces… une idée de la mémoire, du temps et de son délitement.
Quelques repères architecturés nous rallient à la vraie vie : les gares, espaces enfin « dévirtualisés », matérialisés : Belaphar, Ib (le nom le plus court de l’Inde). On se laisse séduire par les musiques d’Erik Satie, de Laurie Anderson ; par l’esthétisme d’un corps qui se pare de géographie.
Les questions métaphysiques nous laissent rêveurs…
« Et s’il y avait des villes, des champs, des bois tourmentés dans le corps » ?
On se surprend de sympathie pour le premier voyageur bengali en 1854, convaincu alors du fait que voyager longtemps dans un véhicule de feu (le train) réduirait la longévité humaine !
Finalement, cette dissolution du temps et de l’espace est normale car le propre du cinéma expérimental (indien y compris) n’est t-il pas de nous soumettre à l’expérience de la question, du déséquilibre comme à celle d’une recherche, en tous cas d’une impossible réception universelle ?
Debkamal Ganguly ponctue lui-même en nous livrant un article de journal au titre évocateur « UFO » bien conscient du trouble cinématographique qu’il jette en nous.
Et oui Shakti, Devdas,… le cinéma indien n’est pas uniquement bollywoodien mais comme le rappelle un proverbe indien : « Le monde flatte l’éléphant et piétine la fourmi ».
[1] “La famille n’est qu’une horde de parents assommants qui ignorent tout à fait comment vivre et sont incapables de deviner quand ils devraient mourir” extrait de Aphorismes d’Oscar Wilde
[2] [Une renaissance du cinéma : Le cinéma underground américain par Dominique Noguez. Paris : Klincksieck Esthétique, 1985, p. 31
[3] “In defense of amateur” in Scrapbook, Heller ed., p.162, 1982






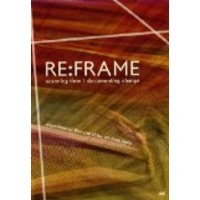






Partager cet article